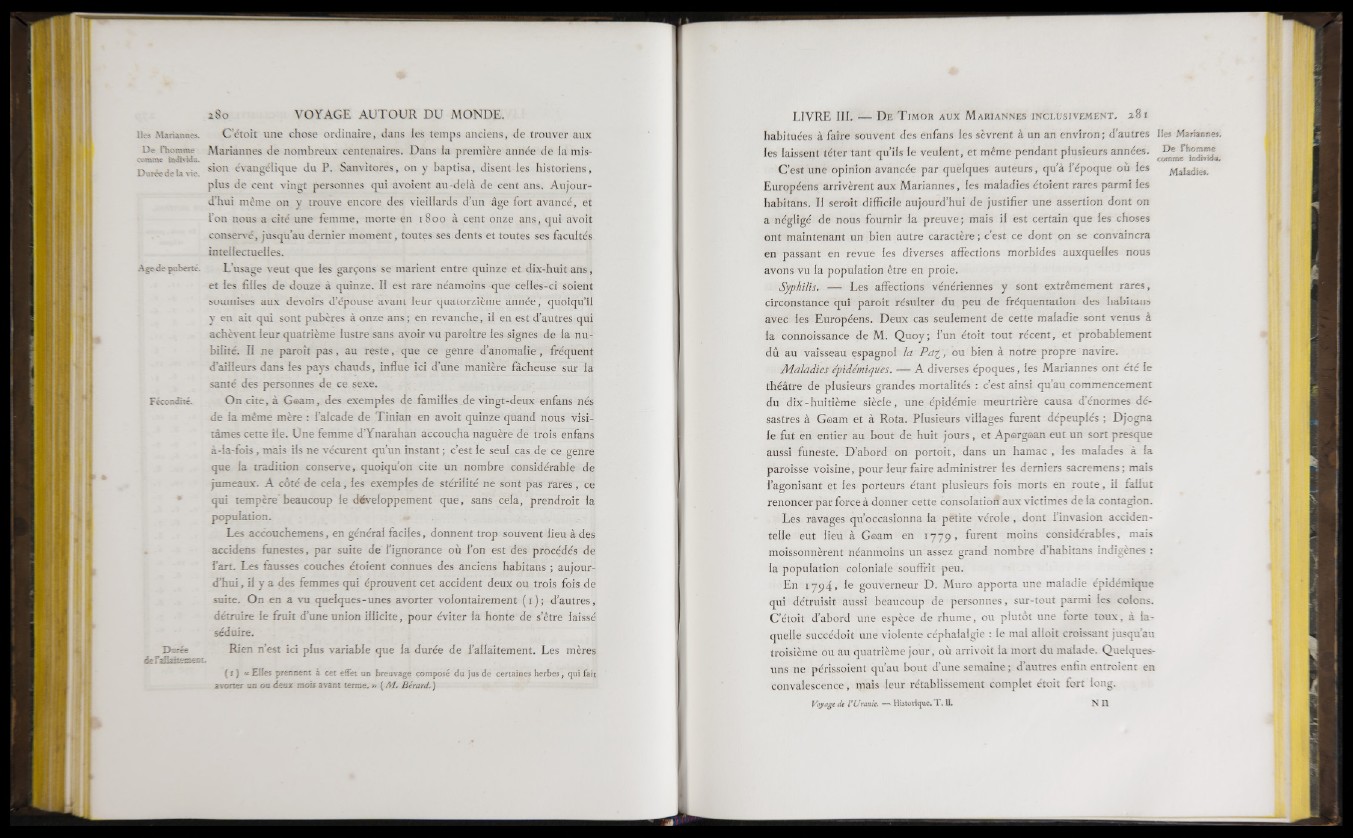
lies M aru i'uC i.
Ue rhomme
ocrnnic indhiùu.
Ui:ree de lèi vie.
zSo VOYAGE AUTOUR DU MONDE.
Cetoit une chose ordinaire, dans les temps anciens, de trouver aux
Mariannes de nombreux centenaires. Dans ia première aimce de la mission
évangélique du P. Sanvitores, on y baptisa, disent les historiens,
plus de cent vingt personnes qui avoient au-delà de cent ans. Aujour-
dhui même on v trouve encore des vieillards d'un âge lort avancé, et
Ion nous a cité une femme, morte en 1800 à cent onze ans, qui avoit
conservé, jusqu'au dernier moment, toutes ses dents et tontes ses facultés
intellectuelles.
A j s i i puberte. L'usage veut que ies gnrçons se marient entre quinze et dix-huit ans,
et ies filles de douze à quinze. II est rare néamoins que celles-ci soient
soumises aux devoirs d'épouse avant leur quatorzième année, quoiqu’il
y en ait qui sont pubères à onze ans ; en revanche, il en est d’autres qui
achèvent leur quatrième lustre sans avoir vu paroître les signes de la nu-
biliré. Il ne paroîr pas , au reste, que ce genre d’anomalie , fréquent
d’ailleurs dans les pays chauds, influe ici d’une manière fâcheuse sur la
santé des personnes de ce sexe.
On cite, à Gaam, des exemples de familles de vingt-deux enfans nés
de la même mère : l'alcade de Tinian en avoit quinze quand nous visitâmes
cene He. Une femme d'Ynarahan accoucha naguère de trois enfans
a-Ia-fois , mais ils ne vécurent qu’un instant ; c’est le seul cas de ce genre
que la tradition conserve, quoiqu’on cite un nombre considérable de
jumeaux. A côté de cela, les exemples de stérilité ne sont pas rares , ce
qui tempère beaucoup le développement que, sans cela, prendroit ia
population.
Les accouchemens, en général faciles, donnent trop souvent lieu à des
accidens funestes, par suite de l’ignorance où l’on est des procédés de
l’an. Les fausses couches étoient connues des anciens habitans ; aujourd’hui,
il y a des femmes qui éprouvent cet accident deux ou trois fois de
suite. On en a vm quelques-unes avorter volontairement (i); d’autres,
détruire le fruit d’une union illicite, pour éviter la honte de s’être laissé
séduire.
Rien n’est ici plus v'ariable que la durée de l’allaitement. Les mères
F fo c
( I ) E îîe î prennent à cet effet un breavage composé du jus de certaines herbes, qui fait
avorter un on deux mois avant terme. » ( M , Bérard . )
LIVRE III. — D e T jm o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t , 281
habiuiées à faire souvent des enfans les scvrent à un an environ; d’autres Iles .Mariannes,
les laissent téter tant qu’ils le veulent, et même pendant plusieurs années.
C ’est une opinion avancée par quelques auteurs, qu’à l’époque où les Maladies,
Européens arrivèrent aux Mariannes, les maladies étoient rares parmi les
habitans. 11 seroit difficile aujourd’hui de justifier une assertion dont on
a négligé de nous fournir la preuve; mais il est certain que les choses
ont maintenant nn bien autre caractère ; c’est ce dont on se convaincra
en passant en revue ies diverses affections morbides auxquelles nous
avons vu la population être en proie.
Syphilis. — Les affections vénériennes y sont extrêmement rares,
circonstance qui paroît résulter du peu de fréquentation des habitans
avec les Européens. Deux cas seulement de cette maladie sont venus à
ia connoissance de M. Quoy; l’un étoit tout récent, et probablement
dû au vaisseau espagnol la P a r , ou bien à notre propre navire.
Maladies épidémiques. — A diverses époques, les Mariannes ont été le
théâtre de piusieurs grandes mortalités : c’est ainsi qu’au commencement
du dix-huitième siècle, une épidémie meurtrière causa d’énormes désastres
à Goam et à Rota. Plusieurs villages furent dépeuplés ; Djogna
le fut en entier au bout de huit jours , et Aporgoan eut un sort presque
aussi funeste. D’abord on portoit, dans un hamac , les malades à la
paroisse voisine, pour leur faire administrer les derniers sacremens; mais
l’agonisant et les porteurs étant piusieurs fois morts en route , il fallut
renoncer par force à donner cette consolation aux victimes de ia contagion.
Les ravages qu’occasionna la petite vérole , dont I invasion accidentelle
eut lieu à Gfflam en 177p, furent moins considérables, mais
moissonnèrent néanmoins un assez grand nombre d'habitans indigènes :
la population coloniale souffrit peu.
En I 7p4 , le gouverneur D. Muro apporta une maladie épidémique
qui détruisit aussi beaucoup de personnes, sur-tour parmi les colons.
C’étoit d’abord une espèce de rhume, ou plutôt une forte toux, à laquelle
succédoit une violente céphalalgie : le mal alloit croissant jusqu'au
troisième ou au quatrième jour, où arrivoit la mort du malade. Quelques-
uns ne périssoient qu'au bout d'une semaine ; d'autres enfin eiuroient en
convalescence, mais leur rétablissement complet etoit fort long.
Vcyagc ik VÜTiinie. — HUtoviquc. 1 . IL N U