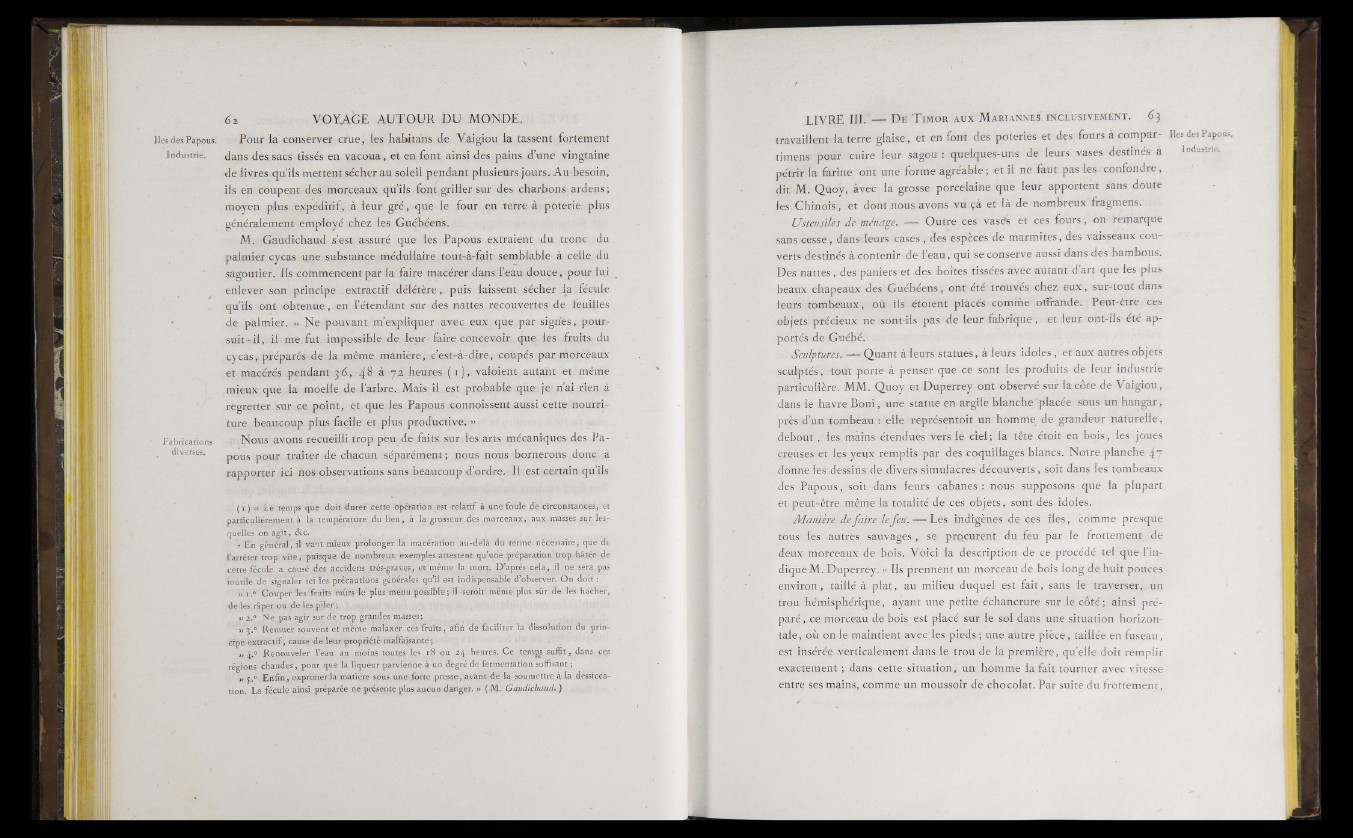
Iles des Papous.
Industrie.
Fabrications
diverses.
Pour la conserver crue, les habitans de Vaigiou la tassent fortement
dans des sacs tissés en vacoua, et en font ainsi des pains d’une vingtaine
de livres qu'ils mettent sécher au soleil pendant plusieurs jours. Au besoin,
ils en coupent des morceaux qu’ils font griller sur des charbons ardens;
moyen plus expéditif, à leur gré, que le four en terre à poterie plus
généralement employé chez les Guébéens.
M. Gaudichaud s’est assuré que les Papous extraient du tronc du
palmier cycas une substance médullaire tout-à-fait semblable à celle du
sagoutier. lis commencent par la faire macérer dans l’eau douce, pour lui
enlever son principe .extractif délétère, puis laissent sécher la fécule
qu’iis ont obtenue, en i’étendant sur des nattes recouvertes de feuilles
de palmier. « Ne pouvant m’expliquer avec eux que par signes, poursuit
il, il me fut impossible de leur faire concevoir que les fruits du
cycas, préparés de ia même manière, c’est-à-dire, coupés par morceaux
et macérés pendant 36, 4§ à 72 heures ( 1 ) , valoient autant et même
mieux que la moelle de l’arbre. Mais il est probable que je n’ai rien à
regretter sur ce point, et que les Papous connoissent aussi cette nourriture
beaucoup plus facile et plus productive. »
Nous avons recueilli trop peu de faits sur ies arts mécaniques des Papous
pour traiter de chacun séparément ; nous nous bornerons donc à
rapporter ici nos observations sans beaucoup d’ordre. Il est certain qu’ils
( I ) « L e temps que doit durer cette opération est re la tif à une foule de circonstances, et
particulièrement à la température du lie u , à la grosseur des m orce au x, aux masses sur les-,
quelles on a g it , & c .
» E n gén é ral, il vaut mieux prolonger la macération au-delà du terme nécessaire, que de
l’arrêter trop v it e , puisque de nombreux exemples attestent qu’une préparation trop hâtée de
cette fécule a causé des accidens très-graves, et même la mort. D ’après c e la , il ne sera pas
inutile de signaler ici les précautions générales qu’ il est indispensable d’observer. On doit :
■1 i . ° C oup e r les fruits mûrs le plus menu possible; il seroit même plus sûr de les hacher,
de les râper;ou de les p ile r ;
w 2 ," Ne pas agir sur de trop grandes masses;
» 3 .° Remuer souvent et même malaxer ces fruits, afin de faciliter la dissolution du principe
e x tra c tif, cause de leur propriété malfaisante;
» 4 . ° Ren ouv e le r l’eau au moins toutes les 1 8 ou 24 heures. C e temp_s su ffit, dans ces
régions ch au d e s , pour que la liqueur parvienne à un degré de fermentation suffisant ;
1) 5.° E n f in , exprimer la matière sous une forte presse, avant de la soumettre à la dessiccation.
L a fécule ainsi préparée ne présente plus aucun danger. » ( M. Caudlchaud. )
ous.
Industrie.
LIVRE III. — De T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 63
travaillent ia terre glaise, et en font des poteries et des fours à compar- Iles des Pap
tiinens pour cuire leur sagou : queiques-uns de ieurs vases destinés a
pétrir la farine ont une forme agréabie; et il ne faut pas les confondre,
dit M. Quoy, âvec la grosse porcelaine que leur apportent sans doute
les Chinois, et dont nous avons vu çà et là de nombreux fragmens.
Ustensiles de ménage. — Outre ces vases et ces fours, on remarque
sans cesse , dans leurs cases , des espèces de marmites, des vaisseaux couverts
destinés à contenir de l’eau , qui se conserve aussi dans des bambous.
Des nattes, des paniers et des boîtes tissées avec autant d’art que ies plus
beaux chapeaux des Guébéens, ont été trouvés chez eux, sur-tout dans
leurs tombeaux, où iis étoient placés comme offrande. Peut-être ces
objets précieux ne sont-ils pas de ieur fabrique , et leur ont-ils été apportés
de Guébé.
Sculptures. — Quant à leurs statues, à leurs idoles , et aux autres objets
sculptés, tout porte à penser que ce sont ies produits de leur industrie
particulière. MM. Quoy et Duperrey ont observé sur la côte de Vaigiou,
dans le havre Boni, une statue en argile blanche placée sous un hangar,
près d’un tombeau : elle représentoit un homme de grandeur naturelle,
debout , les mains étendues vers le ciel; la tête étoit en bois, les joues
creuses et les yeux remplis par des coquillages blancs. Notre pianche 47
donne ies dessins de divers simulacres découverts , soit dans ies tombeaux
des Papous, soit dans ieurs cabanes : nous supposons que la plupart
et peut-être même ia totalité de ces objets, sont des idoles.
Manière défaire le feu: — Les indigènes de ces îies, comme presque
tous les autres sauvages, se prqcurent du feu par ie frottement de
deux morceaux de bois. Voici la description de ce procédé tel que l’indique
M. Duperrey, « Ils prennent un morceau de bois long de huit pouces
environ, taillé à plat, au milieu duquel est fait, sans le traverser, un
trou hémisphérique, ayant une petite échancrure sur le côté; ainsi préparé,
ce morceau de bois est placé sur le soi dans une situation horizontale,
où on le maintient avec les pieds ; une autre pièce, taillée en fuseau,
est insérée verticalement dans le trou de !a première, qu’elle doit remplir
exactement ; dans cette situation, un homme la fait tourner avec vitesse
entre ses mains, comme un moussoir de chocolat. Par suite du frottement,