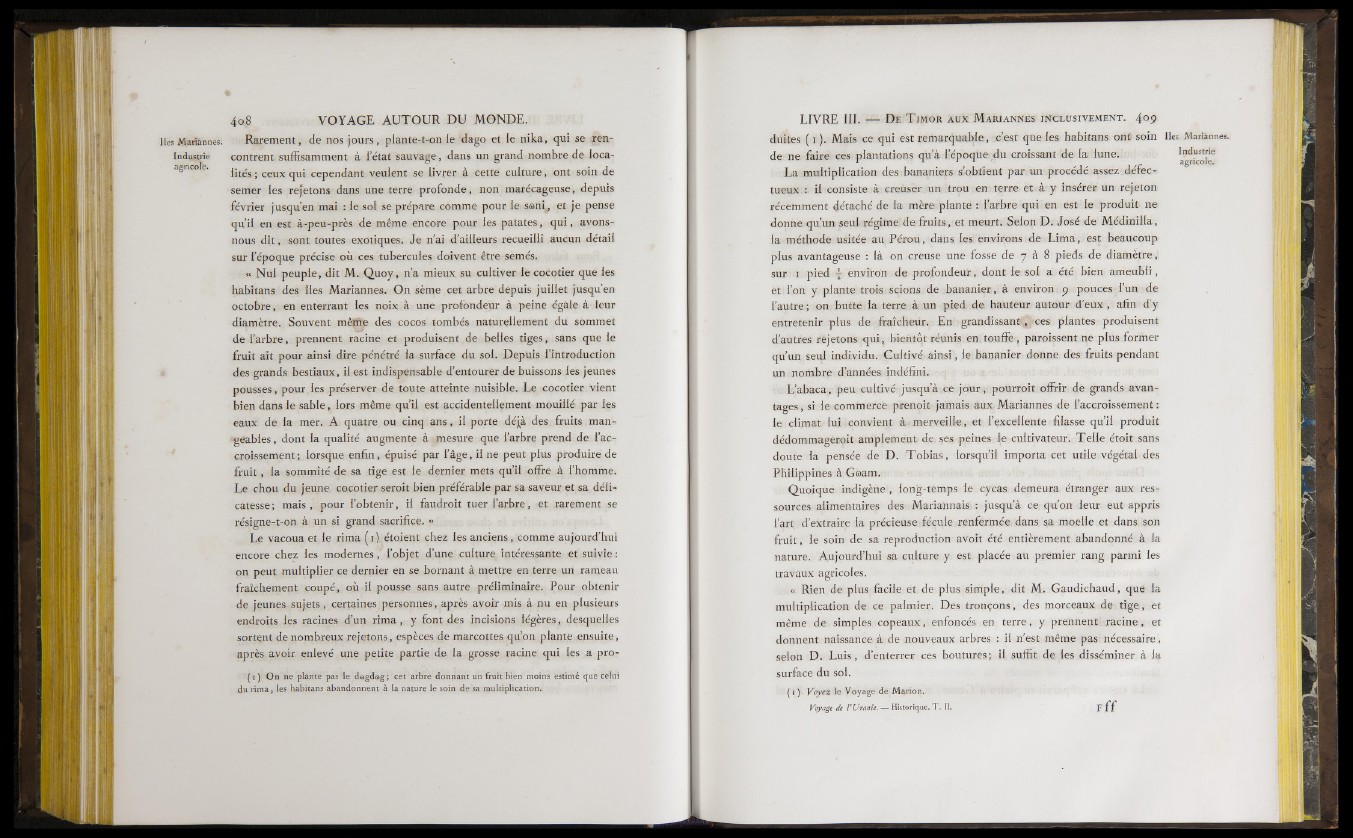
Industrie
agricole.
■■«I
I ' ::M
Rarement, de nos jours, plante-t-on le dago et le nika, qui se rencontrent
suffisamment à l’état sauvage, dans un grand nombre de localités
; ceux qui cependant veulent se livrer à cette culture, ont soin de
semer les rejetons dans une terre profonde, non marécageuse, depuis
février jusqu’en mai : le sol se prépare comme pour le soni, et je pense
qu’il en est à-peu-près de même encore pour les patates, qui, avons-
nous d it, sont toutes exotiques. Je n’ai d’ailleurs recueilli aucun détail
sur i’époque précise où ces tubercules doivent être semés.
« Nul peuple, dit M. Quoy, n’a mieux su cultiver le cocotier que les
habitans des îles Mariannes. On sème cet arbre depuis juillet jusqu’en
octobre, en enterrant les noix à une profondeur à peine égale à leur
diamètre. Souvent même des cocos tombés naturellement du sommet
de l’arbre, prennent racine et produisent de belles tiges, sans que ie
fruit ait pour ainsi dire pénétré la surface du sol. Depuis l’introduction
des grands bestiaux, il est indispensable d’entourer de buissons les jeunes
pousses, pour les préserver de toute atteinte nuisible. Le cocotier vient
bien dans le sable, lors même qu’il est accidentellement mouillé par les
eaux de ia mer. A quatre ou cinq ans , ii porte dé[à des fruits mangeables,
dont la qualité augmente à mesure que i’arbre prend de l’accroissement;
lorsque enfin, épuisé par l’âge, il ne peut plus produire de
fruit , la sommité de sa tige est ie dernier mets qu’il offre à i’homme.
Le chou du jeune cocotier seroit bien préférable par sa saveur et sa délicatesse;
mais, pour l’obtenir, il faudroit tuer i’arbre , et rarement se
résigne-t-on à un si grand sacrifice. »
Le vacoua et ie rima (i) étoient chez les anciens, comme aujourd’hui
encore chez les modernes , l’objet d’une culture intéressante et suivie ;
on peut multiplier ce dernier en se bornant à mettre en terre un rameau
fraîchement coupé, où il pousse sans autre préliminaire. Pour obtenir
de jeunes sujets , certaines personnes, après avoir mis à nu en plusieurs
endroits les racines d’un rima , y font des incisions légères, desquelles
sortent de nombreux rejetons, espèces de marcottes qu’on plante ensuite,
après avoir enlevé une petite partie de la grosse racine qui les a pro-
( I ) On ne plante pas le dogdag ; cet arbre donnant un fruit bien moins estimé que celu
du r im a , les habitans abandonnent à la nature ie soin de sa multiplication.
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 4 ° 9
duites ( I ). Mais ce qui est remarquable, c’est que les habitans ont soin lie s Mariannes.
de ne faire ces plantations qu’à l’époque du croissant de la lune. igri/ÛT
La multiplication des bananiers s’obtient par un procédé assez défectueux
: il consiste à creuser un trou en terre et à y insérer un rejeton
récemment détaché de la mère plante : i’arbre qui en est le produit ne
donne qu’un seul régime de fruits, et meurt. Selon D. José de Médinilia,
la méthode usitée au Pérou, dans les environs de Lima, est beaucoup
pius avantageuse : là on creuse une fosse de 7 à 8 pieds de diamètre,
sur I pied ] environ de profondeur, dont le sol a été bien ameubli,
et l’on y plante trois scions de bananier, à environ 9 pouces l’un de
l’autre ; on butte la terre à un pied de hauteur autour d’eux , afin d’y
entretenir pius de fraîcheur. En grandissant , ces piantes produisent
d’autres rejetons qui, bientôt réunis en touffe, paroissent ne plus former
qu’un seul individu. Cultivé ainsi, le bananier donne des fruits pendant
un nombre d’années indéfini.
L’abaca, peu cultivé jusqu’à ce jour, pourroit offrir de grands avantages
, si ie commerce prenoit jamais aux Mariannes de l’accroissement :
le climat lui convient à merveille, et l’excellente filasse qu’il produit
dédommageroit amplement de ses peines le cultivateur. Telle étoit sans
doute la pensée de D. Tobias, lorsqu’il importa cet utile végétal des
Philippines à Goam.
Quoique indigène , long-temps le cycas demeura étranger aux ressources
alimentaires des Mariannais : jusqu’à ce qu’on leur eut appris
l’art d’extraire la précieuse fécule renfermée dans sa moelle et dans son
fruit, le soin de sa reproduction avoit été entièrement abandonné à la
nature. Aujourd’hui sa culture y est placée au premier rang parmi les
travaux agricoles.
« Rien de plus facile et de pius simple, dit M. Gaudichaud, que la
multiplication de ce palmier. Des tronçons, des morceaux de tige, et
même de simples copeaux, enfoncés en terre, y prennent racine, et
donnent naissance à de nouveaux arbres : il n’est même pas nécessaire,
selon D. Luis , d’enterrer ces boutures ; il suffit de les disséminer à la
surface du sol.
( I ) Voyez Le V o y a g e de M arion.
Voyage de l ’ Uranie, — Historique. T . II. r f f