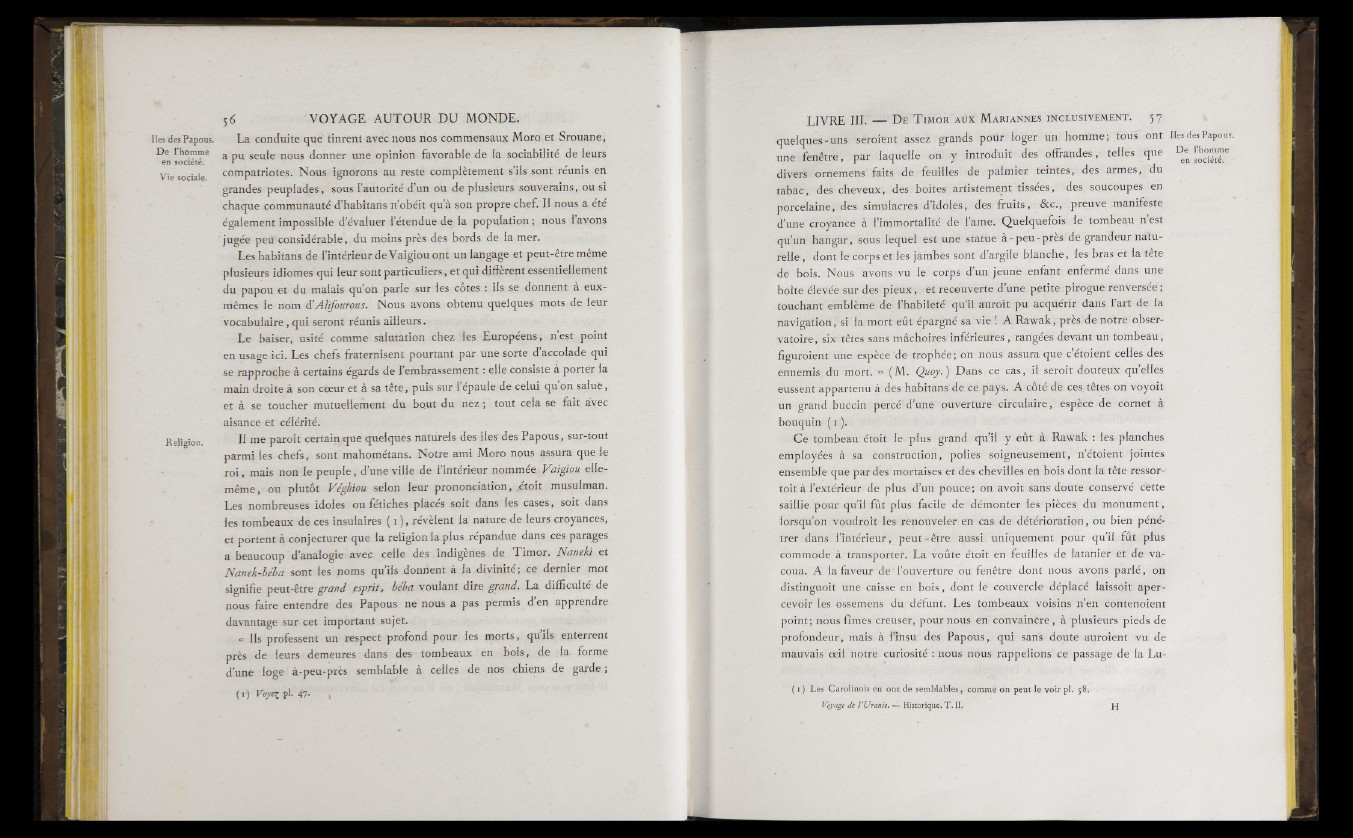
Iles des Papous.
D e l’homme
en société.
V ie sociale.
R e lig io n .
La conduite que tinrent avec nous nos commensaux Moro et Srouane,
a pu seule nous donner une opinion favorable de la sociabilité de leurs
compatriotes. Nous ignorons au reste complètement s’ils sont réunis en
grandes peuplades, sous l’autorité d’un ou de plusieurs souverains, ou si
chaque communauté d’habitans n’obéit qu’à son propre chef. II nous a été
également impossible d’évaluer i’étendue de la population ; nous l’avons
jugée peu considérable, du moins près des bords de la mer.
Les habitans de l’intérieur de Vaigiou ont un langage et peut-être même
plusieurs idiomes qui ieur sont particuliers, et qui diffèrent essentiellement
du papou et du malais qu’on parie sur ies côtes : ils se donnent à eux-
mêmes le nom à’Alifourous. Nous avons obtenu quelques mots de ieur
vocabulaire , qui seront réunis ailleurs.
Le baiser, usité comme salutation chez les Européens, n’est point
en usage ici. Les chefs fraternisent pourtant par une sorte d accolade qui
se rapproche à certains égards de l’embrassement ; elle consiste à porter la
main droite à son coeur et à sa tête, puis sur l’épaule de celui qu on salue,
et à se toucher mutueliement du bqut du nez ; tout ceia se fait avec
aisance et célérité.
Il me paroît certain que quelques naturels des îies des Papous, sur-tout
parmi ies chefs, sont mahométans. Notre ami Moro nous assura que le
ro i, mais non le peuple, d’une ville de l’intérieur nommée Vaigiou elle-
même, ou plutôt Véghiou selon leur prononciation, étoit musulman.
Les nombreuses idoles ou fétiches placés soit dans les cases, soit dans
ies tombeaux de ces insulaires ( i ), révèlent la nature de leurs croyances,
et portent à conjecturer que la religion la pius répandue dans ces parages
a beaucoup d’analogie avec celle des indigènes de Timor. Naneki et
Nanek-béba sont les noms qu’iis donnent à la divinité; ce dernier mot
signifie peut-être grand esprit, béba voulant dire grand. La difficulté de
nous faire entendre des Papous ne nous a pas permis d en apprendre
davantage sur cet important sujet.
« lis professent un respect profond pour ies morts, quils enterrent
près de ieurs demeures dans des tombeaux en bois, de la forme
d’une loge à-peu-près semblable à celles de nos chiens de garde ;
( I ) V o y e ^ p l . 4 7 .
D e l’ homme
en société.
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 57
quelques-uns seroient assez grands pour loger un homme; tous ont Ile s des P ap o u ,
une fenêtre, par laquelle on y introduit des offrandes, telles que
divers ornemens faits de feuiiies de palmier teintes, des armes, du
tabac, des cheveux, des boîtes artistement tissées, des soucoupes en
porcelaine, des simulacres d’idoles, des fruits, &c., preuve manifeste
d’une croyance à l’immortalité de i’ame. Queiquefois le tombeau n est
qu’un hangar, sons lequel est une statue à-peu-près de grandeur naturelle
, dont le corps et les jambes sont d’argile blanche, les bras et la tete
de bois. Nous avons vu le corps d’un jeune enfant enferme dans une
boîte élevée sur des pieux , et recouverte d’une petite pirogue renversée ;
touchant emblème de l’habileté qu’il auroit pu acquérir dans l’art de la
navigation, si ia mort eût épargné sa vie ! A Rawak, près de notre observatoire,
six têtes sans mâchoires inférieures , rangées devant un tombeau,
figuroient une espèce de trophée; on nous assura que c’étoient celles des
ennemis du mort. » (M. Qiioy.) Dans ce cas, il seroit douteux quelles
eussent appartenu à des habitans de ce pays. A côté de ces têtes on voyoit
un grand buccin percé d’une ouverture circulaire, espèce de cornet à
bouquin ( i ),
Ce tombeau étoit le plus grand qu’il y eût à Rawak : les planches
employées à sa construction, polies soigneusement, n’étoient jointes
ensemble que par des mortaises et des chevilles en bois dont la tête ressor-
toit à l’extérieur de plus d’un pouce; on avoit sans doute conservé cette
saillie pour qu’il fût plus facile de démonter les pièces du monument,
lorsqu’on voudroit les renouveler en cas de détérioration, ou bien pénétrer
dans l’intérieur, peut-être aussi uniquement pour qu’il fût plus
commode à transporter. La voûte étoit en feuilles de latanier et de vacoua.
A ia faveur de l’ouverture ou fenêtre dont nous avons parié, on
distinguoit une caisse en bois, dont le couvercle déplacé laissoit apercevoir
ies osseinens du défunt. Les tombeaux voisins n’en contenoient
point; nous fîmes creuser, pour nous en convaincre, à plusieurs pieds de
profondeur, mais à l’insu des Papous, qui sans doute auroient vu de
mauvais oeil notre curiosité : nous nous rappelions ce passage de la Lii-
( I ) Les Carolinois en ont de semblables, comme on peut le v o ir pl. 58.
Voyage de l ’Uranie, — Historigiie. T . II. H