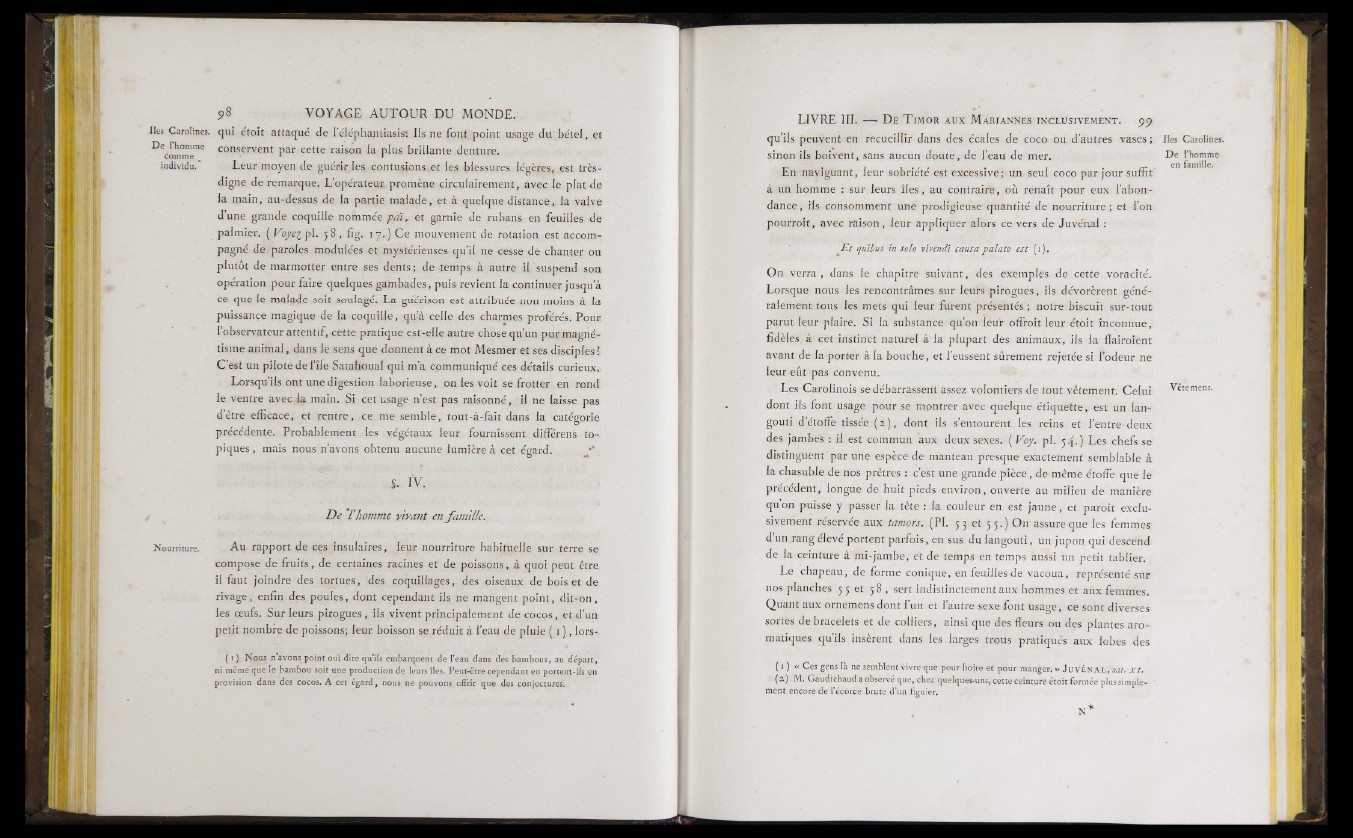
lie s Ca roline s. qui étolt attaqué de l’éléphantiasist Ils ne font point usage du bétei, et
D e l’ homme
comme
individu.
conservent par cette raison la plus brillante denture.
Leur moyen de guérir les contusions et les blessures légères, est très-
digne de remarque. L ’opérateur promène circulairement, avec le plat de
ia main, au-dessus de la partie malade, et à quelque distance, ia vaive
d’une grande coquille nommée pai, et garnie de rubans en feuilles de
palmier. (Voyez pl. 58, fig. 17 .) Ce mouvement de rotation est accompagné
de paroles modulées et mystérieuses qu’il ne cesse de chanter ou
plutôt de m.armotter entre ses dents; de temps à antre il suspend son
opération pour faire quelques gambades, puis revient ia continuer jusqu’à
ce que le malade soit soulagé. La guérison est attribuée non moins à la
puissance magique de la coquilie, qu’à celle des charmes proférés. Pour
l’observateur attentif, cette pratique est-elle autre chose qu’un pur magnétisme
animal, dans le sens que donnent à ce mot Mesmer et ses disciples!
C ’est un pilote de i’île Satahoual qui m’a communiqué ces détails curieux.
Lorsqu’ils ont une digestion laborieuse, on les voit se frotter en rond
ie ventre avec la main. Si cet usage n’est pas raisonné, il ne laisse pas
d’être efficace, et rentre, ce me semble, tout-à-fait dans la catégorie
précédente. Probablement les végétaux leur fournissent différens topiques
, mais nous n’avons obtenu aucune lumière à cet égard.
§. IV.
De TIwmme vivant en famille.
Nourriture. Au rapport de ces insulaires, leur nourriture habituelle sur terre se
compose de fruits, de certaines racines et de poissons, à quoi peut être
il faut joindre des tortues, des coquillages, des oiseaux de bois et de
rivage, enfin des poules, dont cependant iis ne mangent point, dit-on,
ies oeufs. Sur leurs pirogues, ils vivent principalement de cocos, et d’un
petit nombre de poissons; leur boisson se réduit à l’eau de pluie ( i ), lors-
( 1 ) N ou s n’avons point ouï dire qu’ils embarquent de l’eau dans des bambous, au départ,
ni meme que le bambou soit une production de leurs îles. Peut-être cependant en portent-ils en
provision dans des cocos. A cet é g a rd , nous ne pouvons offrir que des conjectures.
D e l’homme
en famille.
LIVRE III. — De T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 99
qu’iis peuvent en recueiliir dans des écales de coco ou d’autres vases ; Ile s Carolines.
sinon ils boivent, sans aucun doute, de l’eau de mer.
En naviguant, leur sobriété est excessive; un seul coco par jour suffit
à un homme : sur leurs îles, au contraire, où renaît pour eux l’abondance,
ils consomment une prodigieuse quantité de nourriture; et l’on
pourroit, avec raison, leur appliquer alors ce vers de Juvéïial :
E t quitus in solo vivendi causa palato est ( i ).
On verra, dans le chapitre suivant, des exemples de cette voracité.
Lorsque nous les rencontrâmes sur leurs pirogues, ils dévorèrent généralement
tous les mets qui leur furent présentés; notre biscuit sur-tout
parut leur plaire. Si la substance qu’on ieur offroit leur étoit inconnue,
fidèles à cet instinct naturel à la plupart des animaux, ils la flairoient
avant de la porter à la bouche, et l’eussent sûrement rejetée si l’odeur ne
leur eût pas convenu.
Les Carolinois se débarrassent assez volontiers de tout vêtement. Celui Vêtemens.
dont ils font usage pour se montrer avec quelque étiquette, est un langouti
d’étoffe tissée (2 ), dont ils s’entourent les reins et l’entre-deux
des jambes ; ii est commun aux deux sexes. ( Voy. pl. 54.) Les chefs se
distinguent par une espèce de manteau presque exactement semblable à
la chasuble de nos prêtres : c’est une grande pièce, de même étoffe que le
précédent, longue de huit pieds environ, ouverte au milieu de manière
qu’on puisse y passer ia tête ; la couleur en est jaune, et paroît exclusivement
réservée aux tamors. (Pl. 53 et 55.) On assure que les femmes
d un rang élevé portent parfois, en sus du langouti, un jupon qui descend
de ia ceinture à mi-jambe, et de temps en temps aussi un petit tablier.
Le chapeau, de forme conique, en feuilles de vacoua, représenté sur
nos planches 5 5 et 58 , sert indistinctement aux liommes et aux femmes.
Quant aux ornemens dont l'un et l’autre sexe font usage, ce sont diverses
sortes de bracelets et de colliers, ainsi que des fleurs ou des plantes aromatiques
qu’ils insèrent dans les larges trous pratiqués aux lobes des
( I ) « Ce s gens là ne semblent v ivre que pour boire et pour manger. „ Ju v É N .A L , sat. X I .
( 2 ) M. Gaudichaud aob se rv é que, chez quelques-uns, cette ceinture étoit formée plussimple-
ment encore de l’écorce brute d’un figuier.