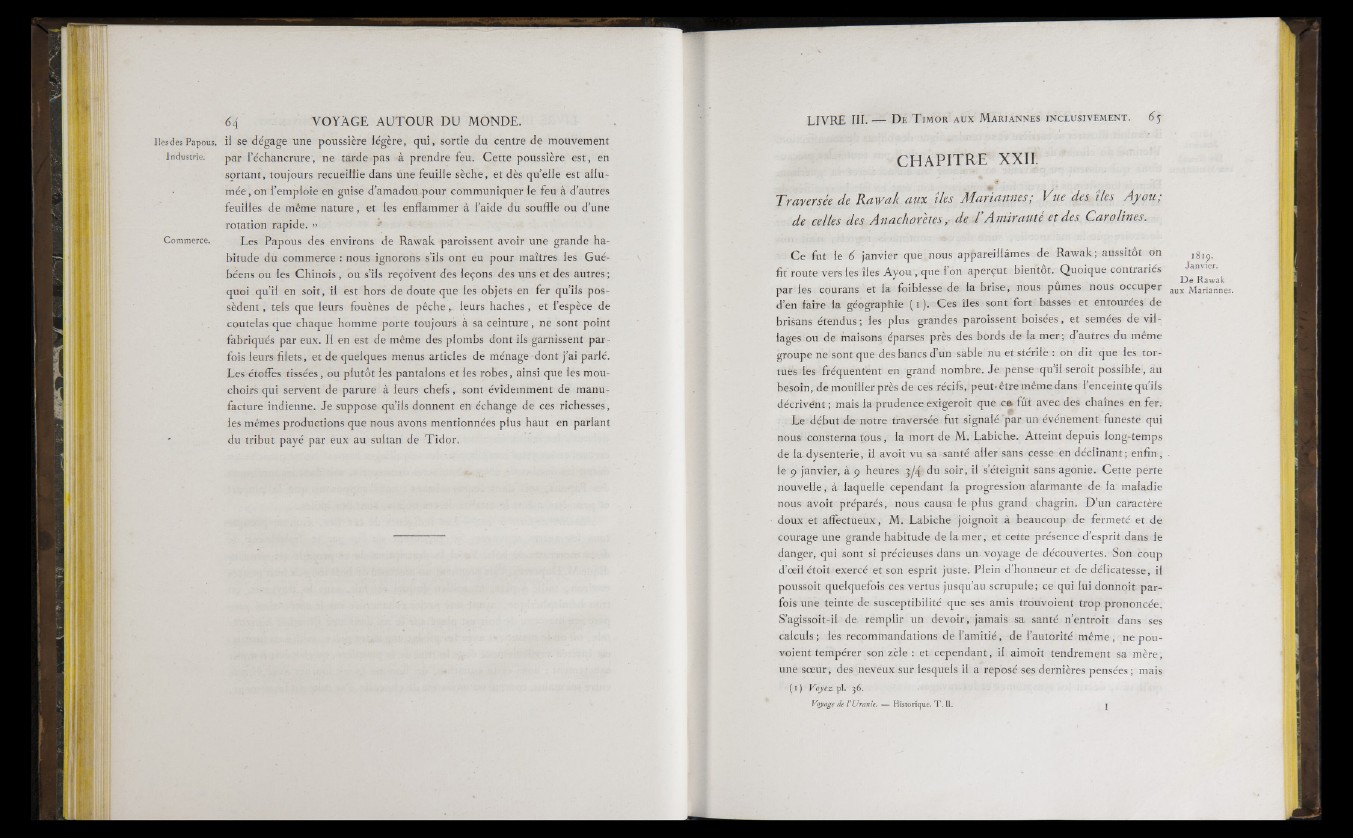
lie s des Papous.
Industrie.
Commerce.
il se dégage une poussière légère, qui, sortie du centre de mouvement
par i’échancrure, ne tarde pas à prendre feu. Cette poussière est, en
sortant, toujours recueillie dans une feuille sèche, et dès qu’elle est allumée,
on l’emploie en guise d’amadou pour communiquer le feu à d’autres
feuilles de même nature, et ies enflammer à i’aide du souffle ou d’une
rotation rapide. »
Les Papous des environs de Rawak paroissent avoir une grande habitude
du commerce : nous ignorons s’ils ont eu pour maîtres les Guébéens
ou les Chinois, ou s’ils reçoivent des leçons des uns et des autres ;
quoi qu’il en soit, il est hors de doute que les objets en fer qu’ils possèdent
, tels que leurs fouènes de pêche , ieurs haches , et l’espèce de
couteias que chaque homme porte toujours à sa ceinture, ne sont point
fabriqués par eux. II en est de même des plombs dont iis garnissent parfois
ieurs filets, et de quelques menus articles de ménage dont j’ai parlé.
Les étoffes tissées, ou plutôt les pantalons et les robes, ainsi que les mouchoirs
qui servent de parure à leurs chefs , sont évidemment de manufacture
indienne. Je suppose qu’ils donnent en échange de ces richesses,
les mêmes productions que nous avons mentionnées plus haut en parlant
du tribut payé par eux au sultan de Tidor.
CHAPITRE XXII.
Traversée de Rawak aux îles Mariannes; Vue des îles Ayou;
de celles des Anachorètes, de l ’Amirauté et des Carolines.
Ce fut ie 6 janvier que nous appareillâmes de Rawak; aussitôt on
fit route vers les îles Ayou , que l’on aperçut bientôt. Quoique contrariés Jan v ie r .
4 - , , , , 1 • A D e R aw a k par les courans et la foiblesse de la brise, nous pûmes nous occuper aux Mariannes,
d’en faire ia géographie ( i ). Ces îles sont fort basses et entourées de
brisans étendus; les plus grandes paroissent boisées, et semées de villages
ou de maisons éparses près des bords de la mer; d’autres du même
groupe ne sont que des bancs d’un sable nu et stérile : on dit que les tortues
les fréquentent en grand nombre. Je pense qu’il seroit possible, au
besoin, de mouiller près de ces récifs, peut-être même dans i’enceinte qu’ils
décrivent; mais la prudence exigeroit que ce fût avec des chaînes en fer.
Le début de notre traversée fut signalé par un événement funeste qui
nous consterna tous , la mort de M. Labiche. Atteint depuis long-temps
de la dysenterie, ii avoit vu sa santé aller sans cesse en déclinant; enfin, ■
le 9 janvier, à 9 heures 3/4 du soir, il s’éteignit sans agonie. Cette perte
nouvelle, à laquelle cependant la progression alarmante de la maladie
nous avoit préparés, nous causa ie plus grand chagrin. D’un caractère
doux et affectueux, M. Labiche joignoit à beaucoup de fermeté et de
courage une grande habitude de la mer, et cette présence d’esprit dans le
danger, qui sont si précieuses dans un voyage de découvertes. Son coup
d’oeil étoit exercé et son esprit juste. Plein d’honneur et de délicatesse, il
poussoit quelquefois ces vertus jusqu’au scrupule; ce qui lui donnoit parfois
une teinte de susceptibilité que ses amis trouvoient trop prononcée.
S’agissoit-il de remplir un devoir, jamais sa santé n’entroit dans ses
calculs; les recommandations de l’amitié, de l’autorité même , ne pouvoient
tempérer son zèle : et cependant, il aimoit tendrement sa mère,
une soeur, des neveux sur lesquels il a reposé ses dernières pensées ; mais
( i ) Voyez pl. 36.
Voyage de l ’Uranie. — Historique. T . II. j