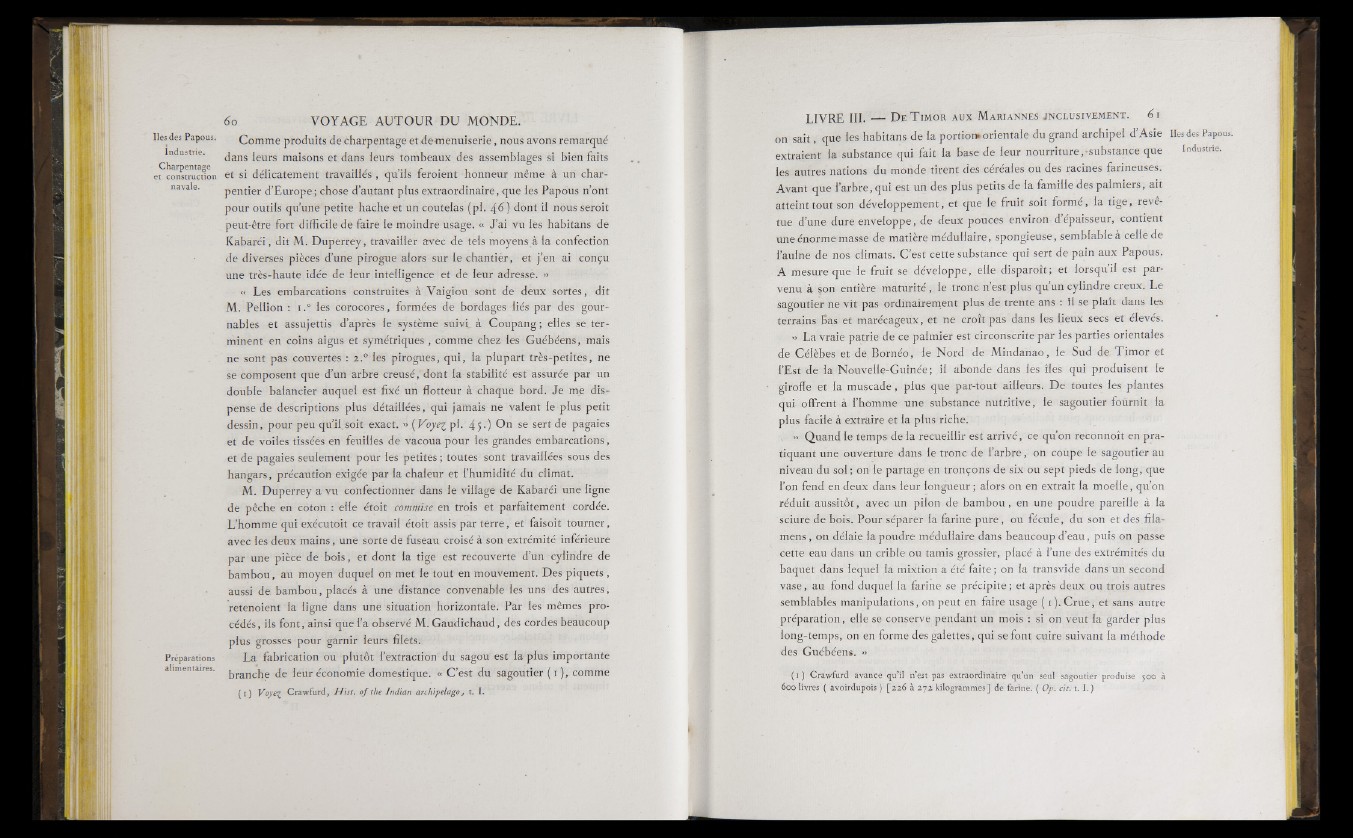
Iles des Papous. Comme produits de charpentage et de menuiserie, nous avons remarqué
In d u s trie . J a ^ s leurs maisons et dans leurs tombeaux des assemblages si bien faits
Charpentage . r ■ a ,
et construction et SI délicatement travailles , quils reroient honneur meme a un charnava
le. pentier d’Europe; chose d’autant plus extraordinaire, que les Papous n’ont
pour outils qu’une petite hache et un coutelas (pl. 46) dont il nous seroit
peut-être fort difficile de faire le moindre usage. « J ’ai vu les habitans de
Kabaréi, dit M. Duperrey, travaiiier avec de tels moyens à ia confection
de diverses pièces d’une pirogue alors sur le chantiér, et j’en ai conçu
une très-haute idée de leur intelligence et de leur adresse. »
« Les embarcations construites à Vaigiou sont de deux sortes, dit
M. Peilion ; i.° les corocores, formées de bordages liés par des gour-
nables et assujettis d’après le système suivi à Coupang ; elies se terminent
en coins aigus et symétriques , comme chez ies Guébéens, mais
ne sont pas couvertes : 2.° les pirogues, qui, la plupart très-petites, ne
se composent que d’un arbre creusé, dont ia stabilité est assurée par un
double balancier auquel est fixé un flotteur à chaque bord. Je me dispense
de descriptions plus détaillées, qui jamais ne valent le plus petit
dessin, pour peu qu’il soit exact. » (Voye^pl. 4 y ) On se sert de pagaies
et de voiles tissées en feuiiies de vacoua pour ies grandes embarcations,
et de pagaies seulement pour les petites ; toutes sont travaillées sous des
hangars, précaution exigée par la chaleur et i’humidité du climat.
M. Duperrey a vu confectionner dans le village de Kabaréi une ligne
de pêche en coton : eiie étoit commise en trois et parfaitement cordée.
L’homme qui exécutoit ce travail étoit assis par terre, et faisoit tourner,
avec les deux mains, une sorte de fuseau croisé à son extrémité inférieure
par une pièce de bois, et dont la tige est recouverte d’un cylindre de
bambou, au moyen duquel on met ie tout en mouvement. Des piquets ,
aussi de bambou, placés à une distance convenable les uns des autres,
retenoient la ligne dans une situation horizontale. Par les mêmes procédés,
iis font, ainsi que l’a observé M. Gaudichaud, des cordes beaucoup
pius grosses pour garnir leurs filets.
Préparations La fabrication ou plutôt i’extraction du sagou est la plus importante
alimentaires. jg leur économie domestique. « C’est du sagoutier ( i ), comme
( 0 Vo)'^\ L raw fu rd , H is t , o f the Ind ian archipelago, t. I.
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i . a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 6 1
on sait, que les habitans de la portion* orientale du grand archipel d’Asie lie s des Papous,
extraient la substance qui fait la base de leur nourriture,-substance que Industrie,
les autres nations du monde tirent des céréales ou des racines farineuses.
Avant que l’arbre, qui est un des plus petits de la famille des palmiers, ait
atteint tout son développement, et que le fruit soit formé, la tige, reve-
tue d’une dure enveloppe, de deux pouces environ d épaisseur, contient
une énorme masse de matière médullaire, spongieuse, semblable à celle de
l’auIne de nos climats. C ’est cette substance qui sert de pain aux Papous.
A mesure que le fruit se développe, elle disparoît; et lorsquil est parvenu
à son entière maturité , le tronc n’est plus qu’un cylindre creux. Le
sagoutier ne vit pas ordinairement plus de trente ans : il se piaît dans les
terrains bas et marécageux, et ne croît pas dans les lieux secs et élevés.
» La vraie patrie de ce palmier est circonscrite par les parties orientales
de Célèbes et de Bornéo, ie Nord de Mindanao, le Sud de Timor et
l’Est de la Nouvelle-Guinée; il abonde dans les îles qui produisent le
girofle et la muscade , plus que par-tout ailleurs. De toutes ies plantes
qui offrent à l’homme une substance nutritive, le sagoutier fournit ia
plus facile à extraire et la plus riche.
» Quand le temps de la recueiliir est arrivé, ce qu’on reconnoît en pratiquant
une ouverture dans le tronc de l’arbre, on coupe le sagoutier au
niveau du sol ; on le partage en tronçons de six ou sept pieds de long, que
l’on fend en deux dans ieur longueur ; alors on en extrait la moelle, qu’on
réduit aussitôt, avec un pilon de bambou, en une poudre pareille à la
sciure de bois. Pour séparer la farine pure, ou fécule, du son et des ffia-
mens, on délaie la poudre médullaire dans beaucoup d’eau, puis on passe
cette eau dans un crible ou tamis grossier, placé à l’une des extrémités du
baquet dans lequel la mixtion a été faite; on la transvide dans un second
vase, au fond duquel la farine se précipite ; et après deux ou trois autres
semblables manipulations, on peut en faire usage ( i ). Crue, et sans autre
préparation, elle se conserve pendant un mois ; si on veut la garder plus
long-temps, on en forme des galettes, qui se font cuire suivant la méthode
des Guébéens. »
( I ) Cra-wfurd a vance qu’ il n’est pas extraordinaire qu’un seul sagoutier produise 500 à
600 livres ( avoirdupois ) [ 2 26 à 2 7 2 kilogrammes ] de farine. ( Op. cit. t. I. )