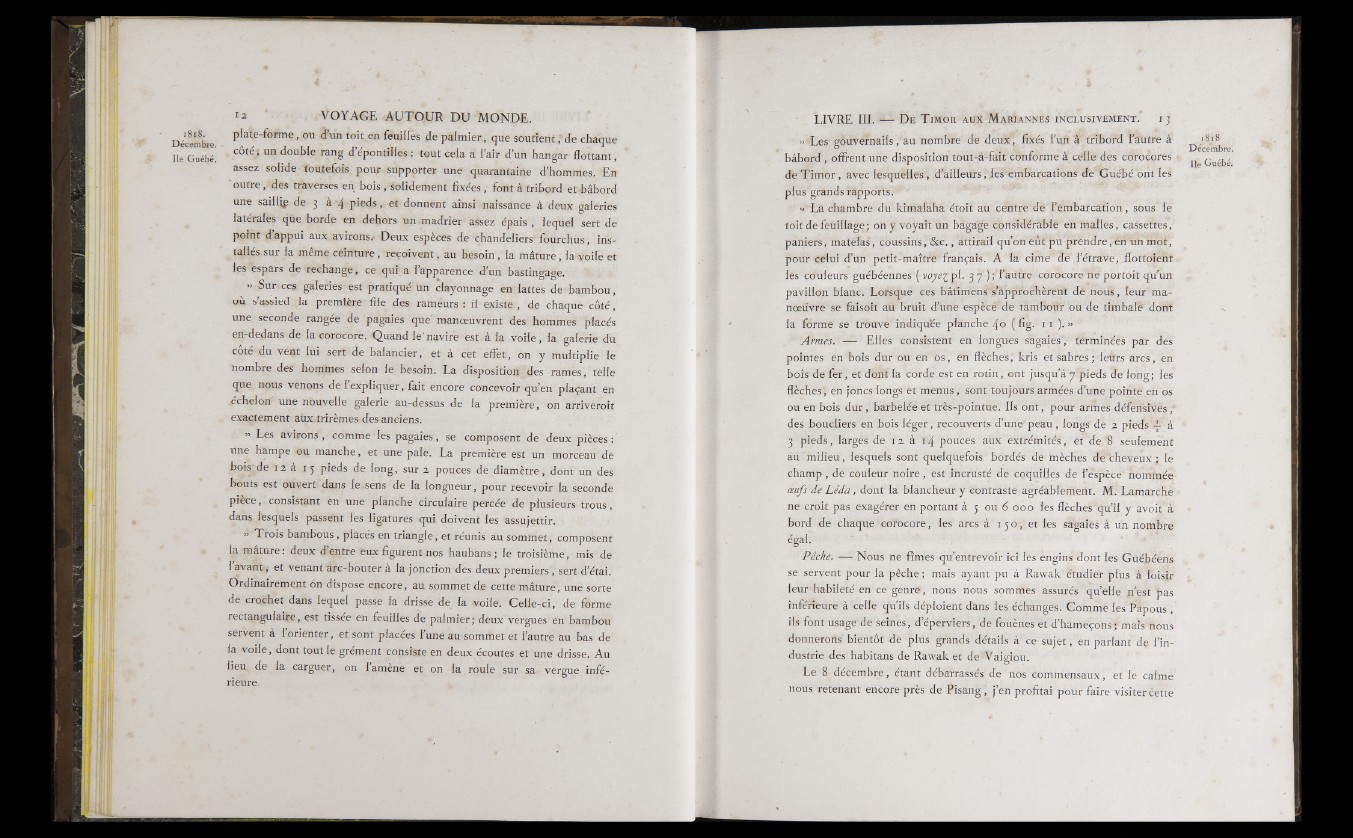
Décenibre , OU d’un toit en feuiiles de palmier, que soutient, de chaque
Ile Guébé ™ double rang dépontilies : tout cela a l’air d’un hangar flottant,
assez solide toutefois pour supporter une quarantaine d’hommes. En
outre , des traverses en bois , solidement fixées , font à tribord et bâbord
une saiilt^ de 3 à 4 pieds, et donnent ainsi naissance à deux galeries
latérales que borde en dehors un madrier assez épais , lequel sert de
point d’appui aux avirons. Deux espèces de chandeliers fourchus, installés
sur la même ceinture , reçoivent, au besoin , la mâture , la voile et
les espars de rechange, ce qui a l’apparence d’un bastingage.
^ « Sur ces galeries est pratiqué un clayonnage en lattes de bambou,
où s assied ia première file des rameurs : il existe , de chaque côté,
une seconde rangée de pagaies que manoeuvrent des hommes placés
en-dedans de la corocore. Quand le'navire est à la voile, la galerie du
côté du vent lui sert de balancier, et à cet effet, on y multiplie le
nombre des hommes selon ie besoin. La disposition des rames, telle
que nous venons de l’expliquer, fait encore concevoir qu’en plaçant en
échelon une nouvelle galerie au-dessus de la première, on arriveroit
exactement aux trirèmes des anciens.
» Les avirons , comme ies pagaies, se composent de deux pièces :
une hampe ou manche, et une pale. La première est un morceau de
bots de 12 à 15 pieds de long, sur 2 pouces de diamètre , dont un des
bouts est ouvert dans le sens de ia longueur, pour recevoir la seconde
pièce, consistant en une planche circuiaire percée de plusieurs trous,
dans iesquels passent les ligatures qui doivent les assujettir.
« Trois bambous , placés en triangle, et réunis au sommet, composent
la mâture: deux d’entre eux figurent nos haubans; le troisième, mis de
1 avant, et venant arc-bouter à la jonction des deux premiers , sert d’étai.
Ordinairement on dispose encore, au sommet de cette mâture, une sorte
de crochet dans lequel passe la drisse de la voile. Celle-ci, de forme
rectangulaire, est tissée en feuilles de palmier; deux vergues en bambou
servent à l’orienter, et sont placées l’une au sommet et l’autre au bas de
la voile, dont tout le grément consiste en deux écoutes et une drisse. Au
lieu de ia carguer, on i’amène et on la roule sur sa vergue inférieure.
» Les gouvernails, au nombre de deux, fixés l’un à tribord l’autre à
bâbord , offrent une disposition tout-à-fait conforme à celle des corocores
de Timor , avec lesquelles , d’ailieurs, ies embarcations de Guébé ont les
plus grands rapports.
» La chambre du kimaiaha étoit au centre de l’embarcation, sous le
toit de feuillage; on y voyait un bagage considérable en malles, cassettes,
paniers, matelas, coussins. Sic. , attirail qu’on eût pu prendre, en un mot,
pour celui d’un petit-maître français. A la cime de l’étrave, flottoient
les couleurs guébéennes ( voye^ pl. 37 ); l’autre corocore ne portoit qu’un
pavillon blanc. Lorsque ces bâtimens s’approchèrent de nous, leur manoeuvre
se faisoit au bruit d’une espèce de tambour ou de timbale dont
la forme se trouve indiquée planche 4o (fig. 1 1 ). >’
Armes. — Elles consistent en longues sagaies, terminées par des
pointes en bois dur ou en os, en flèches, kris et sabres ; leurs arcs, en
bois de fe r, et dont ia corde est en rotin, ont jusqu’à 7 pieds de long; ies
flèches, en joncs longs et menus , sont toujours armées d’une pointe en os
ou en bois dur , barbelée et très-pointue. Iis ont, pour armes défensives ,
des boucliers en bois léger, recouverts d’une peau , longs de 2 pieds y à
3 pieds, larges de 1 2 à 1 4 pouces aux extrémités, et de 8 seulement
au miiieu, lesquels sont quelquefois bordés de mèches de cheveux ; le
champ , de couleur noire , est incrusté de coquilles de i’espèce nommée
oeufs de Léda, dont la blancheur y contraste agréablement. M. Lamarche
ne croit pas exagérer en portant à 5 ou 6 000 les flèches qu’il y avoit à
bord de chaque corocore, les arcs à i 5 o , et ies sagaies à un nombre
égal.
Pêche. — Nous ne fîmes qu’entrevoir ici les engins dont les Guébéens
se servent pour la pêche ; mais ayant pu à Rawak étudier plus à loisir
leur habileté en ce genre, nous nous sommes assurés qu’elie n’est pas
inférieure à celle qii’iis déploient dans les échanges. Comme les Papous ,
ils font usage de seines, d’éperviers, de fouènes et d’hameçons; mais nous
donnerons bientôt de plus grands détails à ce sujet, en parlant de l’industrie
des habitans de Rawak et de Vaigiou.
Le 8 décembre, étant débarrassés de nos commensaux, et le calme
nous retenant encore près de Pisang, j’en profitai pour faire visiter cette
J le Guébé.