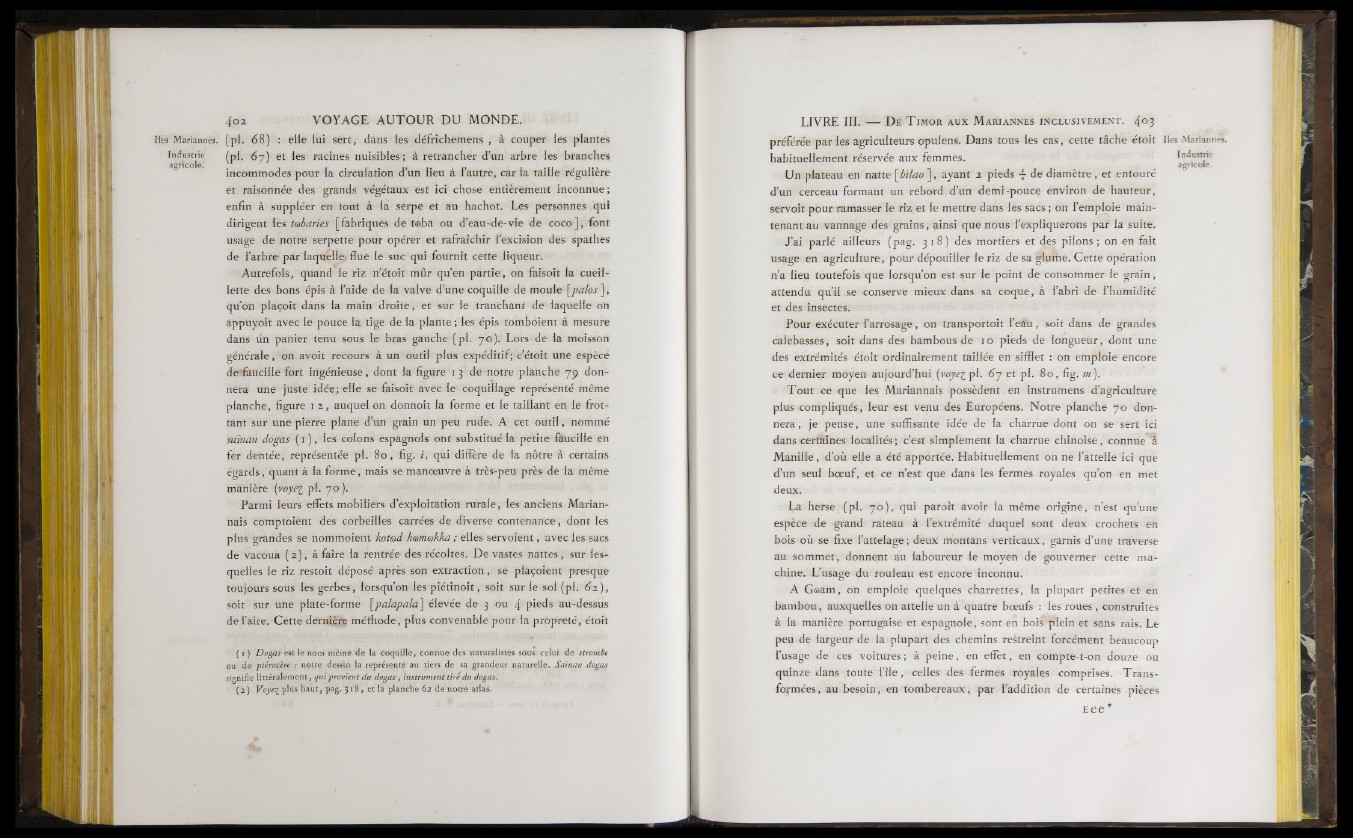
ü 'li
lie s Mariannes, (pl. 68) : elle lui sert, dans ies défrichemens , à couper les plantes
industrie
agricole .
(pl. 67) et les racines nuisibles; à retrancher d’un arbre ies branches
incommodes pour la circulation d’un lieu à l’autre, car la taille régulière
et raisonnée des grands végétaux est ici chose entièrement inconnue;
enfin à suppiéer en tout à la serpe et au hachot. Les personnes qui
dirigent les tabaries [fabriques de toba ou d’eau-de-vie de coco], font
usage de notre serpette pour opérer et rafraîchir l’excision des spathes
de i’arbre par laquelle flue ie suc qui fournit cette liqueur.
Autrefois, quand ie riz n’étoit mûr qu’en partie, on faisoit la cueillette
des bons épis à l’aide de la vaive d’une coquilie de moule [palos ],
qu’on plaçoit dans la main droite, et sur ie tranchant de laquelle on
appuyoit avec le pouce la tige de la plante ; les épis tomboient à mesure
dans un panier tenu sous le bras gauche (pl. 70). Lors de la moisson
générale, on avoit recours à un outil plus expéditif; c’étoit une espèce
de faucille fort ingénieuse, dont la figure i 3 de notre planche 79 donnera
une juste idée; elle se faisoit avec le coquillage représenté même
pianche, figure i 2 , auquel on donnoit la forme et le taillant en le frottant
sur une pierre plane d’un grain un peu rude. A cet outil, nommé
sdinan dogas ( i ), les colons espagnols ont substitué la petite faucille en
fer dentée, représentée pl. 80, fig. i, qui diffère de ia nôtre à certains
égards, quant à la forme, mais se manoeuvre à très-peu près de ia même
manière [voyez pl. 70).
Parmi leurs effets mobiliers d’exploitation rurale, ies anciens Mariannais
comptoient des corbeilles carrées de diverse contenance, dont ies
pius grandes se nommoient kotetd hamakka ; elles servoient, avec les sacs
de vacoua (2 ), à faire ia rentrée des récoltes. De vastes nattes , sur lesquelles
le riz restoit déposé après son extraction , se plaçoient presque
toujours sous les gerbes, lorsqu’on les piétinoit, soit sur le sol (pl. 62),
soit sur une plate-forme [palapala] élevée de 3 ou 4 pieds au-dessus
défaire. Cette dernière méthode, plus convenable pour la propreté, étoit
( I ) Dogas esL le nom même de la coq uille , connue des naturalistes sous celui de strombe
ou de ptêrocere : notre dessin la représente au tiers de sa grandeur naturelle. Sa'inan dogas
signifie littéralement, dogas , instrument tiré du dogas.
( 2 ) V o y t i plus haut, pag. 3 1 8 , et la planche 62 de notre atlas.
LIVRE III. — D e T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 4 ° 3
préférée paries agriculteurs opuiens. Dans tous les cas, cette tâche étoit lie s Mariannes.
habituellement réservée aux femmes. Industne
agricole.
Un plateau en natte [bilao ], ayant 2 pieds j- de diamètre, et entouré
d’un cerceau formant un rebord d’un demi-pouce environ de hauteur,
servoit pour ramasser le riz et le mettre dans les sacs ; on l’emploie maintenant
au vannage des grains, ainsi que nous l’expliquerons par la suite.
J ’ai parlé ailleurs (pag. 318) des mortiers et des pilons; on en fait
usage en agriculture, pour dépouiller ie riz de sa glume. Cette opération
n’a lieu toutefois que lorsqu’on est sur le point de consommer le grain,
attendu qu’ii se conserve mieux dans sa coque, à l’abri de i’humidité
et des insectes.
Pour exécuter l’arrosage, on transportoit l’eau, soit dans de grandes
calebasses, soit dans des bambous de 10 pieds de longueur, dont une
des extrémités étoit ordinairement taillée en sifflet : on emploie encore
ce dernier moyen aujourd’hui [voyez pi. 67 et pl. 80, fig. m).
Tout ce que les Mariannais possèdent en instrumens d’agriculture
plus compliqués, leur est venu des Européens. Notre pianche 70 donnera,
je pense, une suffisante idée de ia charrue dont on se sert ici
dans certaines localités; c’est simplement la charrue chinoise, connue à
Manille, d’où eile a été apportée. Habituellement on ne l’attelle ici que
d’un seul boeuf, et ce n’est que dans les fermes royales qu’on en met
deux.
La herse (pl. 70 ), qui paroît avoir ia même origine, n’est qu’une
espèce de grand rateau à l’extrémité duquei sont deux crochets en
bois où se fixe l’attelage ; deux montans verticaux, garnis d’une traverse
au sommet, donnent au laboureur le moyen de gouverner cette machine.
L’usage du rouleau est encore inconnu.
A Gfflam, on emploie quelques charrettes, la plupart petites et en
bambou, auxquelles on attelle un à quatre boeufs : les roues , construites
à la manière portugaise et espagnole, sont en bois plein et sans rais. Le
peu de largeur de la plupart des chemins restreint forcément beaucoup
l’usage de ces voitures; à peine, en effet, en compte-t-on douze ou
quinze dans toute i’îie, celles des fermes royales comprises. Transformées,
au besoin, en tombereaux, par l’addition de certaines pièces
E e e *