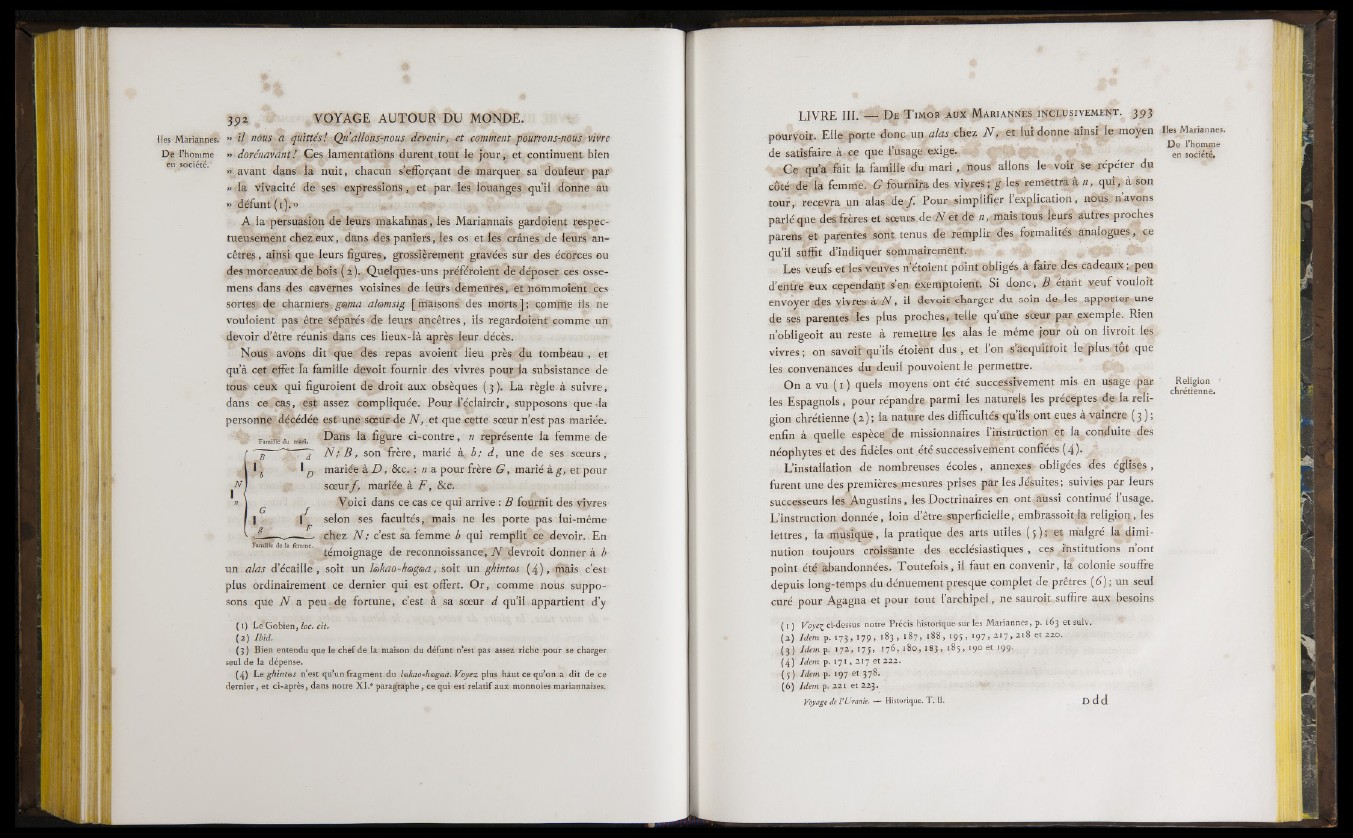
Iles Mariannes. ’> i l nous a q u it té s ! Qii allotis-nous d e v en ir , et comment pourrons-nous vivre
De l’homme
en société.
» d orénavant ! Ces lamentations durent tout le jour, et continuent bien
« avant dans ia nuit, chacun s’efforçant de marquer sa douleur par
*> ia vivacité de ses expressions , et par ies iouanges qu’il donne au
» défunt (i).’>
A la persuasion de ieurs makahnas, les Mariannais gardoient respectueusement
chez eux, dans des paniers, les os et les crânes de ieurs ancêtres
, ainsi que leurs figures, grossièrement gravées sur des écorces eu
des morceaux de bois {2). Quelques-uns préféroient de déposer ces ossemens
dans des cavernes voisines de leurs demeures, et nommoient ces
sortes de charniers g om a a lam s ig [maisons des morts]; comme ils ne
vouioient pas être séparés de ieurs ancêtres, iis regardoient comme un
devoir d’être réunis dans ces iieux-là après leur décès.
Nous avons dit que des repas avoient lieu près du tombeau , et
qu’à cet effet la famille devoit fournir des vivres pour la subsistance de
tous ceux qui figuroient de droit aux obsèques ( 3 ). La règle à suivre,
dans ce cas, est assez compliquée. Pour l’éclaircir, supposons que la
personne décédée est une soeur de M, et que cette soeur n’est pas mariée.
Dans la figure ci-contre, n représente la femme de
N ; B , son frère, marié à b; d, une de ses soeurs,
mariée à D , S ic . : n a pour frère G , marié k g , et pour
soeur f , mariée à F , Scc.
Voici dans ce cas ce qui arrive ; B fournit des vivres
selon ses facultés, mais ne les porte pas Iui-même
chez JV ; c’est sa femme b qui remplit ce devoir. En
témoignage de reconnoissance, N devroit donner à b
F am il ie d u m a ri.
N
I
I I
I
F am ille de ia femtr
un a la s d’écaille, soit un lo k a o -h a g a a , soit un ghintos (4 ), mais c’est
pius ordinairement ce dernier qui est offert. Or, comme nous supposons
que N a peu de fortune, c’est à sa soeur d qu’ii appartient d’y
{ i) Le Gobien, loc, cit.
( 2 ) Ibid .
(3) Bien entendu que le chef de la maison du défunt n’est pas assez riche pour se charger
seul de la dépense.
(4) Le ghintas n’est qu’un fragment du lakao-hagaa. Voyez plus haut ce qu’on a dit de ce
dernier, et ci-après, dans notre X L ' paragraphe, ce qui est relatif aux monnoies mariannaises.
De Thomme
en société.
R elig ion
chrétienne.
LIVRE III. — D e T im o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 393
pourvoir. Elle porte donc un alas chez N , et lui donne ainsi le moyen Ile s Marianne s
de satisfaire à ce que l’usage exige.
Ce qu’a fait la familie du mari , nous allons ie voir se répéter du
côté de la femme. G fournira des vivres; g les remettra à n, qui, à son
tour, recevra un aias de f. Pour simplifier i explication, nous n avons
parié que des frères et soeurs de Met de », mais tous leurs autres proches
parens et parentes sont tenus de remplir des formalités analogues, ce
qu’il suffit d’indiquer sommairement.
Les veufs et ies veuves n’étoient point obligés à faire des cadeaux ; peu
d’entre eux cependant s’en exemptoient. Si donc, B étant veuf vouioit
envoyer des vivres à M , ü devoit charger du soin de ies apporter une
de ses parentes les pius proches, telle qu’une soeur par exempie. Rien
n’obiigeoit au reste à remettre ies aias le même jour où on livroit les
vivres ; on savoit qu’ils étoient dus , et l’on s’acquittait le plus tôt que
ies convenances du deuil pouvoient le permettre.
On a vu ( I ) quels moyens ont été successivement mis en usage par
ies Espagnols, pour répandre parmi les naturels les préceptes de la religion
chrétienne (2) ; la nature des difficuités qu’ils ont eues à vaincre ( 3 ) ;
enfin à quelle espèce de missionnaires l’instruction et la conduite des
néophytes et des fidèles ont été successivement confiées (4).
L’instaiiation de nombreuses écoles, annexes obligées des égiises ,
furent une des premières mesures prises par les Jésuites; suivies par leurs
successeurs les Augustins, ies Doctrinaires en ont aussi continué l’usage.
L’instruction donnée , ioin d’être superficielle, embrassoit la religion , les
lettres, la musique, la pratique des arts utiles (5); et malgré la diminution
toujours croissante des ecclésiastiques , ces institutions n’ont
point été abandonnées. Toutefois, il faut en convenir, la colonie souffre
depuis long-temps du dénuement presque complet de prêtres (6) ; un seui
curé pour Agagna et pour tout l’archipel, ne sauroit suffire aux besoins
( I ) Voye i ci-dessus notre Précis historique sur les M arian ne s , p. 16 3 et suiv.
( 2 ) Idem p. 1 7 3 , 1 7 9 , 1 8 3 , 1 87 , 1 88, 195, 1 9 7 , 2 1 7 , 2 1 8 et 2 2 0 .
( 3 ) I d em f . 1 72, 1 75. >76, 180, 1 83 , 185, 19 0 et 199.
(4 ) Idem p. 1 7 1 , 2 ( 7 et 2 2 2 .
( 5 ) 7* m p. 19 7 et 378.
(6 ) Ide?n p. 2 2 1 et 2 2 3 .
Voyagt dt l'Uranie, — Historique. T . 11. D d d