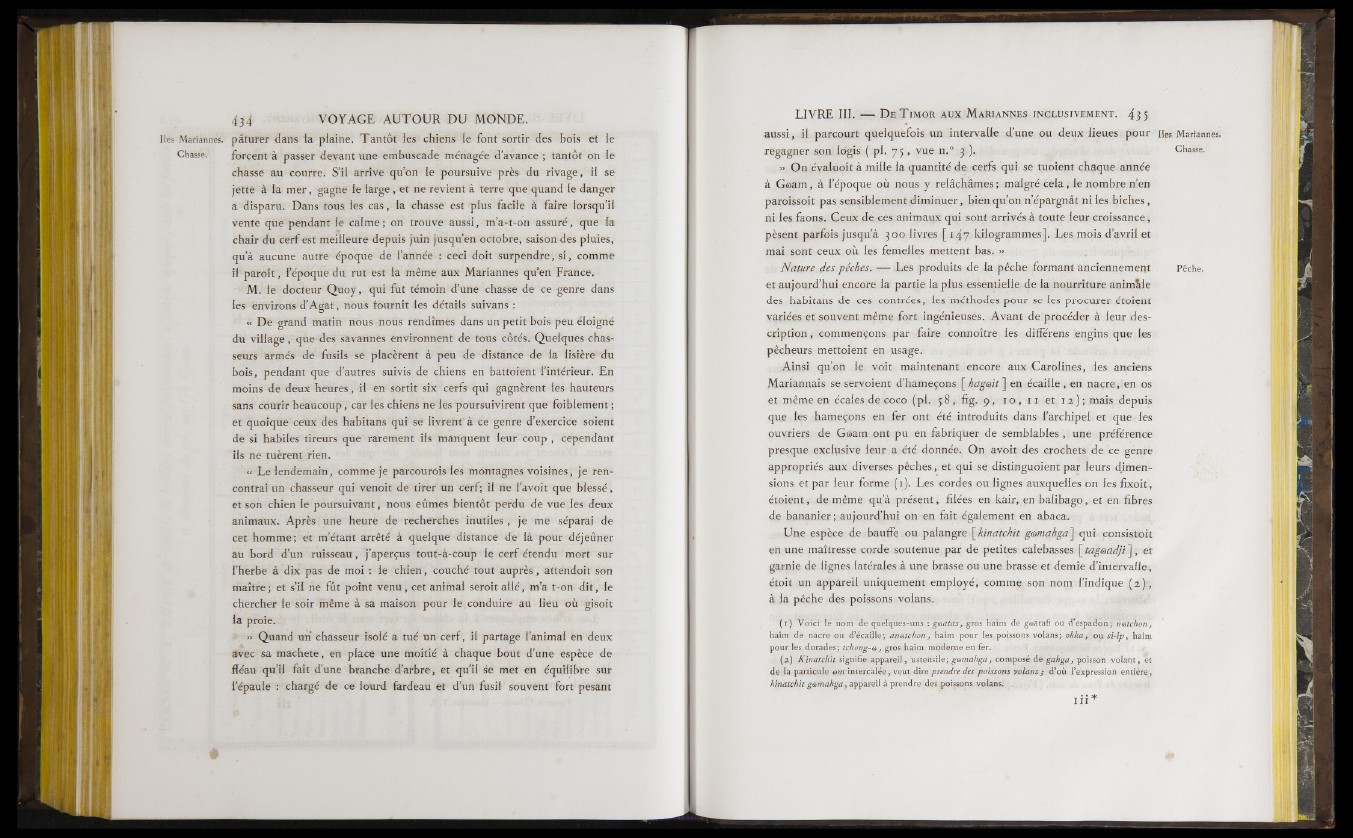
Ile s Mariannes. pâturer dans ia plaine. Tantôt les chiens le font sortir des hois et le
Chas:
forcent à passer devant une embuscade ménagée d’avance ; tantôt on le
chasse au courre. S’il arrive qu’on le poursuive près du rivage, il se
jette à la mer, gagne le large , et ne revient à terre que quand le danger
a disparu. Dans tous ies cas, la chasse est pius facile à faire lorsqu’il
vente que pendant le caime; on trouve aussi, m’a-t-on assuré, que la
chair du cerf est meilleure depuis juin jusqu’en octobre, saison des pluies,
qu’à aucune autre époque de l’année : ceci doit surpendre, s i, comme
il paroît, i’époque du rut est la même aux Mariannes qu’en France.
M. le docteur Quoy, qui fut témoin d’une chasse de ce genre dans
ies environs d’A gat, nous fournit les détails suivans :
« De grand matin nous nous rendîmes dans un petit bois peu éloigné
du village , que des savannes environnent de tous côtés. Quelques chasseurs
armés de fusils se placèrent à peu de distance de la lisière du
bois, pendant que d’autres suivis de chiens en battoient l’intérieur. En
moins de deux heures , il en sortit six cerfs qui gagnèrent les hauteurs
sans courir beaucoup , car les chiens ne les poursuivirent que foiblement ;
et quoique ceux des habitans qui se livrent à ce genre d’exercice soient
de si habiles tireurs que rarement ils manquent leur coup , cependant
ils ne tuèrent rien.
« Le lendemain, comme je parcourôis ies montagnes voisines, je rencontrai
un chasseur qui venoit de tirer un cerf; il ne l’avoit que blessé,
et son chien ie poursuivant, nous eûmes bientôt perdu de vue les deux
animaux. Après une heure de recherches inutiles , je me séparai de
cet homme; et m’étant arrêté à quelque distance de là pour déjeûner
au bord d’un ruisseau, j’aperçus tout-à-coup ie cerf étendu mort sur
l’herbe à dix pas de moi : le chien, couché tout auprès, attendoit son
maître; et s’il ne fût point venu, cet animal seroit allé, m’a t-on dit, le
chercher le soir même à sa maison pour le conduire au lieu où gisoit
la proie.
» Quand un chasseur isolé a tué un cerf, il partage l’animal en deux
avec sa machete, en piace une moitié à chaque bout d’une espèce de
fléau qu’il fait d’une branche d’arbre, et qu’il se met en équilibre sur
l’épaule ; chargé de ce lourd fardeau et d’un fusil souvent fort pesant
Chasse.
Pêche
LIVRE III. — De T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 43 5
aussi, il parcourt queiquefois un intervalle d’une ou deux lieues pour îles Mariannes,
regagner son logis ( pl. 75 , vue n.° 3 ).
» On évaluoit à mille la quantité de cerfs qui se tuoient chaque année
à Gaam, à l’époque où nous y relâchâmes ; malgré cela, le nombre n’en
paroissoit pas sensiblement diminuer, bien qu’on n’épargnât ni les biches,
ni les faons. Ceux de ces animaux qui sont arrivés à toute leur croissance,
pèsent parfois jusqu’à 300 livres [ i 4 y kilogrammes]. Les mois d’avril et
mai sont ceux où les femelles mettent bas. »
Nature des pêches. — Les produits de la pêche formant anciennement
et aujourd’hui encore la partie la plus essentielle de la nourriture animale
des habitans de ces contrées, les méthodes pour se les procurer étoient
variées et souvent même fort ingénieuses. Avant de procéder à leur description
, commençons par faire connoître les différens engins que les
pêcheurs mettoient en usage.
Ainsi qu’on le voit maintenant encore aux Carolines, les anciens
Mariannais se servoient d’hameçons [ hageit ] en écaille , en nacre, en os
et même en écales de coco (pl. 58, fig. 9 , 10 , 1 1 et 1 2 ) ; mais depuis
que les hameçons en fer ont été introduits dans l’archipei et que les
ouvriers de Coam ont pu en fabriquer de semblables , une préférence
presque exclusive ieur a été donnée. On avoit des crochets de ce genre
appropriés aux diverses pêches, et qui se distinguoient par leurs dimensions
et par leur forme (i). Les cordes ou lignes auxquelles on les fixoit,
étoient, de même qu’à présent, filées en kair, en baiihago, et en fibres
de bananier ; aujourd’hui on en fait également en abaca.
Une espèce de bauffe ou palangre [kinatchit gamahga] qui consistoit
en une maîtresse corde soutenue par de petites calebasses [ tagaadji ] , et
garnie de lignes latérales à une brasse ou une brasse et demie d’intervalle,
étoit un appareil uniquement employé, comme son nom l’indique (2 ) ,
à la pêche des poissons volans.
( 1 ) V o ic i le nom de quelques-uns ; gQatas, gros haim de goataft ou d’e sp ad on; natchon,
haim de nacre ou d’é c a ille ; an aîch on , haim pour les poissons vo lan s ; okk a, ou si~ip ^ haim
pour les dorades; tcIiong-Q, gros haim moderne en fer.
(2 ) Kin a tch it signifie ap p a re il, ustensile; gtamahga, composé de g a h g a , poisson v o la n t , et
de la particule om in te rca lé e , veut dire prendre des poissons volans ; d’où l’expression entière ,
kinatchit gmnahga, appareil à prendre des poissons volans.
l i i^