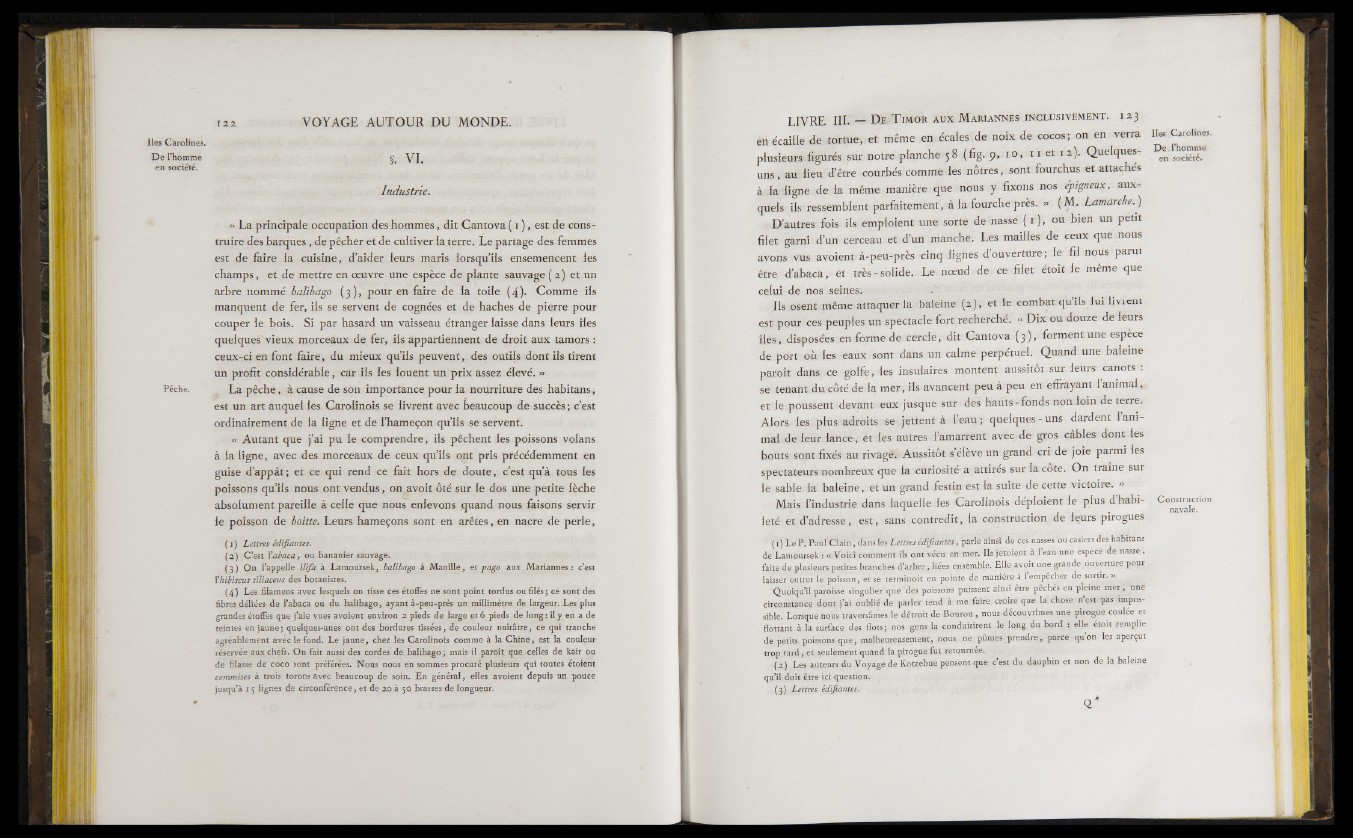
D e Thomme
en société.
Pêche.
§. V I .
Industrie.
« La principale occupation des hommes, dit Cantova ( i ), est de construire
des barques , de pêcher et de cultiver la terre. Le partage des femmes
est de faire ia cuisine, d’aider leurs maris iorsqu’ils ensemencent les
champs, et de mettre en oeuvre une espèce de plante sauvage (2) et un
arbre nommé baUbago (3 ), pour en faire de la toile (4 ). Comme ils
manquent de fer, ils se servent de cognées et de haches de pierre pour
couper le bois. Si par hasard un vaisseau étranger laisse dans ieurs îies
quelques vieux morceaux de fer, ils appartiennent de droit aux tamors ;
ceux-ci en font faire, du mieux qu’iis peuvent, des outils dont ils tirent
un profit considérable, car ils ies louent un prix assez élevé. »
La pêche, à cause de son importance pour la nourriture des habitans,
est un art auquel les Carolinois se livrent avec beaucoup de succès ; c’est
ordinairement de la ligne et de l’hameçon qu’iis se servent.
« Autant que j’ai pu ie comprendre, iis pèchent les poissons volans
à la ligne, avec des morceaux de ceux qu’ils ont pris précédemment en
guise d’appât; et ce qui rend ce fait hors de doute, c’est qu’à tous les
poissons qu’ils nous ont vendus, on avoit ôté sur le dos une petite lèche
absolument pareille à celle que nous enlevons quand nous faisons servir
le poisson de boitte. Leurs hameçons sont en arêtes, en nacre de perle,
( I ) Lettres édifiantes.
( 2 ) C ’est Xabaca, ou bananier sauvage.
( 3 ) On l’appelle ilifa à Lamoursek , baiihago à M an ille , et pago aux M a r ian n e s : c’est
l’hibiscus tiliaceus des botanistes.
(4 ) L es filamens a v e c lesquels on tisse ces étoffes ne sont point tordus ou filé s ; ce sont des
fibres déliées de l’aba ca ou du balifaago, ayant à-peu-près un millimètre de largeur. L es plus
grandes étoffes que j’aie vues avoient environ 2 pieds de large et 6 pieds de lo n g ; il y en a de
teintes en jau n e ; quelques-unes ont des bordures tissées, de couleur noirâtre, ce qui tranche
agréablement avec le fond. L e jau n e , chez les C a rolinois comme à la C h in e , est la couleur
réservée aux chefs. On fait aussi des cordes de b a lib a g o ; mais il paroît que celles de kair ou
de filasse de coco sont préférées. Nous nous en sommes procuré plusieurs qui toutes étoient
commises à trois torons avec beaucoup de soin. E n g én é ra l, elles avoient depuis un pouce
jusqu’à 1 5 lignes de circonférenc e, et de 20 à 50 brasses de longueur.
LIVRE III. — De T i m o r a u x M a r i a n n e s i n c l u s i v e m e n t . 12 3
en écailie de tortue, et même en écaies de noix de cocos; on en verra
plusieurs figurés sur notre planche 58 (fig. 9, 1 0 , 1 1 et 1 2 ) . Quelques-
uns, au iieu d’être courbés comme ies nôtres, sont fourchus et attachés
à la ligne de la même manière que nous y fixons nos e'pigneux, auxquels
ils ressemblent parfaitement, à la fourche près. » ( M . Lamarche.)
D’autres fois iis emploient une sorte de nasse ( i ), ou bien un petit
filet garni d’un cerceau et d’un manche. Les mailles de ceux que nous
avons vus avoient à-peu-près cinq lignes d’ouverture; ie fil nous parut
être d’abaca, et très-solide. Le noeud de ce filet étoit ie même que
celui de nos seines.
Iis osent même attaquer la baleine (2), et le combat quils lui livrent
est pour ces peuples un spectacle fort recherché. « Dix ou douze de ieurs
îles, disposées en forme de cercle, dit Cantova (3 ), forment une espèce
de port où ies eaux sont dans un caime perpétuel. Quand une baleine
paroît dans ce golfe, les insulaires montent aussitôt sur leuis canots .
se tenant du côté de ia mer, iis avancent peu à peu en effrayant i’animal,
et ie poussent devant eux jusque sur des hauts-fonds non ioin de tene.
Alors les pius adroits se jettent à i’eau ; quelques - uns dardent i’ani-
mai de ieur iance, et les autres l’amarrent avec de gros câbles dont les
bouts sont fixés au rivage. Aussitôt s’élève un grand cri de joie parmi les
spectateurs nombreux que ia curiosité a attirés sur ia cote. On traîne sur
le sable la baleine, et un grand festin est la suite de cette victoire.
Mais l’industrie dans laquelle les Carolinois déploient le plus d habileté
et d’adresse, est, sans contredit, la construction de leurs pirogues
( r ) L e P. P au l C la in , dans les Lettres édifiantes, parle ainsi de ces nasses ou casiers des habitans
de Lamoursek : « V o ic i comment ils ont vécu en mer. Ils jetoient à I eau une espèce de nasse ,
faite de plusieurs petites branches d’a rb re , liées ensemble. E lle avoit une grande ouve rtuie poui
laisser entrer le poisson, et se terminoit en pointe de manière à 1 empêcher de sortir. «
Quoiqu’il paroisse singulier que des poissons puissent ainsi être pêches en pleine m e r , une
circonstance dont j’ai oublié de parler tend à me faire croire que la chose n est pas impossible.
Lorsque nous traversâmes le détroit de Bourou , nous découvrîmes une pirogue coulée et
flottant à la surface des flots; nos gens la conduisirent le long du bord : elle étoit remplie
de petits poissons q u e , malheureusement, nous ne pûmes p ren d re , parce qu’on les aperçut
trop Ta r d, et seulement quand la pirogue fut retournée.
( 2 ) Les auteurs du V o y a g e de Kotzebue pensent que c’est du dauphin et non de la baleine
qu’ il doit être ici question.
{3 ) Lettres édifiantes.
Q"
ll&s Caroline s.
D e l’homme
en société.
C onstruction
navale.