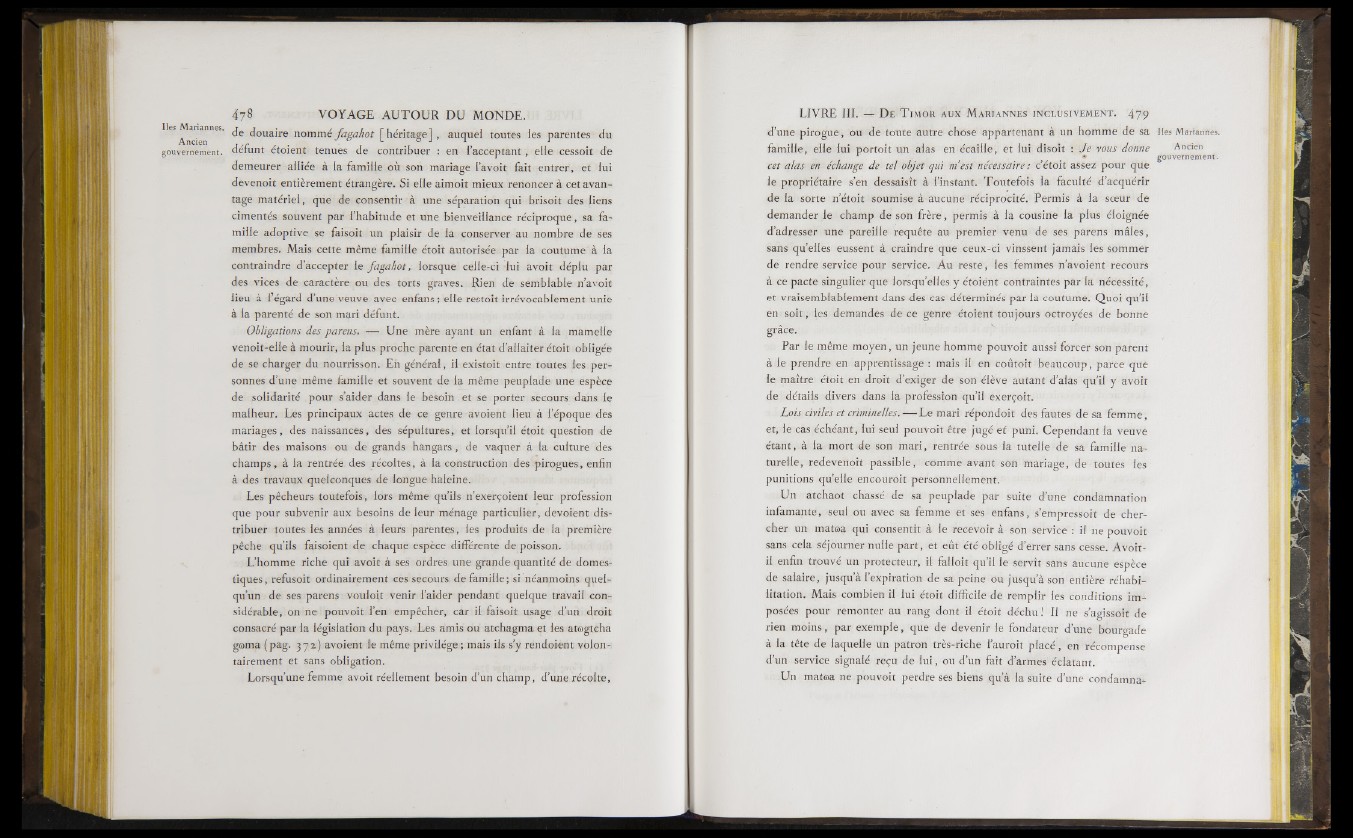
Ancien
gouvernement.
de douaire nomméfagahot [héritage], auquel toutes les parentes du
défunt étoient tenues de contribuer : en l’acceptant , elle cessoit de
demeurer alliée à la famille où son mariage l’avoit fait entrer, et lui
devenoit entièrement étrangère. Si elle aimoit mieux renoncer à cet avantage
matériel, que de consentir à une séparation qui brisoit des iiens
cimentés souvent par l’habitude et une bienveillance réciproque, sa famille
adoptive se faisoit un plaisir de la conserver au nombre de ses
membres. Mais cette même famille étoit autorisée par la coutume à la
contraindre d’accepter le fagahot, iorsque celle-ci lui avoit déplu par
des vices de caractère ou des torts graves. Rien de semblable n’avoit
lieu à l’égard d’une veuve avec enfans ; elle restoit irrévocablement unie
à ia parenté de son mari défunt.
Obligations des parens, — Une mère ayant un enfant à la mamelle
venoit-elle à mourir, la plus proche parente en état d’allaiter étoit obligée
de se charger du nourrisson. En général, il existoit entre toutes les personnes
d’une même famille et souvent de la même peuplade une espèce
de solidarité pour s’aider dans le besoin et se porter secours dans ie
malheur. Les principaux actes de ce genre avoient lieu à l’époque des
mariages, des naissances, des sépultures, et lorsqu’il étoit question de
bâtir des maisons ou de grands hangars , de vaquer à la culture des
champs, à la rentrée des récoltes, à la construction des pirogues, enfin
à des travaux quelconques de longue haleine.
Les pêcheurs toutefois, lors même qu’ils n’exerçoient leur profession
que pour subvenir aux besoins de leur ménage particulier, devoient distribuer
toutes les années à leurs parentes, les produits de la première
pêclie qu’ils faisoient de chaque espèce différente de poisson.
L ’homme riche qui avoit à ses ordres une grande quantité de domestiques,
refusoit ordinairement ces secours de famille; si néanmoins quelqu’un
de ses parens vouloit venir l’aider pendant quelque travail considérable,
on ne pouvoit l’en empêcher, car ii faisoit usage d’un droit
consacré par la législation du pays. Les amis ou atchagma et les atogtcha
goma (pag. 3 7 2 ) avoient le même privilège ; mais ils s’y rendoient volontairement
et sans obligation.
Lorsqu’une femme avoit réellement besoin d’un champ, d’une récolte,
Ancien
g o u v e rnem en t.
LIVRE III. — D e T imor aux M ariannes inclus ivement. 4 79
d’une pirogue, ou de toute autre chose appartenant à un homme de sa lies Mariannes,
famille, elle lui portoit un aias en écaille, et lui disoit : Je vous donne
cet alas en échange de tel objet qui m’est nécessaire : c’étoit assez pour que
le propriétaire s’en dessaisît à l’instant. Toutefois la facuité d’acquérir
de la sorte n’étoit soumise à aucune réciprocité. Permis à la soeur de
demander le champ de son frère, permis à ia cousine la plus éloignée
d’adresser une pareille requête au premier venu de ses parens mâles,
sans qu’elles eussent à craindre que ceux-ci vinssent jamais les sommer
de rendre service pour service. Au reste, les femmes n’avoient recours
à ce pacte singulier que lorsqu’elles y étoient contraintes par la nécessité,
et vraisemblablement dans des cas déterminés par la coutume. Quoi qu’il
en soit, les demandes de ce genre étoient toujours octroyées de bonne
grâce.
Par le même moyen, un jeune homme pouvoit aussi forcer son parent
à le prendre en apprentissage : mais il en coûtoit beaucoup, parce que
le maître étoit en droit d’exiger de son élève autant d’alas qu'il y avoir
de détails divers dans la profession qu’il exerçoit.
Lois civiles et criminelles. — Le mari répondoit des fautes de sa femme,
et, ie cas échéant, lui seui pouvoit être jugé ef puni. Cependant la veuve
étant, à la mort de son mari, rentrée sous la tutelle de sa famille naturelle,
redevenoit passible, comme avant son mariage, de toutes ies
punitions qu’elle encouroit personnellement.
Un atchaot chassé de sa peupiade par suite d’une condamnation
infamante, seul ou avec sa femme et ses enfans, s’empressoit de chercher
un inatffla qui consentît à le recevoir à son service : il ne pouvoit
sans ceia séjourner nulle part, et eût été obligé d’errer sans cesse. Avoit-
il enfin trouvé un protecteur, il falloit qu’il le servît sans aucune espèce
de salaire, jusqu’à l’expiration de sa peine ou jusqu’à son entière réhabilitation.
Mais combien il lui étoit difficile de remplir ies conditions imposées
pour remonter au rang dont il étoit déchu ! Il ne s’agissoit de
rien moins, par exemple, que de devenir le fondateur d’une bourgade
à la tête de laquelle un patron très-riche l’auroit placé , en récompense
d’un service signalé reçu de lu i, ou d’un fait d’armes éclatant.
Un matoa ne pouvoit perdre ses biens qu’à la suite d’une condamna