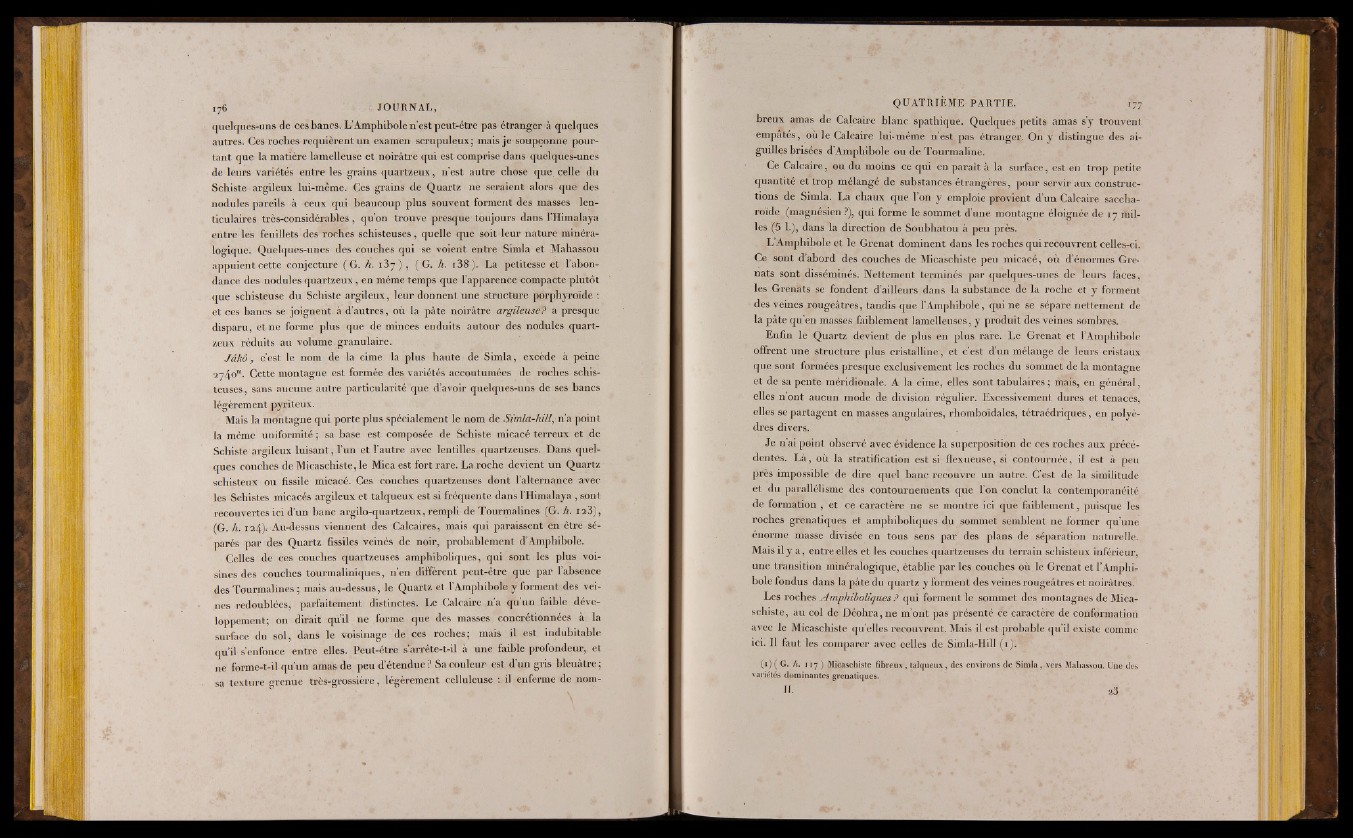
quelques-uns de ces bancs. L ’Amphibole n’est peut-être pas étranger à quelques
autres. Ces roches requièrent un examen scrupuleux ; mais je soupçonne pourtant
que la matière lamelleuse et noirâtre qui est comprise dans quelques-unes
de leurs variétés entre les grains quartzeux, n’est autre chose que celle du
Schiste argileux lui-même. Ces grains de Quartz ne seraient alors que des
nodules pareils à ceux qui beaucoup plus souvent forment des masses lenticulaires
très-considérables , qu’on trouve presque toujours dans l’Himalaya
entre les feuillets des roches schisteuses, quelle que soit leur nature minéra-
logique. Quelques-unes des couches qui se voient entre Simla et Mahassou
appuient cette conjecture (G. h. 13y ) , ( G. h. i 3 8 ). La petitesse et l’abondance
des.nodules quartzeux , en même temps que l’apparence compacte plutôt
que schisteuse du Schiste argileux, leur donnent une structure pôrphyroïde :
et ces bancs se joignent à d’autres, où la pâte noirâtre argileuse? a presque
disparu, et ne forme plus que de minces enduits autour des nodules quartzeux
réduits au volume granulaire.
Jâkô, c’est le nom de la cime la plus haute de Simla, excède à peine
2740” . Cette montagne est formée des variétés accoutumées de roches schisteuses,
sans aucune autre particularité que d’avoir quelques-uns de: ses bancs
légèrement pyriteux.
Mais la montagne qui porte plus spécialement le nom dé Simla-hilL n'a point
la même uniformité sa base est composée de Schiste micacé terreux et de
Schiste argileux luisant, l’un et l ’autre avec lentilles quartzeuses. Dans quelques
couches de Micaschiste, le Mica est fort rare. La roche devient un Quartz
schisteux ou fissile micacé. Ces couches quartzeuses dont l’alternance avec
les Schistes micacés argileux et talqueux est si fréquente dans l’Himalaya , sont
recouvertes ici d’un banc argilo-quartzeux, rempli de Tourmalines (G. h. 123),.
(G.h. 124).-¡Au-dessus viennent des Calcaires, mais qui paraissent en être séparés
par des Quartz fissiles veinés de noir, probablement d’Amphibole.
Celles de ces couches quartzeuses amphiboliques, qui sont les plus voisines
des couches tourmaliniques, n’en diffèrent peut-être que par l’absence
des Tourmalines ; mais au-dessus, le Quartz et l’Amphibole y forment des veines
redoublées, parfaitement distinctes. Le Calcaire,n’a qu’un faible développement;
on dirait qu’il ne forme que des masses concrétionnées à; la
surface du sol, dans le voisinage de ces roches; mais il est indubitable
qu’il s’enfonce entre elles. Peut-être s’arrête-t-il à une faible profondeur, et
ne forme-t-il qu’un amas de peu d’étendue ? Sa couleur est d’un gris bleuâtre ;
sa texture grenue très-grossière, légèrement celluleuse : il enferme de nombreux
amas de Calcaire blanc spathique. Quelques petits amas s’y trouvent
empâtes, ou le Calcaire lui-même n’est pas étrangey. On y distingue des aiguilles
brisées d’Amphibole ou de Tourmaline.
Ce Calcaire, ou du moins ce qui en paraît à la surface, est en trop petite
quantité et trop mélangé de substances étrangères, pour servir aux constructions
de Simla. La chaux que l’on y emploie provient d’un Calcaire saccha-
roïde (magnésien ?), qui forme le sommet d’une montagne éloignée de 17 milles
(5 1.), dans la direction de Soubhatou à peu près.
L’Amphibole et le Grenat dominent dans les roches qui recouvrent celles-ci.
Ce sont d’abord des couches de Micaschiste peu micacé, où d’énormes Grenats
sont disséminés. Nettement terminés par quelques-unes de leurs faces,
les Grenats se fondent d’ailleurs dans la substance de la roche et y forment
des veines rougeâtres, tandis que l’Amphibole, qui ne se sépare nettement de
la pâte qu’en masses faiblement lamelleuses, y produit des veines sombres.
Enfin le Quartz devient de plus en plus rare. Le Grenat et l’Amphibole
offrent une structure plus cristalline:, et c’est d’un mélange de leurs cristaux
que sont formées presque exclusivement les roches du sommet de la montagne
et de sa pente méridionale. A la cime, elles sont tabulaires ; maïs, en général,
elles n’ont aucun mode de division régulier. Excessivement dures et tenaces,
elles se partagent en masses angulaires, rhomboïdales, tétraédriques, en polyèdres
divers.
Je n’ai point observé avec évidence la superposition de ces roches aux précédentes.
L à , où la stratification est si flexueuse, si contournée, il èst à peu
près impossible de dire quel banc recouvre un autre. C’est de la similitude
et du parallélisme des contournements que l’on conclut la contemporanéité
de formation , et ce caractère ne se montre ici que faiblement, puisque les
roches grenatiques et amphiboliques du sommet semblent ne former qu’une
énorme masse divisée en tous sens par des plans de séparation naturelle.
Mais il y a , entre elles et les couches quartzeuses du terrain schisteux inférieur,
une transition minéralogique, établie par les couches où le Grenat et l’Amphibole
foudus dans la pâte du quartz y forment des veines rougeâtres et noirâtres:
Les roches Amphiboliques ? qui forment le sommet des montagnes de Micaschiste,
au col de Déohra, ne m’ont pas présenté ce caractère de conformation
avec le Micaschiste qu elles recouvrent. Mais il est probable qu’il existe comme
ici. Il faut les comparer avec celles de Simla-Hill (i)'iW
(1) ( G. h. 1 17 ) Micaschiste fibreux, talqueux, des enyirons de Simla, vers Mahassou. Une des
variétés dominantes grenatiques.
II. i f