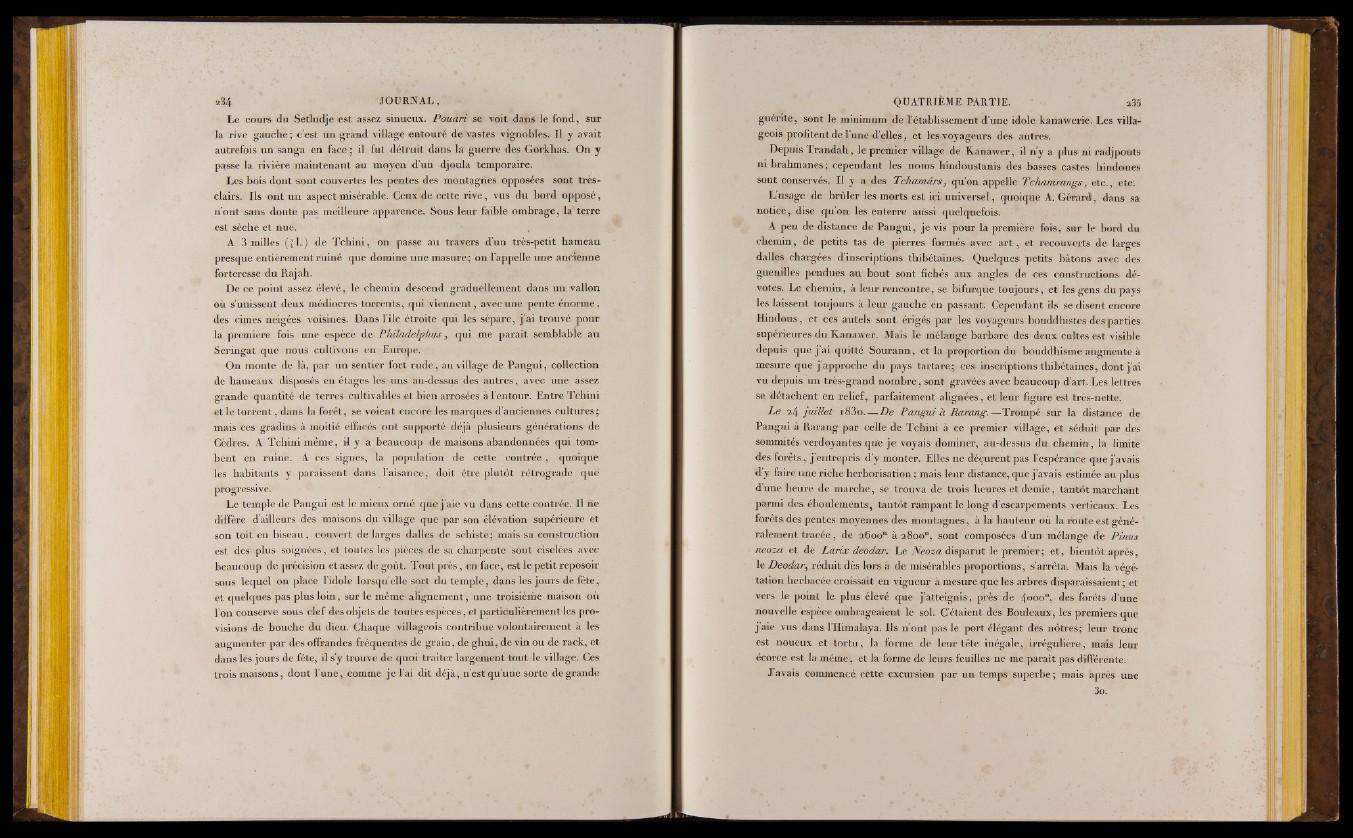
Le cours du Setludje est assez sinueux. Pouari se voit dans le fond, sur
la rive gauche ; c ’est un grand village entouré de vastes vignobles. Il y avait
autrefois un sanga en face ; il fut détruit dans la guerre des Gorkhas. On y
passe la rivière maintenant au moyen d ’un djoula temporaire.
Les bois dont sont couvertes les pentes des montagnes opposées sont très-
clairs. Ils ont un aspect misérable. Ceux de cette riv e , vus du bord opposé,
n’ont sans doute pas meilleure apparence. Sous leur faible ombrage, la terre
est sèche et nue. ,
A 3 milles ( f 1.) de Tchini, on passe au travers d’un très-petit hameau
presque entièrement ruiné que domine une masure; on l’appelle une ancienne
forteresse du Rajah.
De ce point assez élevé, le chemin descend graduellement dans un vallon
où s’unissent deux médiocres torrents, qui viennent, avec une pente énorme,
des cimes neigées voisines. Dans l’île étroite qui les sépare, j ’ai trouvé pour
la première fois une espèce de Philadelphus, qui me paraît semblable au
Seringat que nous cultivons en Europe.
On monte de là, par un sentier fort rude, au village de Pangui, collection
de hameaux disposés en étages les uns au-dessus des autres, avec une assez
grande quantité de terres cultivables et bien arrosées à l ’entour. Entre Tchini
et le torrent, dans la forêt, se voient encore les marques d’anciennes cultures;
mais ces gradins à moitié effacés ont supporté déjà plusieurs générations de
Cèdres. A Tchini même, il y a beaucoup de maisons abandonnées qui tombent
en ruine. A ces signes, la population de cette contrée , quoique
les habitants y paraissent dans l’aisance, doit être plutôt rétrograde que
progressive.
Le temple de Pangui est le mieux orné que j ’aie vu dans cette contrée. Il ne
diffère d’ailleurs des maisons dju village que par son élévation supérieure et
son toit en biseau, couvert de larges dalles de schiste; mais sa construction
est des plus soignées, et toutes les pièces de sa charpente sont ciselées avec
beaucoup de précision et assez de goût. Tout près, en face, est le petit reposoir
sous lequel on place l’idole lorsqu’elle sort du temple, dans les jours de fête,
et quelques pas plus loin, sur le même alignement, une troisième maison où
l’on conserve sous clef des objets de toutes espèces, et particulièrement les provisions
de bouche du dieu. Chaque villageois contribue volontairement à les
augmenter par des offrandes fréquentes de grain, de ghui, de vin ou de rack, et
dans les jours de fête, il s’y trouve de quoi traiter largement tout le village. Ces
trois maisons, dont l’une, comme je l’ai dit déjà, n’est qu’une sorte de grande
guérite, sont le minimum de l’établissement d’une idole kanawerie. Les villageois
profitent de l’une d’elles, et les voyageurs des autres.
Depuis Trandah,. le premier village de Kanawer, il n’y a plus ni radjpouts
ni brahmanes ; cependant les noms hindoustanis des basses castes hindoues
sont conservés. Il y a des Tchamârs} qu’on appelle Tchamrangs, etc., etc.
L ’usage de brûler les morts est ici universel, quoique A. Gérard, dans ,sa
notice ,, dise qu’on les, enterre aussi quelquefois.
A peu de distance de Pangui,. je vis pour la première fois, sur le bord du
chemin, de petits tas de pierres formés avec a r t , et recouverts de larges
dalles chargées d’inscriptions thibétaines. Quelques petits bâtons avec des
guenilles pendues au bout sont fichés aux angles de ces constructions dévotes..
Le chemin, à leur rencontre, se bifurque toujours, et les gens du pays
les laissent toujours à leur gauche en passant. Cependant ils se disent encore
Hindous, et ces autels sont érigés par les voyageurs bouddhistes des parties
supérieures du K.anawer. Mais le mélange barbare des deux cultes est visible
depuis que j ’ai quitté Sourann, et la proportion du bouddhisme augmente à
mesure que j ’approche du pays tartare ; ces inscriptions thibétaines, dont j ’ai
vu depuis un très-grand nombre , sont gravées avec beaucoup d’art. Les lettres
se détachent en relief, parfaitement alignées, et leur figure est très-nette.
Le 24 juillet i 83o .— De Pangui a Rarang. — Trompé sur la distance de
Pangui à Rarang par celle de Tchini à ce premier village, et séduit par des
sommités verdoyantes que je voyais dominer, au-dessus du chemin, la limite
des forets , j ’entrepris d’y monter. Elles ne déçurent pas l’espérance que j ’avais
d’y faire une riche herborisation ; mais leur distance, que j ’avais estimée au plus
d’une heure de marche, se trouva de trois heures et demie, tantôt marchant
parmi des ébouleménts, tantôt rampant le long d’escarpements verticaux. Les
forêts des pentes moyennes des montagnes , à la hauteur où la route est généralement
tracée , de 2600“ à 28oom, sont composées d’un mélange de Pinus
neoza et de Larix deodar. Le Neoza disparut le premier; e t, bientôt après,
le Deodar, réduit dès lors à de misérables proportions, s’arrêta. Mais la végétation
herbacée croissait en vigueur à mesure que les arbres disparaissaient ; et
vers le point lo p in s élevé que j ’atteignis, près de 4ooom, des forêts d’une
nouvelle espèce ombrageaient le sol. C’étaient dès Bouleaux , les premiers que
j ’aie vus dans l’Himalaya. Ils n’ont pas le port élégant des nôtres; leur tronc
est noueux et tortu, la forme de leur tête inégale, irrégulière, mais leur
écorce est la même , et la forme de leurs feuilles ne me paraît pas différente.
J’avais commencé cette excursion par un temps superbe ; mais après une
3o.