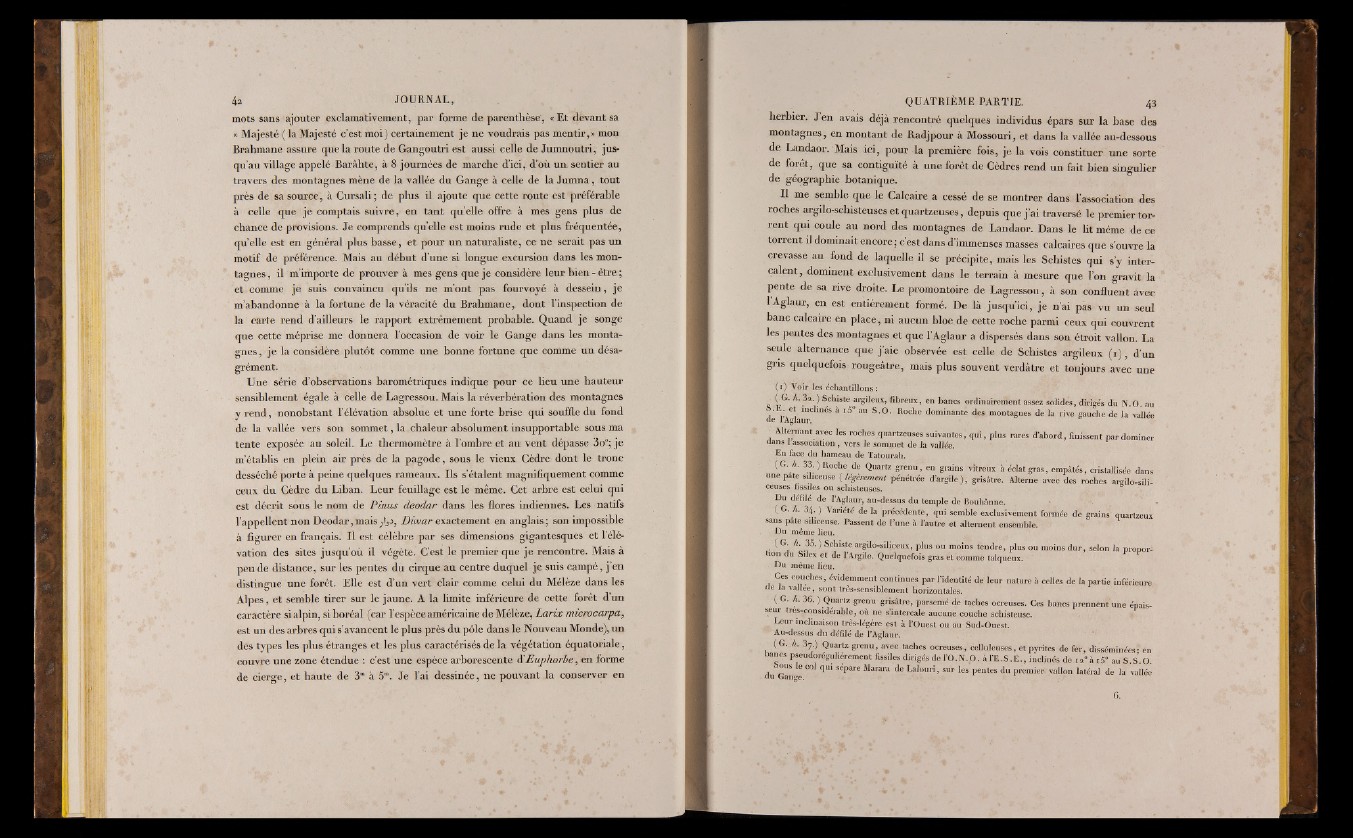
mots sans ajouter exclamativement, par forme de parenthèse, «Et devant sa
« Majesté ( la Majesté c’est moi) certainement je ne voudrais pas mentir,» mon
Brahmane assure que la route de Gangoutri est aussi celle de Jumnoutri, jusqu’au
village appelé Barâhte, à 8 journées de marche d’ici, d’où un. sentier au
travers des montagnes mène de la vallée du Gange à celle de la Jumna, tout
près de sa source, à Gursali; de plus il ajoute que cette route est préférable
à celle que je comptais suivre, en tant quelle offre à mes gens plus de
chance de provisions. Je comprends qu elle est moins rude et plus fréquentée,
qu’elle est en général plus basse , et pour un naturaliste, ce ne serait pas un
motif de préférence. Mais au début d’une si longue excursion dans les montagnes,
il m’importe de prouver à mes gens que je considère leur bien-être ;
et comme je suis convaincu qu’ils ne m’ont pas fourvoyé à dessein, je
m’abandonne à la fortune de la véracité du Brahmane, dont l’inspection de
la carte rend d’ailleurs le rapport extrêmement probable. Quand je songe
que cette méprise me donnera l’occasion de voir le Gange dans les montagnes
, je la considère plutôt comme une bonne fortune que comme un désagrément.
Une série d’observations barométriques indique pour ce lieu une hauteur
sensiblement égale à celle de Lagressou. Mais la réverbération des montagnes
y rend, nonobstant l’élévation absolue et une forte brise qui souffle du fond
de la vallée vers son sommet, la chaleur absolument insupportable sous ma
tente exposée au soleil. Le thermomètre à l’ombre et au vent dépasse 3o°; je
m’établis en plein air près de la pagode, sous le vieux Cèdre dont le tronc
desséché porte à peine quelques rameaux. Us s’étalent magnifiquement comme
ceux du Cèdre du Liban. Leur feuillage est le même. Cet arbre est celui qui
est décrit sous le nom de Pinus deodar dans les flores indiennes. Les natifs
l ’appellent non Deodar,m a i s Diwar exactement en anglais; son impossible
à figurer en français. I l est célèbre par ses dimensions gigantesques et l ’élévation
des sites jusqu’où il végète. C’est le premier que je rencontre. Mais à
peu de distance, sur les pentes du cirque au centre duquel je suis campé, j ’en
distingue une forêt. Elle est d’un vert clair comme celui du Mélèze dans les
Alpes, et semble tirer sur le jaune. A la limite inférieure de cette forêt d’un
caractère si alpin, si boréal (car l'espèce américaine de Mélèze, Larix microcarpa,
est un des arbres qui s’avancent le plus près du pôle dans le Nouveau Monde), un
des types les plus étranges et les plus caractérisés de la végétation équatoriale,
couvre une zone étendue : c’est une espèce arborescente d Euphorbe, en forme
de cierge, et haute de 3“ à 5m. Je l’ai dessinée, ne pouvant la conserver en
herbier. Jen avais déjà rencontré quelques individus épars sur la base des
montagnes, en montant de Radjpour à Mossouri, et dans la vallée au-dessous
de Landaor. Mais ic i, pour la première fois, je la vois constituer une sorte
de forêt, que sa contiguïté à une forêt de Cèdres rend un fait bien singulier
de géographie botanique.
Il me semble que le Calcaire a cessé de se montrer dans l’association des
roches argilo-schisteuses et quartzeuses, depuis que j ’ai traversé le premier tor-
rent qui coule au nord des montagnes de Landaor. Dans le lit même de ce
torrent il dominait encore; cest dans d’immenses masses calcaires que s’ouvre la
crevasse au fond de laquelle il se précipite, mais les Schistes qui s’y intercalent,
dominent exclusivement dans le terrain à mesure que l'on gravit la
pente de sa rive droite. Le promontoire de Lagressou, à son confluent avec
lAglaur, en est entièrement formé. De là jusqu’ici, je n’ai pas vu un seul
banc calcaire en place, ni aucun bloc de cette roche parmi ceux qui couvrent
les pentes des montagnes et que l’Aglaur a dispersés dans son étroit vallon. La
seule alternance que j ’aie observée est celle dé Schistes argileux (*)§ d’un
gris quelquefois rougeâtre, mais plus souvent verdâtre et toujours avec une
( rD Voir les échantillons:
„ ( ) Schiste argileux, fibreux, en bancs ordinairement assez solides, dirigés du N.O. au
. . et inclinés à i 5 au S .O . Roche dominante des montagnes de la rive gauche de la vallée
de lAglaur. -
. AIt«™ant avec les roches quartzeuses suivantes J qui, plus rares d’abord, finissent par dominer
dans 1 association , vers le sommet de la vallée.
En face du hameau de Tatourah.
(G. A. 33.) Roche de Quartz grenu, en grains vitreux à éclat gras, empâtés, cristallisée dans
une pâte sd.ceuse (légèrement pénétrée d’argiléj, grisâtre. Alterne avec des roches argilo-sili-
qeuses fissiles ou schisteuses.
Du défilé de l’Aglaur, au-dessus du temple de Bouhànne. * -
( G. A. 34. ) "Variété de la précédente, qui Semble exclusivement formée de grains quartzeux
sans paie siliceuse. Passent de l’une à l’autre et alternent ensemble.
Du même lieu.
( G; h- 35.) Schiste argilo-siliçeux, plus ou moins tendre, plus ou moins dur, selon la proportion
du Silex et de l’Argile. Quelquefois gras et comme talqueux.
Du même lieu.
1 C,6S c°u,ches’ évidemment continues par l’identité de leur nature à celles de la partie inférieure
de la vallee , sont très-sensiblement horizontales.
( G. A. 36. ) Quartz grenu grisâtre, parsemé de taches oçreuses. Ces bancs prennent une épais-
seui tres-considerable, où ne s’intercale aucune couche schisteuse.
Leur inclinaison très-légère est à l’Ouest ou au Sud-Ouest.
Au-dessus du défilé dp l’Àglàur.
( G. h. .37.) Quartz grenu, avec taches ocreuses, celluleuses, et pyrites de fer, disséminées- en
bancs pseudorégulièrement fissiles dirigés de l’O.N.O.. à l’R .S .È ., indinés de.i2°à r5° au S.S.O .
ous e col qui sépare Marara de Lalouri, sur les pentes du premier vallon latéral de la vallée
du Oange. -e. - . . > . ,