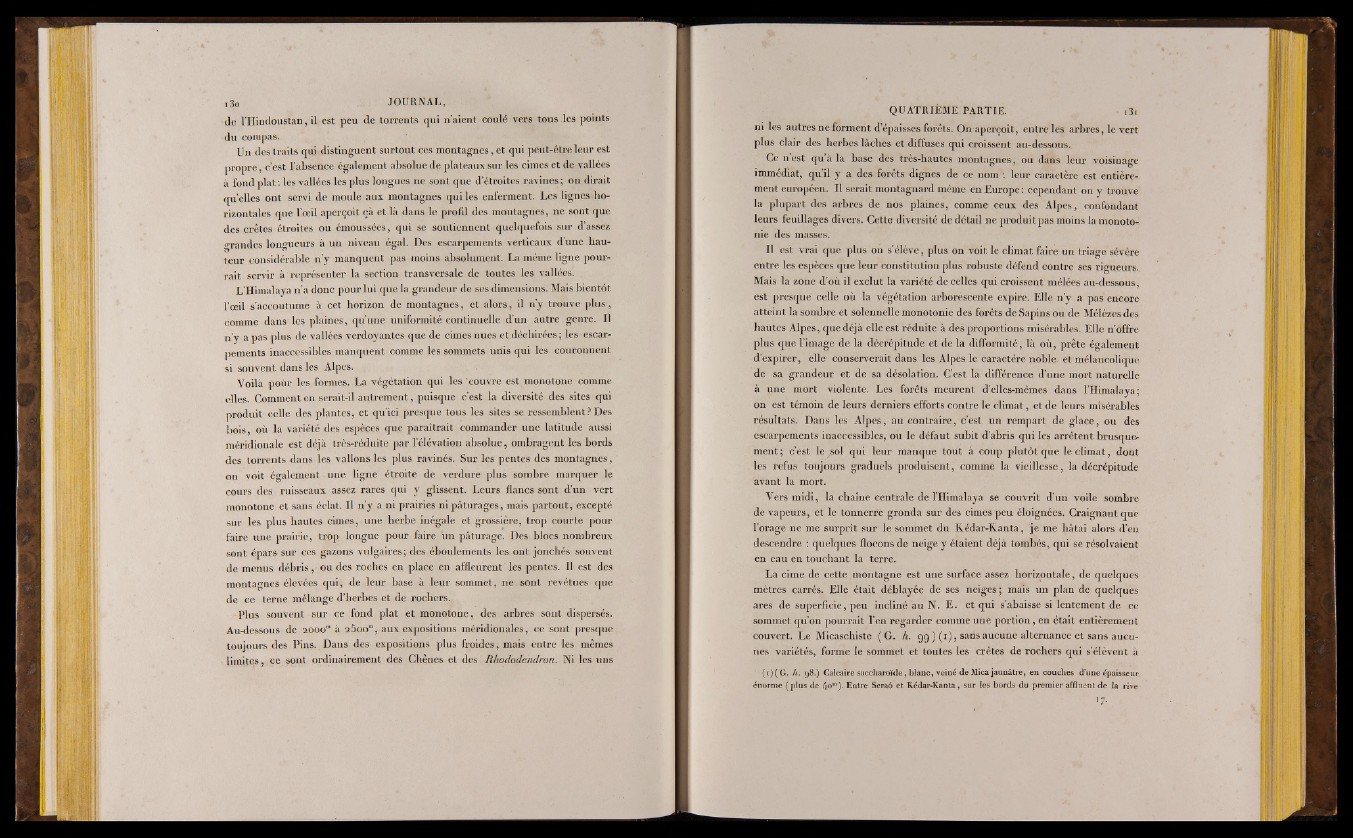
de l’IIindoustan, il est peu de torrents qui n’aient coulé vers tous les points
du compas.
Un des traits qui distinguent surtout ces montagnes, et qui peut-être leur est
propre, c’est l’absénce également absolue de platéaux sur les cimes et de vallées
à fond plat : les vallées les plus longues ne sont que d’étroites ravines ; on dirait
qu’elles ont servi de moule aux montagnes qui les enferment. Les lignes horizontales
que l’oeil aperçoit çà et là dans le profil des montagnes, ne sont que
des crêtes étroites ou émoussées, qui se soutiennent quelquefois sur d’assez
grandes longueurs à un niveau égal. Des escarpements verticaux d’une hauteur
considérable n’y manquent pas moins absolument. La même ligne pourrait
servir à représenter la section transversale de toutes les vallées.
L’Himalaya n’a donc pour lui que la grandeur de ses dimensions. Mais bientôt
l’oeil s'accoutume à cet horizon de montagnes, et alors., il n’y trouve plus.,
comme dans les plaines, qu’une uniformité continuelle d’un autre genre. Il
n’y a pas plus de vallées verdoyantes que de cimes nues et déchirées; les escarpements
inaccessibles manquent comme les sommets uüis qui les couronnent
si souvent dans les Alpes.
Voilà poùr les formes. La végétation qui les 'couvre est monotone comme
elles. Comment en serait-il autrement, puisque c’est la diversité des sites qui
produit celle des plantes, et qu’ici presque tous les sites se ressemblent ? Des
bôis, où la variété des espèces que paraîtrait commander une latitude aussi
méridionale est déjà très-réduite par l’élévation absolue, ombragent les bords
des torrents dans les vallons les plus ravinés. Sur les pentes des montagnes,
on voit également une ligne étroite de verdure plus sombre marquer le
cours des ruisseaux assez rares qui y glissent. Leurs flancs sont d’un vert
monotone et sans éclat. Il n’y a ni prairies ni pâturages, mais partout, excepté
sur les plus hautes cimes, une herbe inégale et grossière, trop courte pour
faire une prairie, trop longue pour faire un pâturage. Des blocs nombreux
sont épars sur ces gazons vulgaires; des éboulements les ont. jonchés, souvent
de menus débris , ' ou des roches en place en affleùrent les pentes. Il est des
montagnes élevées qui, de leur base à leur sommet, ne sont revêtues que
de ce terne mélange d’herbes et de rochers.
Plus souvent sur ce fond plat et monotone, des arbres sont dispersés.
Au-dessous de 2000" à 25oo", aux expositions méridionales, ce sont presque
toujours des Pins. Dans. des expositions plus froides, mais entre les mêmes
limites, ce sont ordinairement des Chênes et des Rhododendron. Ni les uns
ni les autres ne forment d’épaisses forêts. On aperçoit, entre les arbres, le vert
plus clair des herbes lâches et diffuses qui croissent au-dessous.
Ce n est qu a la base des très-hautes montagnes, ou dans leur voisinage
immédiat, qu’il y a des forêts dignes de ce nom : leur caractère est entièrement
européen. Il serait montagnard même en Europe : cependant on y trouve
la plupart des arbres de nos plaines, comme ceux des Alpes, confondant
leurs feuillages divers. Cette diversité de détail ne produit pas moins la monotonie
des masses.
Il est vrai que plus on s'élève, plus on voit le climat faire un triage sévère
entre les espèces que leur constitution plus robuste défehd contre ses rigueurs.
Mais la zone d’où il exclut la variété de celles qui croissent mêlées au-dessous,
est presque celle où la végétation arborescente expire. Elle n’y a pas encore
atteint la sombre et solennelle monotonie des forêts de Sapins ou de Mélèzes des
hautes Alpes, que déjà elle est réduite à des proportions misérables, Elle n’offre
plus que l’image de la décrépitude et de la difformité, là où, prête également
d’expirer, elle conserverait dans les Alpes,le caractère noble, et mélancolique
de sa grandeur et de sa désolation. C’est la différence d’une mort naturelle
à une mort violente. Les forêts meurent d’elles-mêmes dans l’Himalaya;
on est témoin de leurs derniers efforts contre le climat, et de leurs misérables
résultats. Dans les Alpes, au contraire, c’est un rempart de glace, ou des
escarpements inaccessibles, ou le défaut subit d’abris qui les arrêtent brusquement
; c’est le ,sol qui leur manque tout à coup plutôt que le climat, dont
les refus toujours graduels produisent, comme la vieillesse, la décrépitude
avant la mort.
Vers midi, la chaîne centrale de l’Himalaya se couvrit d’un voile sombre
de vapeurs, et le tonnerre gronda sur des cimes peu éloignées. Craignant que
l’orage ne me surprît sur le sommet du h édar-kant;i, je me hâtai alors d’en
descendre : quelques flocons de neige y étaient déjà tombés, qui se résolvaient
en eau en touchant la terre.
La cime de cette montagne est une surface assez horizontale, de quelques
mètres carrés. Elle était déblayée de ses neiges ; mais un plan de quelques
ares de superficie, peu incliné au N . E . et qui s’abaisse si lentement de ce
sommet qu’on pourrait l’en regarder comme une portion, en était entièrement
couvert. Le Micaschiste ( G. h. 99 ) (1), sans aucune alternance et sans aucunes
variétés, forme le sommet et toutes les crêtes de rochers qui s’élèvent à
(x)(G. h. 98.) Calcaire saccharoïde, blanc, veiné de Mica jaunâtre, en couches d’une épaisseur
énorme (plus de Yjo“ ). Entre Seraô et Kédar-Kanta, sur les bords du premier affluent de la rive