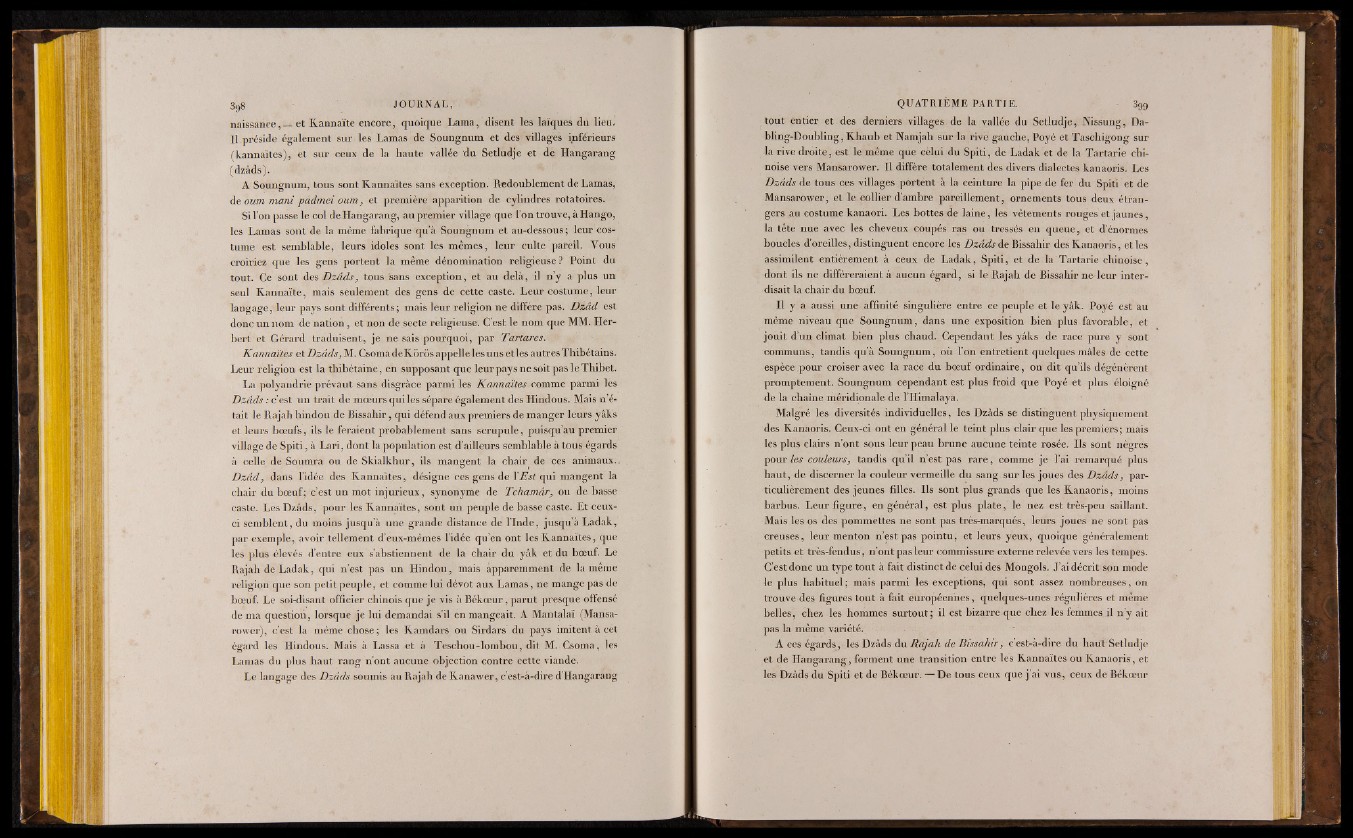
n a i s s a n c e e t Rannaïte encore, quoique Lama, disent les laïques du lieu.
Il préside également sur les Lamas de Soungnum et des villages inférieurs
f kannaïtes), et sur ceux de la haute vallée du Setludje et de Hangarang
(dzâds).
A Soungnum, tous sont Kannaïtes sans exception. Redoublement de Lamas,
de oum mani pâdmei oum, et première apparition de cylindres rotatoires.
Si l’on passe le col de Hangarang, au premier village que l’on trouve, à Hango,
les Lamas sont de la même fabrique qu’à Soungnum et au-dessous; leur costume
est semblable, leurs idoles sont les mêmes, leur culte pareil. Vous
croiriez que les gens portent la même dénomination religieuse ? Point du
tout. Ce sont des Dzâds, tous sans exception, et au delà, il n’y a plus un
seul Rannaïte, mais seulement des gens de cette caste. Leur costume, leur
langage, leur pays sont différents; mais leur religion ne diffère pas. Dzâd est
donc un nom de nation, et non de secte religieuse. C’est le nom que MM. Herbert
et Gérard traduisent, je ne sais pourquoi, par Tartares.
Kannaïtes et Dzâds, M. Csoma deRôros appelle les uns et les autres Thibétains.
Leur religion est la thibétaine, en supposant que leur pays ne soit pas le Thibet.
La polyandrie prévaut sans disgrâce parmi les Kannaïtes comme parmi les
Dzâds : c’est un trait de moeurs qui les sépare également des Hindous. Mais n’était
le Rajah hindou de Rissahir, qui défend aux premiers de manger leurs yaks
et leurs boeufs, ils le feraient probablement sans scrupule, puisqu’au premier
village de Spiti, à Lari, dont la population est d’ailleurs semblable à tous égards
à celle de Soumra ou de Skialkhur, ils mangent la chair de ces animaux.,
Dzâd, dans l’idée des Rannaïtes, désigne ces gens de Y Est qui mangent la
chair du boeuf; c’est un mot injurieux, synonyme de Tchamâr, ou de basse
caste. Les Dzâds, pour les Rannaïtes, sont un peuple de basse caste. Et ceux-
ci semblent, du moins jusqu’à une grande distance de l’Inde, jusqu’à Ladak,
par exemple, avoir tellement d’eux-mêmes l’idée qu’en ont les Rannaïtes, que
les plus élevés d’entre eux s’abstiennent de la chair du yâk et du boeuf. Le
Rajah de Ladak, qui n’est pas un Hindou, mais apparemment de la meme
religion que son petit peuple, et comme lui dévot aux Lamas, ne mange pas de
boeuf. Le soi-disant officier chinois que je vis à Békoeur, parut presque offensé
de ma question, lorsque je lui demandai s’il en mangeait. A Mantalaï (Mansa-
rower), c’est la même chose; les Ramdars ou Sirdars du pays imitent à cet
égard les Hindous. Mais à Lassa et à Teschou-lombou, dit M. Csoma, les
Lamas du plus .haut rang n’ont aucune objection contre cette viande.
Le langage des Dzâds soumis au Rajah de Ranawer, c’est-à-dire d’Hangarang
tout entier et des derniers villages de la vallée du Setludje, Nissung, Da-
bling-Doubling, Rhaub et Namjah sur la rive gauche, Poyé et Taschigong sur
la rive droite, est le même que cèlui du Spiti, de Ladak et de la Tartarie chinoise
vers Mansarower. Il diffère totalement des divers dialectes kanaoris Les
Dzâds de tous ces villages portent â la ceinture la pipe de fer du Spiti et de
Mansarower, et le collier d’ambre pareillement, ornements tous deux étrangers
au costume kanaori. Les bottes de laine, les vêtements rouges et jaunes,
la tête nue avec les cheveux coupés ras ou tressés en queue, et d’énormes
boucles d’oreilles, distinguent encore les Dzâds de Bissahir des Ranaoris, et les
assimilent entièrement à ceux de Ladak, Spiti, et de la Tartarie chinoise,
dont ils ne différeraient à aucun égard, si le Rajah de Bissahir ne^leur interdisait
la chair du boeuf.
Il y a aussi une affinité singulière entre ce peuple et le yâk. Poyé est au
même niveau que Soungnum, dans une exposition bien plus favorable, et
jouit d’un climat bien plus chaud. Cependant les yâks de race pure y sont
communs, tandis qu’à Soungnum, où l’on entretient quelques mâles de cette
espèce pour croiser avec la race du boeuf ordinaire, on dit qu’ils dégénèrent
promptement. Soungnum cependant est plus froid que Poyé et plus éloigné
de la chaîne méridionale de l’Himalaya.
Malgré les diversités individuelles, les Dzâds se distinguent physiquement
des Ranaoris. Ceux-ci ont en général le teint plus clair que les premiers; mais
les plus clairs n’ont sous leur peau brune aucune teinte rosée. Us sont nègres
pour les couleurs, tandis qu’il n’est pas ra re , comme je l’ai remarqué plus
haut, de discerner la couleur vermeille du sang sur les joues des Dzâds, particulièrement
des jeunes filles. Ils sont plus grands que les Ranaoris, moins
barbus. Leur figure, en général, est plus plate, le nez est très-peu saillant.
Mais les os des pommettes ne sont pas très-marqués, leurs joues ne sont pas
creuses, leur menton n’est pas pointu, et leurs yeux, quoique généralement
petits et très-fendus, n’ont pas leur commissure externe relevée vers les tempes.
C’est donc un type tout à fait distinct de celui des Mongols. J’ai décrit son mode
le plus habituel; mais parmi les exceptions, qui sont assez nombreuses, on
trouve des figures tout à fait européennes, quelques-unes régulières et même
belles, chez les hommes surtout; il est bizarre que chez les femmes il n’y ait
pas la même variété.
A ces égards, les Dzâds du Rajah de Bissahir, c’est-à-dire du haut Setludje
et de Hangarang, forment une transition entre les Rannaïtes © © > ou Ranaoris, et
les Dzâds du Spiti et de Békoeur. — De tous ceux que j ’ai vus, ceux de Békoeur