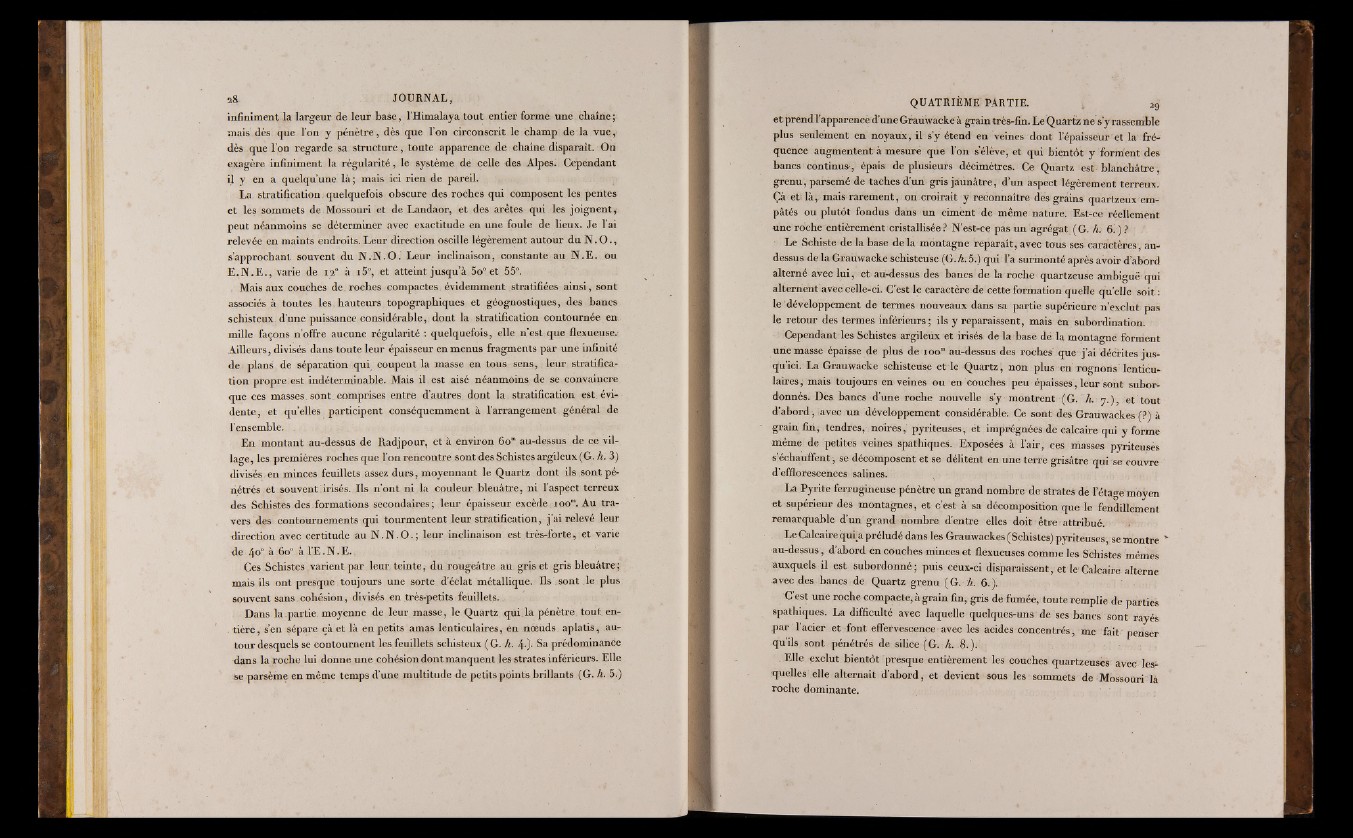
infiniment la largeur de leur base, l ’Himalaya tout entier forme une.chaîne;
mais dès que l’on y pénètre, dès que l’on circonscrit le champ de la vu e ,'
dès que l ’on regarde sa; structure, toute apparence de chaîne disparaît. On
exagère infiniment la régularité, le système de celle des Alpes.. Cependant
i) y en a quelqu’une là ; mais ici rien de pareil.
La stratification, quelquefois obscure des roches qui composent les pentes
et les sommets de. Mossouri et de Landaor, et des arêtes qui les joignent,
peut néanmoins se déterminer avec exactitude en une foule de lieux. Je l’ai
relevée en maints endroits. Leur direction oscille légèrement autour du N .O . ,
s’approchant souvent du N.-N.'O. Leur inclinaison, constante au N ,E . ou
E .N .E . , varie de 12“ à i 5°, et atteint jusqu’à 5o° et 55°.
Mais aux couches de. roches compactes, évidemment stratifiées ainsi, sont
associés à toutes les. hauteurs topographiques et géognostiques, des bancs
schisteux d’une puissance considérable,, dont la stratification contournée en
mille façons n’offre aucune régularité : quelquefois, elle n’est que flexueuse.
Ailleurs, divisés dans toute leur épaisseur en menus fragments par une infinité
de plans de séparation qui coupent la masse en tous sens, leur stratification
propre est indéterminable. Mais il est aisé néanmoins de se convaincre
que ces masses. sont comprises entre d’autres, dont la. stratification est. évidente,
et qu’elles participent conséquemment à l’arrangement général de
l ’ensemble. .
En montant au-dessus de Radjpour, et à environ 60“ au-dessus de ce village,
les premières roches que l’on rencontre sont des Schistes argileux (G. h. 3)
divisés en minces feuillets assez durs, moyennant le Quartz dont ils sont pénétrés,
et souvent misés. Ils n’ont ni la couleur bleuâtre, ni l’aspect terreux
des Schistes des formations secondaires ; leur épaisseur excède 100". Au travers
des contournements qui tourmentent leur stratification, j ’ai relevé leur
direction avec certitude au N .N .O , ; leur inclinaison est très-forte, et varie
de 40” à 6o°.à l’E .N .E . .
Ces Schistes .varient par leur, teinte, du rougeâtre au gris et gris bleuâtre ;
mais ils ont presque toujours une sorte d’éclat métallique. Ils sont le plus
souvent sans. cohésion, divisés en très-petits : feuillets.,
Dans la partie moyenne de leur masse, le Quartz qui.la pénètre tout entière,
s’en sépare çà et là en petits amas lenticulaires, én .noeuds, aplatis, autour
desquels se contournent les feuillets schisteux (G . h. 4-)- Sa prédominance
dans la roche lui donne une cohésion dont manquent lesstrates inférieurs. Elle
se parsème en même temps d’une multitude de petits points brillants (G. h. 5.)
et prend 1 apparencè d’une Graiiwacke à grain très-fin. Le Quartz ne s’y rassemble
plus seulement en noyaux, il s’y étend en veines dont l’épaisseur et la fréquence
augmentent à mesure que l ’on s’élève, et qui bientôt y forment des
bancs continus, épais de plusieurs décimètres. Ce Quartz est blanchâtre
grenu, parsemé de taches d’un gris jaunâtre, d’un aspect légèrement terreux.
Çà ets là ,m a is rarement, on crôirait y reconnaître dés grains quartzeux empâtés
ou plutôt fondus dans un ciment de même nature. Est-ce réellement
une roche entièrement cristallisée ? N’est-ce pas un agrégat ( G. h. 6. )?
Le Schiste de la base de lamontagne reparaît, avec tous ses caractères , au-
dessus de la Grauwacke schisteuse (G. h. 5.) qui T a surmonté après avoir d’abord
alterné avec lu i, et au-dessus des bancs de la roche quartzeuse ambiguë qui
alternent avec celle-ci. C’est le caractère de cette formation quelle qu’elle soit :
le développement de termes nouveaux dans sa partie supérieure n’exclut pas
le retour des termes inférieurs; ils y reparaissent, mais en subordination.
Cependant les Schistes argileux et irisés dé la base dé la montagne forment
une massé épaisse de plus de too" au-dessus des roches que j ’ai décrites jusqu’ici.
La Grauwacke schisteuse et le Quartz, non plus en rognons lenticulaires;
mais toujours en veines ou en couches peu épaisses, leur sont subordonnés.
Des bancs d’une roche nouvelle s’y montrent (G. h. 7 .) , et tout
d’abord , ,avec .un développement considérable. Ce sont des Grauwackes (?) à
grain fin; tendres,,noires, pyriteuses; ét imprégnées de calcaire qui y forme
même de petites veines spathiques. Exposées à l’air, ces masses pyriteuses
s’échauffent , se décomposent et se délitent en une terre grisâtre qui se-couvre
d’efflorescences salines.
La Pyrite ferrugineuse pénètre un grand nombre de strates de l’étagémùyen
et supérieur des montagnes, et c es t à sa décomposition que le fendillement
remarquable d’un grand nombre d’entre elles doit - être - attribué. .
Le Calcaire qu i a préludé dans les Grauwackes ( Schistes) pyriteuses , se montre '
au-dessus, d’abord en couches minces et flexueuses comme les Schistes mêmes
auxquels il est Subordonné ; puis ceux-ci disparaissent, et le Calcaire alterne
avec des bancs de Quartz grenu (G . h.
C’est une roche compacte, à grain fin; gris de fiiméè, toute remplie de parties
spathiques. La difficulté avec laquelle quelques-uns de ses bancs - sont rayés
par lacie r et font effervescence• avec les acides concentrés, me fait pehser
qu’ils sont pénétrés de silice (G. h. 8. ).
Elle, exclut bientôt presque entièrement les couches! quartzeusès avec lesquelles
elle alternait d’abord, et devient sous les sommets de ■ Mossouri là
roche dominante.