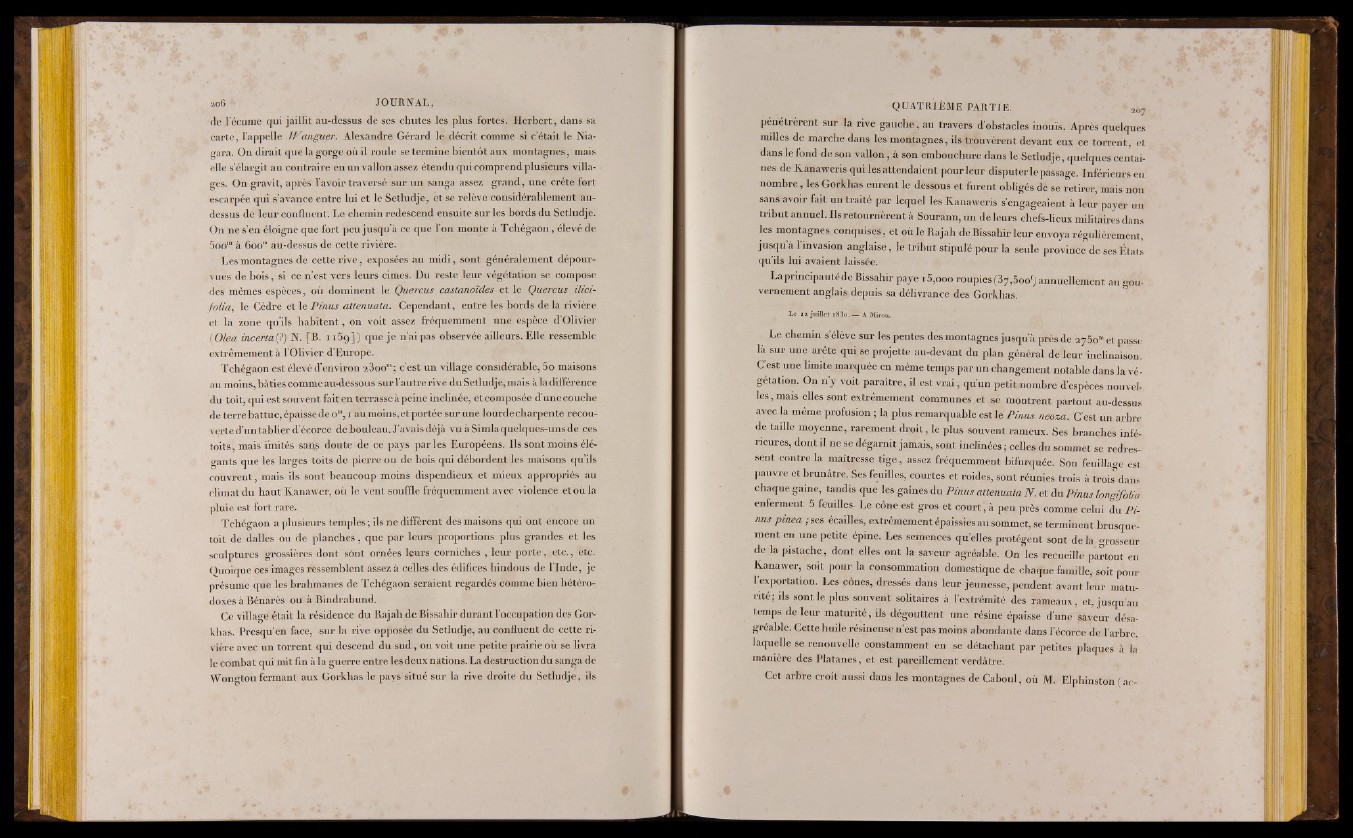
de l’écume qui jaillit au-dessus de ses chutes les plus fortes. Herbert, dans sa
carte, l’appelle tf'anguer. Alexandre Gérard le décrit comme si c’était le Niagara.
On dirait que la gorge où il roule se termine bientôt aux montagnes, mais
elle s’élargit au contraire en un vallon assez étendu qui comprend plusieurs villages.
On gravit, après l’avoir traversé sur un sanga assez grand, une crête fort
escarpée qui s’avance entre lui et le Setludje, et se relève considérablement au-
dessus de leur confluent. Le chemin redescend ensuite sur les bords du Setludje.
On ne s’en éloigne que fort peu jusqu’à ce que l’on monte à Tchégaon, élevé de
5oo” à 600“ au-dessus de cette rivière.
Les montagnes de cette r iv e , exposées au midi, sont généralement dépourvues
de bois, si ce n’est vers leurs cimes. Du reste leur végétation se compose
des mêmes espèces, où dominent le Quercus castanoïdes et le Quercus ilici-
folia, le Cèdre et le Pinus attenuata. Cependant, entre les bords delà rivière
et la zone qu’ils habitent, on voit assez fréquemment une espèce d’Olivier
(Olea incerta(J) N. [B. 115g ] ) que je n’ai pas observée ailleurs. Elle ressemble
extrêmement à l’Olivier d’Europe.
Tchégaon est élevé d'environ 9.3oom; c’est un village considérable, 5o maisons
au moins,bâties comme au-dessous sur l’autre rive duSetludje,mais à la différence
du toit, qui est souvent fait en terrasse à peine inclinée, et composée d’une couche
de terre battue, épaisse de 0“ , 1 au moins, et portée sur une lourde charpente recouverte
d’un tablier d’écorce de bouleau. J’avais déjà vu à Simla quelques-uns de ces
toits, mais imités sans doute de ce pays parles Européens. Ils sont moins élégants
que les larges toits de pierre ou de bois qui débordent les maisons qu’ils
couvrent, mais ils sont beaucoup moins dispendieux et mieux appropriés au
climat du haut Kanawer, où le vent souffle fréquemment avec violence et où la
pluie est fort rare.
Tchégaon a plusieurs temples; ils ne diffèrent des maisons qui ont encore un
toit de dalles ou de planches, que par leurs proportions plus grandes et les
sculptures grossières dont sônt ornées leurs corniches , leur porte, etc., etc.
Quoique ces images ressemblent assez à celles des édifices hindous de l’Inde, je
présume que les brahmanes de Tchégaon seraient regardés comme bien hétérodoxes
à Bénarès ou à Bindrabund.
Ce village était la résidence du Rajah de Bissahir durant l’occupation des Gorkhas.
Presqu’en face, sur la rive opposée du Setludje, au confluent de cette rivière
avec un torrent qui descend du sud, on voit une petite prairie où se livra
le combat qui mit fin à la guerre entre les deux nations. La destruction du sanga de
Wongtou fermant aux Gorkhas le pays situé sur la rive droite du Setludje, ils
pénétrèrent sur la rive gauclm, au travers d’obstacles inouïs. Après quelques
milles de marche dans les montagnes, ils trouvèrent devant eux ce torrent, et
dans le fond de son vallon, à son embouchure dans le Setludje, quelques centaines
de Kanaweris qui les attendaient pour leur disputer le passage. Inférieurs en
nombre, les Gorkhas eurent le dessous et fùrent obligés de se retirer, mais non
sans avoir fait un traité par lequel les Kanaweris s’engageaient à leur payer un
tribut annuel. Ils retournèrent à Sourann, un de leurs chefs-lieux militaires dans
les montagnes, conquises, et où le Rajah de Bissahir leur envoya régulièrement,
jusqu à 1 invasion anglaise, le tribut stipulé pour la seule province de ses États
qu’ils lui avaient laissée.
Laprincipautéde Bissahir paye r 5,ooo roupies (3ÿ ,M ) annuellement au gouvernement
anglais depuis sa délivrance des Gorkhas.
Le i a juillet i 83o . -4- A Mirou.
Le chemin s’élève sur les pentes des montagnes jusqu’à près de 27 5om et passe
là sur une arête qui se projette au-devant du plan général de leur inclinaison.
C’est une limite marquée en même temps par un changement notable dans la végétation.
On n’y voit paraître, il est v ra i, qu’un petit nombre d’espèces nouvelles,
mais elles sont extrêmement communes et se montrent partout au-dessus
avec la même profusion ; la plus remarquable est le Pinus neoza. C’est un arbre
de taille moyenne, rarement droit, le plus souvent rameux. Ses branches inférieures,
dont il ne .se dégarnit jamais, sont inclinées ; celles du sommet se redressent
contre la maîtresse tig e , assez fréquemment bifurquée. Son feuillage est
pauvre et brunâtre. Ses feuilles, courtes et roides, sont réunies trois à trois’ dans
chaque gaine, tandis que les gaines du Pinus attenuata Ri. et du Pinus longifoUa
enferment 5 feuilles. Le cône est gros et court, à peu près comme celui du Pinus
pinea ; ses éeailles, extrêmement épaissies au sommet, se terminent brusquement
en une petite épine. Les semences quelles protègent sont delà grosseur
de la pistache , dont elles ont la saveur agréable. On les recueille partout en
Kanawer, soit pour la consommation domestique de chaque famille,-soit pour
l’exportation. Les cônes, dressés dans leur jeunesse, pendent àvant leur maturité;
ils sont le plus souvent solitaires à l’extrémité des rameaux, et, jusqu’au
temps de leur maturité, ils dégouttent une résine épaisse d’une saveur désagréable.
Cette huile résineuse n’est pas moins abondante dans f écorce de l’arbre
laquelle se renouvelle constamment en se détachant par petites plaques à la
manière des Platanes, et est pareillement verdâtre.
Cet arbre croît aussi dans les montagnes de Caboul, où M. Elphinston (ac