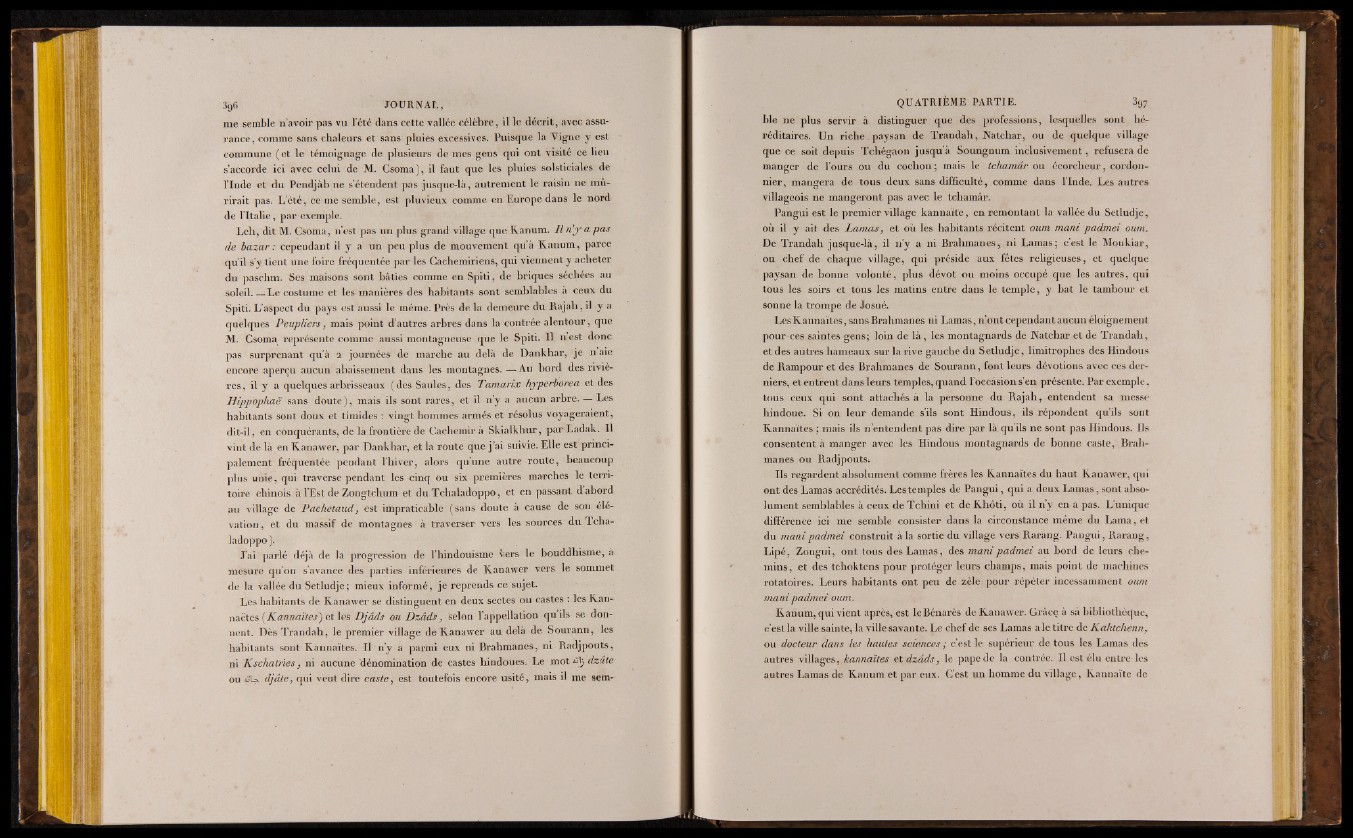
Iffî ï T r t r f f T i n *1 * P f
me semble n’avoir pas vu l’été dans cette vallée célèbre, il le décrit, avec assurance,
comme sans chaleurs et sans pluies excessives. Puisque la Vigne y est
commune (et le témoignage de plusieurs de mes gens qui ont visité ce lieu
s’accorde ici avec celui de M. Csoma), il faut que les pluies solsticiales de
l’Inde et du Pendjab ne s’étendent pas jusque-là, autrement le raisin 11e mûrirait
pas. L’été, ce rne semble, est pluvieux comme en Europe dans le nord
de l’Italie, par exemple.
Leh, dit M. Csoma, n’est pas un plus grand village que Kanum. Il ri y a pas
de bazar : cependant il y a un peu plus de mouvement qu’à Kanum, parce
qu’il s’y tient une foire fréquentée par les Cachemiriens, qui viennent y acheter
du paschm. Ses maisons sont bâties comme en Spiti, de briques séchées au
soleil Le costume et les manières des habitants «ont semblables à ceux du
Spiti. L’aspect du pays est aussi le même. Près de la demeure du Rajah, il y a
quelques Peupliers, mais point d’autres arbres dans la contrée alentour, que
M. Csoma représente comme aussi montagneuse que le Spiti. Il 11 est donc
pas surprenant qu’à 1 journées de marche au delà de Dankhar, je naie
encore aperçu aucun abaissement dans les montagnes. — Au bord des riviè^
res, il y a quelques arbrisseaux (des Saules, des Tamarix hyperborea et des
Hippophaë sans doute), mais ils sont rares, et il n’y a aucun arbre. — Les
habitants sont doux et timides : vingt hommes armés et résolus voyageraient,
dit-il, en conquérants, de là frontière de Cachemir à Skialkhur, par Ladak. Il
vint de là en Kanawer, par Dankhar, et la route que j'ai suivie. Elle est principalement
fréquentée pendant l’hiver, alors qu’une autre route, beaucoup
plus unie, qui traverse pendant les cinq ou six premières marches le territoire
chinois à l’Est de Zongtchum et du Tchaladoppo , et en passant d abord
au village àe Paehetaud, est impraticable (sans doute à cause de son élévation
, et du massif de montagnes à traverser vers les sources du Tchar>
ladoppo).
J’ai parlé déjà de la progression de l’hindouïsme vers le bouddhisme, à
mesure qu’on s’avance des parties inférieures de Kanawer vers le sommet
de la vallée du Setludje; mieux informé, je reprends ce sujet.
Les habitants de Kanawer se distinguent en deux sectes ou castes : les Kan-
naëtes (Kannuités) et les Djâds ou Dzâds, selon l’appellation qu ils se donnent.
Dès Trandah, le premier village de Kanawer au delà de Sourann, les
habitants sont Kannaïtes. Il n’y a parmi eux ni Brahmanes, ni Radjpouts,
ni Kschatries} ni aucune dénomination de castes hindoues. Le mot dzate
ou ù'U. djâte, qui veut dire caste, est toutefois encore usité, mais il me semble
ne plus servir à distinguer que des professions, lesquelles sont héréditaires.
Un rich e . paysan de Trandah, Natchar, ou de quelque village
que ce soit depuis Tchégaon jusqu’à Soungnum inclusivement, refusera de
manger de l’ours ou du cochon; mais le tchamâr ou écorcheur, cordonnier,
mangera de tous deux sans difficulté, comme dans 1 o 7 l’Inde. Les autres
villageois ne mangeront pas avec le tchamâr.
Pangui est le premier village kannaït'e, en remontant la vallée du Setludje,
où il y ait des Lamas, et où les habitants récitent oum mani padmei oum.
De Trandah jusque-là, il n’y a ni Brahmanes, ni Lamas; c’est le Moukiar,
ou chef de chaque village, qui préside aux fêtes religieuses, et quelque
paysan de bonne volonté, plus dévot ou moins occupé que les autres, qui
tous les soirs et tous les matins entre dans le temple, y bat le tambour et
sonne la trompe de Josué.
Les Kannaïtes, sans Brahmanes ni Lamas, n’ont cependant aucun éloignement
pour ces saintes gens; loin de là , les montagnards de Natchar et de Trandah,
et des autres hameaux sur la rive gauche du Setludje, limitrophes des Hindous
de Rampour et des Brahmanes de Sourann, font leurs dévotions avec ces derniers,
et entrent dans leurs temples, quand l’occasion s’en présente. Par exemple,
tous ceux qui sont attachés à la personne du Rajah, entendent sa messe
hindoue. Si on leur demande s’ils sont Hindous, ils répondent qu'ils sont
Kannaïtes ; mais ils n’entendent pas dire par là qu’ils ne sont pas Hindous. Ils
consentent à manger avec les Hindous montagnards de bonne caste, Brahmanes
ou Radjpouts.
Ils regardent absolument comme frères les Kannaïtes du haut Kanawer, qui
ont des Lamas accrédités. Les temples de Pangui, qui a deux Lamas, sont absolument
semblables à ceux de Tchini et de Khôti, où il n’y en a pas. L ’unique
différence ici me semble consister dans la circonstance même du Lama, et
du mani padmei construit à la sortie du village vers Rarang. Pangui, Rarang,
Lipé, Zongui, ont tous des Lamas, des mani padmei au bord de leurs chemins,
et des tchoktens pour protéger leurs champs, mais point de machines
rotatoires; Leurs habitants ont peu de zèle pour répéter incessamment oum
mani padmei oum,
Kanum, qui vient après, est leBénarès de Kanawer. Grâce à sa bibliothèque,
c’est la ville sainte, la ville savante. Le chef de ses Lamas aie titre de Kahtchenn,
ou docteur dans les hautes sciences ; c’est le supérieur de tous les Lamas dès
autres villages, kannaïtes et dzâds, le pape de la contrée. Il est élu entre les
autres Lamas de Kanum et par eux. G’est un homme du village, Kannaïte de