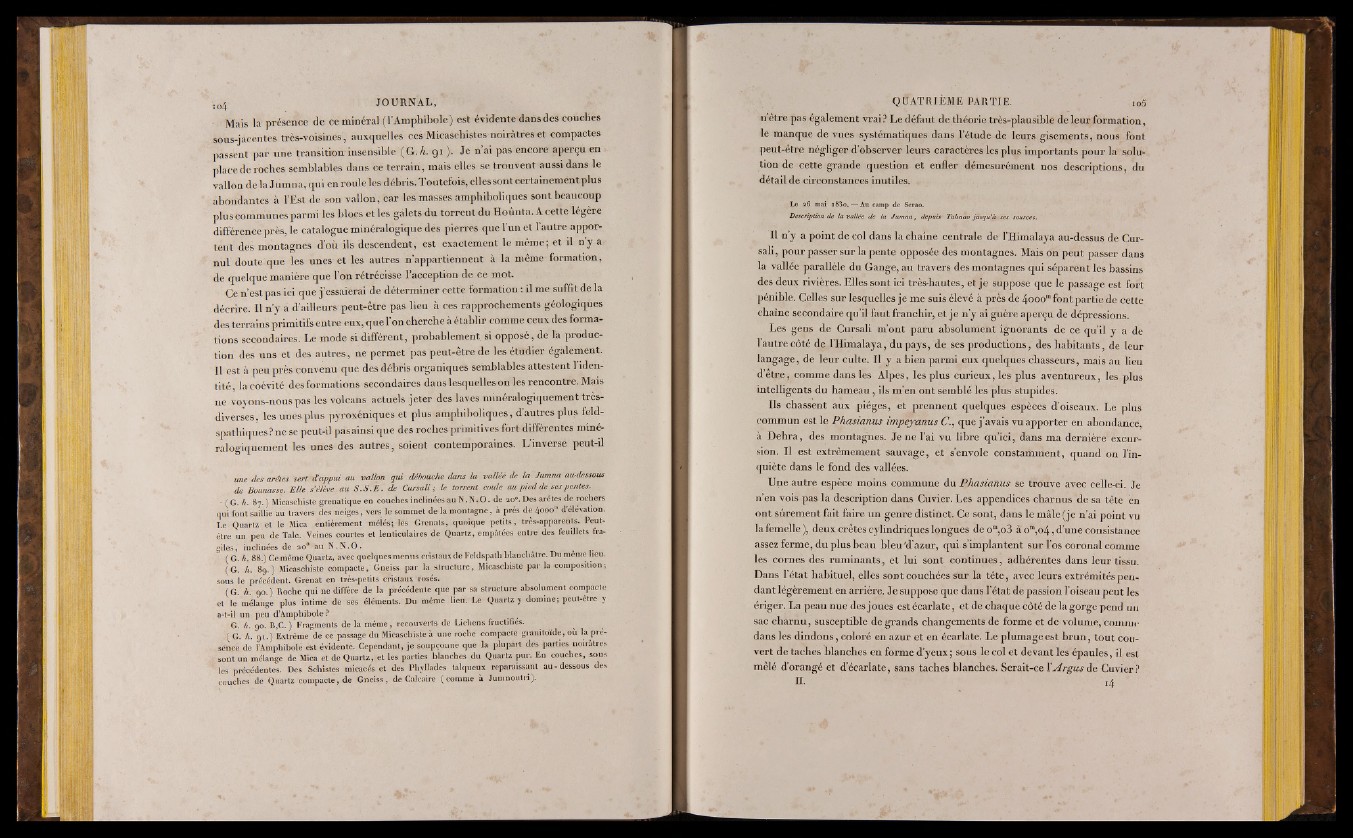
Mais la présence de ce minéral (l’Amphibole) est évidente dans des couches
sous-jacentes très-voisines, auxquelles ces Micaschistes noirâtres et compactes
passent par une transition insensible (G. h. g i )i f Je n ai pas encore aperçu en
place de roches semblables dans ce terrain, mais elles se trouvent aussi dans le
vallon de la Jumna, qui en roule les débris. Toutefois, elles sont certainement plus
abondantes à l’Est de son vallon, car les masses amphiboliques sont beaucoup
plus communes parmi les blocs et les galets du torrent du Hoûnta. A cette légère
différence près, le catalogue minéralogique des pierres que l’un et l’autre apportent
des montagnes d’où ils descendent, est exactement le même; et il n’y a
nul doute que les unes et les autres n’appartiennent à la même formation,
de quelque manière que l’on rétrécisse l’acception de ce mot.
Ce n’est pas ici que j ’essaierai de déterminer cette formation : il me suffit de la
décrire. Il n'y a d’ailleurs peut-être pas lieu à ces rapprochements géologiques
des terrains primitifs entre eux, que l’on cherche à établir comme ceux des formations
secondaires. Le mode si différent, probablement si opposé, de la production
des uns et des autres, ne permet pas peut-être de les étudier également.
Il est à peu près convenu que des débris organiques semblables attestent 1 identité
la coévité des formations secondaires dans lesquelles on les rencontre. Mais
ne voyons-nous pas les volcans actuels jeter des laves minéralogiquement très-
diverses, les unes plus pyroxéniques et plus amphiboliques, d’autres plus feld-
spathiques ?ne se peut-il pasainsi que des roches primitives fort différentes minéralogiquement
les unes des autres, soient contemporaines. L’inverse peut-il
’ une des aréles sert "<tappui au vallon qui débouche dans la vallée de la Jumna au-dessous
de Bounasse. Elle, s'élève au S.S .E . de Cursali; le torrent coule au pied de'ses pentes.
■ (G . h. 87.) Micaschiste grenatique en couches inclinées au N .N .O . de 20°. Des arêtes de rochers
qui font saillie au travers des neiges, vers le sommet de la montagne, à près de ¿¡000“ d’élévation.
Le Quartz", et le Mica entièrement méiés; les Grenats, quoique petits, très-apparents. Peut-
être un peu de Talc. Veines courtes et lenticulaires de Quartz, empâtées entre des feuillets fragiles,
inclinées de 20° au N.N.O. t. * r
( G. h. 88.) Ce même Quartz, avec quelques menus cristaux de Feldspath blanchâtre. Du même heu.
(G . h. 89.) Micaschiste compacte, Gneiss par la structure, Micaschiste par la composition;
sous le précédent. Grenat en très-petits cristaux rosés.
(G . h. 90.) Roche qui ne diffère de la précédente que par sa structure absolument compacte
et le mélange plus intimé de ses éléments. Du même lieu. Le Quartz y domine; peut-être y
a-t-il un peu d’Amphibole? • * , .¡^-\f
G. h. 90. B,C. ) Fragments de la même, recouverts de Lichens fructifies.
(G . h. 9 1 .) Extrême de ce passage du Micaschiste à une roche compacte granitoïde, où l a présence
de TAmphibole est évidente. Cependant, je soupçonne que la plupart des parties noirâtres
-■ ;sont un mélange de Mica et de Quartz, et les parties blanches du Quartz pur. En couches, sous
' le s précédentes. Des Schistes micacés et des Pliyllades talqueux reparaissant au-dessous des
couches de Quartz compacte, de Gneiss, de Calcaire (comme à Jumnoutri).
n etre pas également vrai ? Le défaut de théorie très-plausible de leur formation,
le manque de vues systématiques dans l’étude de leurs gisements, nous font
peut-être négliger d’observer leurs caractères les plus importants pour la solution
de cette grande question et enfler démesurément nos descriptions, du
détail de circonstances inutiles.
Le 26 mai 1 83o. — Au camp de Serao.
Description de la vallée de la Jumna, depuis Tahnao jusqu’à ses sources.
Il n’y a point de col dans la chaîne centrale de l’Himalaya au-dessus de Cursali,
pour passer sur la pente opposée des montagnes. Mais on peut passer dans
la vallée parallèle du Gange, au travers des montagnes qui séparent les bassins
des deux rivières. Elles sont ici très-hautes, et je suppose que le passage est fort
pénible. Celles sur lesquelles je me suis élevé à près de 4000” font partie de cette
chaîne secondaire qu’il faut franchir, et je n’y ai guère aperçu de dépressions.
Les gens de Cursali m’ont paru absolument ignorants de ce qu'il y a de
l'autre côté de l’Himalaya, du pays, de, ses productions, des habitants, de leur
langage, de leur culte. Il y a bien parmi eux quelques chasseurs, mais au lieu
d’ê tre , comme dans les Alpes, les plus curieux, les plus aventureux, les plus
intelligents du hameau, ils m’en ont semblé les plus stupides.
Ils chassent aux pièges, et prennent quelques espèces d’oiseaux. Lé plus
commun est 1 ePh.asian.11s impeyanus C., que j ’avais vuapporter en abondance
à Dehra, des montagnes. Je ne l’ai vu libre qu’ici, dans ma dernière excursion.
Il est extrêmement sauvage, et s’envole constamment, quand on l’inquiète
dans le fond des vallées.
Une autre espèce moins commune du Phasiañus se trouve avec celle-ci. Je
n’en vois pas la description dans Cuvier. Les appendices charnus de sa tète en
ont sûrement fait faire un genre distinct. Ce sont, dans le mâle (je n’ai point vu
lafemelle), deux crêtes cylindriques longues deom,o3 à om,o4 , d’une consistance
assez ferme, du plus beau bleu'd’azur, qui s’implantent sur l’os coronal comme
les cornes des ruminants, et lui sont continues, adhérentes dans leur tissu.
Dans l’état habituel, elles sont couchées Sur la tête, avec leurs extrémités pendant
légèrement en arrière. Je suppose que dans l’état de passion l’oiseau peut les
ériger. La peau nue des joues est écarlate, et de chaque coté de la gorge peud un
sac charnu, susceptible de grands changements de forme et de volume, comme
dans les dindons, coloré en azur et en écarlate. Le plumage est brun, tout couvert
de taches blanches en forme d’yeux ; sous le col et devant les épaules, il est
mêlé d’orangé et d’écarlate, sans taches blanches. Serait-ce l'Argus de Cuvier ?
H. 14 ’