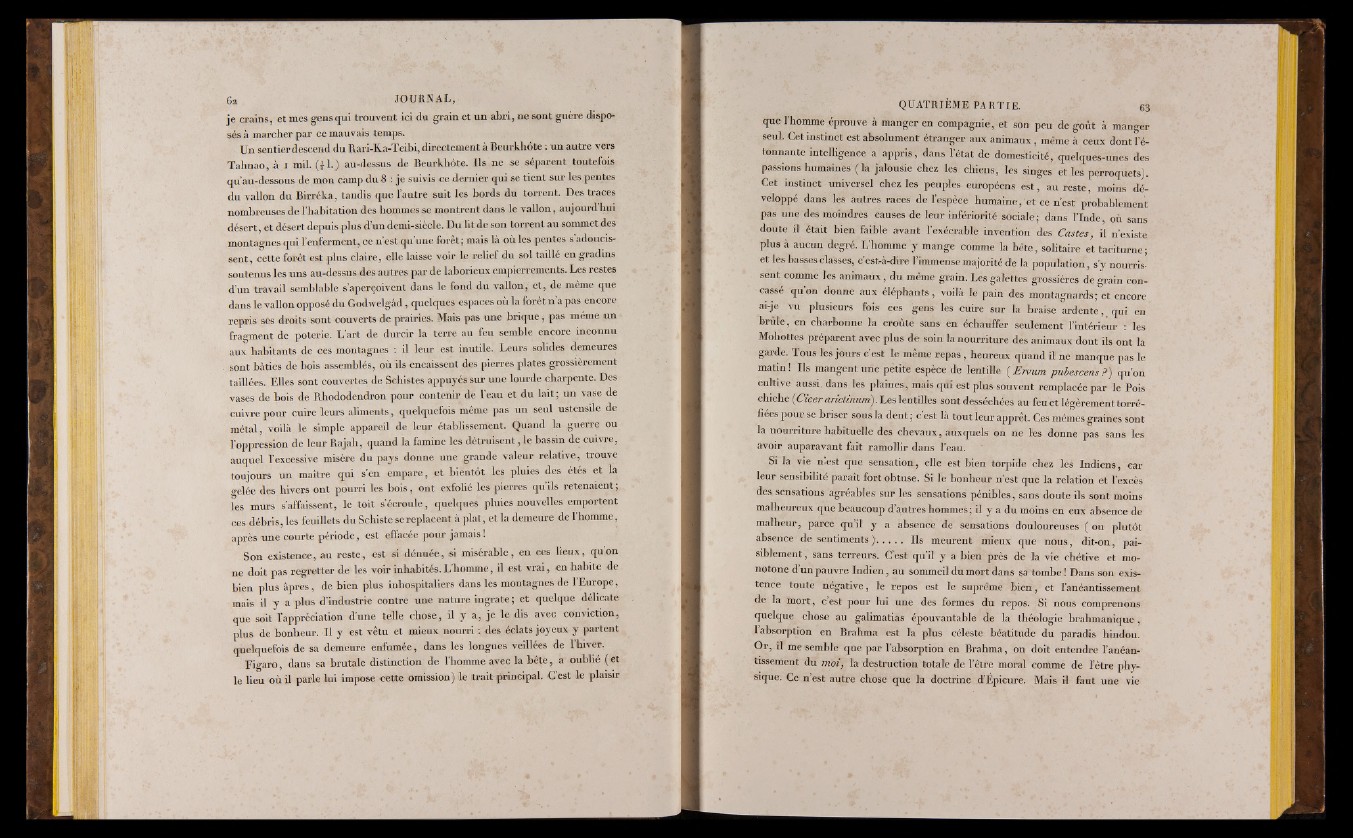
je crains, et mes gens qui trouvent ici du grain et un abri, ne sont guère disposés
à marcher par ce mauvais temps.
Un sentier descend du Rari-Ka-Teibi, directement à Bcurkhôte : un autre vers
Tahnao, à i mil. (5 10 au-dessus de Beurkhôte. Ils ne se séparent toutefois
qu’au-dessous de mon camp du 8 : je suivis ce dernier qui se tient sur les pentes
du vallon du Birréka, tandis que l’autre suit les bords du torrent. Des traces
nombreuses de l’habitation des hommes se montrent dans le vallon, aujourdhui
désert et désert depuis plus d’un demi-siècle. Du lit de son torrent au sommet des
montagnes qui l’enferment, ce n’est qu’une forêt; mais là où les pentes s adoucissent,
cette forêt est plus claire, elle laisse voir le relief du sol taille en gradins
soutenus les uns au-dessus des autres par de laborieux empierrements. Les restes
d’un travail semblable s’aperçoivent dans le fond du vallon, et, de même que
dans le vallon opposé du Godwelgâd, quelques espaces où la forêt n a pas encore
repris ses droits sont couverts de prairies. Mais pas une brique, pas merne un
fragment de poterie. L’art de durcir la terre au feu semble encore inconnu
aux habitants de ces montagnes : il leur est inutile. Leurs solides demeures
sont bâties de bois assemblés, où ils encaissent des pierres plates grossièrement
taillées. Elles sont couvertes de Schistes appuyés sur une lourde charpente. Des
vases de bois de Rhododendron pour contenir de l’eau et du lait ; un vase de
cuivre pour cuire leurs aliments, quelquefois même pas un seul ustensile de
métal, voilà le simple appareil de leur établissement. Quand la guerre ou
l’oppression de leur Rajah, quand la famine les détruisent, le bassin de cuivre,
auquel l’excessive misère du pays donne une grande valeur relative, trouve
toujours un maitre qui s’en empare, et bientôt les pluies des étés et la
gelée des hivers ont pourri les b o is , ont exfolié les pierres qu ils retenaient ;
les murs s’affaissent, le toit s’écroule , quelques pluies nouvelles emportent
ces débris, les feuillets du Schiste se replacent à plat, et la demeure de l’homme,
après une courte période , est effacée pour jamais !
Son existence, au reste, est si dénuée, si misérable, en ces lieux, qu’on
ne doit pas regretter de les voir inhabités. L ’homme, il est vrai, en habite de
bien plus âpres, de bien plus inhospitaliers dans les montagnes de l’Europe,
mais il y a plus d’industrie contre une nature ingrate; et quelque délicate
que soit l’appréciation d’une telle chose, il y a, je le dis avec conviction,
plus de bonheur. Il y est vêtu et mieux nourri : des éclats joyeux y partent
quelquefois de sa demeure enfumée, dans les longues veillées de l’hiver.
Figaro, dans sa brutale distinction de l’homme avec la bête, a oublié ( et
le lieu où il parle lui impose cette omission) le trait principal. C ’est ,1e plaisir
que l’homme éprouve à manger en compagnie, et son peu de goût à manger
met est absolument étranger aux animaux, même à ceux dont bétonnante
intelligence a appris, dans l’état de domesticité, quelques-unes des
passions humaines ( la jalousie chez les cliiens, les singes e lle s perroquets).
Cet instinct universel chez, les peuples européens est, au reste, moins développé
dans les autres races de l’espèee humaine, et ce n’est probablement
pas une des moindres causes de leur infériorité sociale; dans l’Inde, où sans
doute il était bien faible avant l’exécrable invention des Castes, il n’existe
plus à aucun degré. L ’homme y mange comme la béte, solitaire et taciturne;
et les basses classes, c’est-à-dire l’immense majorité de la population, s’y nourrissent
comme les animaux, du même grain. Les galettes grossières de grain concassé
qu’on donne aux éléphants, voilà le pain des montagnards ; et encore
ai-je ™ plusieurs fois ces gens les cuire sur la braise ardente,_ qui en
brûle, en eharhonne la croûte sans en échauffer seulement l’intérieur ; les
Mohottes préparent avec plus de soin la nourriture des animaux dont ils ont la
garde. Tous les jours c’est le même repas, heureux quand il ne manque pas le
matin! Us mangent une petite espèce de lentille. (Ervum pubescens?) qu’on
cultive aussi, dans les plaines, mais qui est plus souvent remplacée par le Pois
chiehe (Cicer arictinum). Les lentilles sont desséchées au fou et légèrement torréfiées
pour se briser sous la dent ; c’est là tout leur apprêt. Ces mêmes graines sont
la nourriture habituelle des chevaux, auxquels on ne les donne pas sans les
avoir auparavant fait ramollir dans l’eau.
Si la vie n.est que sensation , elle est bien torpide chez lès Indiens , car
leur sensibilité paraît fort obtuse. Si le bonheur n’est que la relation et ï ’exeès
des sensations agréables sur les sensations pénibles, sans doute ils sont moins
malheureux que beaucoup d’autres hommes; il y a du moins en eux absence de
malheur, parce qu’il y a absence de sensations douloureuses ( ou plutôt
absence de sentiments) Us meurent mieux que nous,, dit-on, paisiblement,
sans terreurs. C’est qu’il y a bien près de la vie chétive et monotone
d un pauvre Indien, au sommeil du mort dans sa tombe ! Dans son existence
toute négative, le repos est le suprême bien, et l’anéantissement
de la mort, c’est pour lui une des formes du repos. Si nous comprenons
quelque chose au galimatias épouvantable de la théologie brahmanique ,
1 absorption en Brahma est la plus céleste béatitude du paradis hindou.
Or , il me semble que par l’absorption en Brahma, on doit entendre l’anéantissement
du mot, l'a destruction totale de l’être moral comme de Fêtre physique.
Ce n’est autre chose que la doctrine d’Épicure. Mais il faut une vie