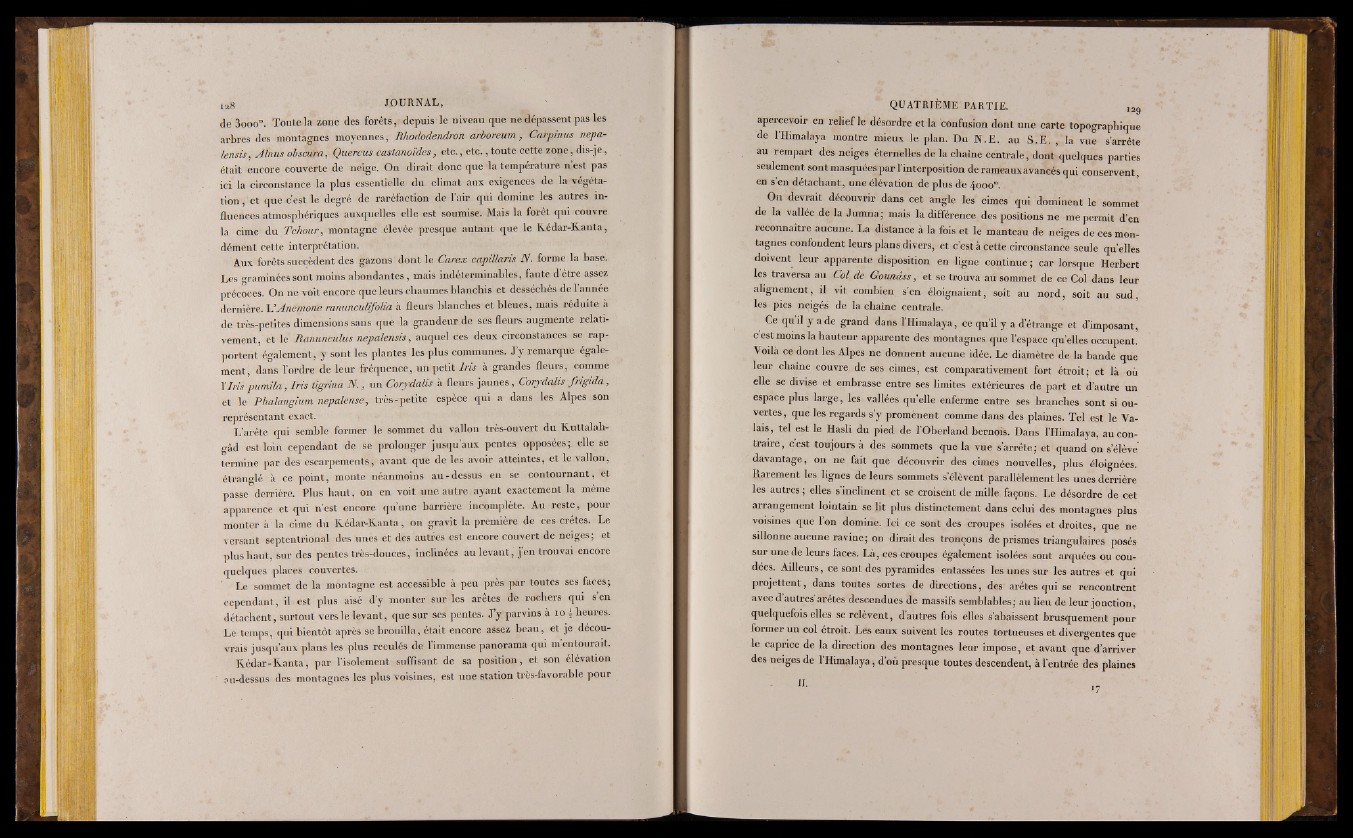
de 3ooo” . Toute la zone des forêts, depuis le niveau que ne dépassent pas les
arbres des montagnes moyennes, Rhododendron arboreum, Carpinus nvpa-
lensis, Alrius obscura, Quercus castanoïdes, etc., e tc ., toute cette zone, dis-je,
était encore couverte de neige. On dirait donc que la température nes t pas
ici la circonstance la plus essentielle du climat aux exigences de la végétation,
et que c’est le degré de raréfaction de l'air qui domine les autres influences
atmosphériques auxquelles elle est soumise. Mais la forêt qui couvre
la cime du Tchour, montagne élevée presque autant que le Kédar-Kanta,
dément cette interprétation.
Aux forêts succèdent des gazons dont le Carex capillaris N. forme la base.
Les graminées sont moins abondantes , mais indéterminables, faute d’être assez
précoces. On ne voit encore que leurs chaumes blanchis et desséchés de 1 année
dernière. L ’Anemone ranunculifolia à fleurs blanches et bleues, mais réduite à
de très-petites dimensions sans que la grandeur de ses fleurs augmente relativement,
et le Ranunculus nepalensis, auquel ces deux circonstances se rapportent
également, y sont les plantes les plus communes, J’y remarque également,
dans l’ordre de leur fréquence, un petit Iris à grandes fleurs, comme
l'Iris pumila, Iristigrina N., un Corydalis à fleurs jaunes, Corjdalis frigida,
et le Phalangium nepalense-, très-petite espèce qui a dans les Alpes son
représentant exact.
L ’arête qui semble former le sommet du vallon très-ouvert du Kuttalah-
gâd est loin cependant de se prolonger jusqu aux pentes opposées;, elle se
termine par des escarpements, avant que de les avoir atteintes, et le vallon,
étranglé à ce point, monte néanmoins au - dessus en se contournant, et
passe derrière. Plus haut, on en voit une autre ayant exactement la même
apparence et qui n’est encore qu’une barrière incomplète. Au reste, pour
monter à la cime du Kédar-Kanta, on gravit la première de ces crêtes. Le
versant septentrional des unes et des autres est encore couvert de neiges; et
plus haut, sur des pentes très-douces, inclinées au levant, j’en trouvai encore
quelques places couvertes, i
Le sommet de la montagne est accessible à peu près par toutes ses faces;
cependant, il est plus aisé d’y monter sur les arêtes de rochers qui s’en
détachent, surtout vers le levant, que sur ses pentes. J y parvins à 10 i heures.
Le temps, qui bientôt après se brouilla, était encore assez beau, et je découvrais
jusqu’aux plans les plus reculés de l’immense panorama qui m’entourait.
Kédar-Kanta, par l’isolement suffisant de sa position, et son élévation
au-dessus des montagnes les plus voisines, est une station très-favorable pour
apercevoir en relief le désordre et la confusion dont une carte topographique
de l’Himalaya montre mieux le plan. Du N .E . au S .E . , la vue s’arrête
au rempart des neiges éternelles de la chaîne centrale, dont quelques parties
seulement sont masquées par l’interposition derameauxavancés qui conservent,
en s'en détachant, une élévation de plus de 4000".
On devrait découvrir dans cet angle les cimes qui dominent le sommet
de la vallée de la Jumna; mais la différence des positions ne me permit d’en
reconnaître aucune. La distance à la fois et le manteau de neiges de ces montagnes
confondent leurs plans divers, et c’est à cette circonstance seule qu’elles
doivent leur apparente disposition en ligne continue ; car lorsque Herbert
les traversa au Col de Gounâss, et se trouva au sommet de ce Col dans leur
alignement, il vit combien s’en éloignaient, soit au nord, soit au sud,
les pics neigés de la chaîne centrale.
Ce qu il y a de grand dans l’Himalaya, ce qu’il y a d’étrange et d’imposant,
c’est moins la hauteur apparente des montagnes que l’espace quelles occupent.
Voilà ce dont les Alpes ne donnent aucune idée. Le diamètre de la bande que
leur chaîne couvre de ses cimes, est comparativement fort étroit; et là où
elle se divise et embrasse entre ses limites extérieures de part et d’autre un
espace plus large, les vallées qu’elle enferme entre ses branches sont si ouvertes
, que les regards s’y promènent comme dans des plaines. Tel est le Valais,
tel est le Hasli du pied de l’Oberland bernois. Dans l’Himalaya, au contraire,
cest toujours à des sommets que la vue s’arrête; et quand on s’élève
davantage, on ne fait que découvrir des cimes nouvelles, plus éloignées.
Rarement les lignes de leurs sommets s’élèvent parallèlement les unes derrière
les autres ; elles s’inclinent et se croisent de mille façons. Le désordre de cet
arrangement lointain se lit plus distinctement dans celui des montagnes plus
voisines que Ion domine. Ici ce sont des croupes isolées et droites, que ne
sillonne aucune ravine; on dirait des tronçons de prismes triangulaires posés
sur une de leurs faces. Là, ces croupes également isolées sont arquées ou coudées.
Ailleurs, ce sont des pyramides entassées les unes sur les autres et qui
projettent, dans toutes sortes de directions, des arêtes qui se rencontrent
avec d autres'arêtes descendues de massifs semblables; au lieu de leur jonction,
quelquefois elles se relèvent, d autres fois elles s’abaissent brusquement pour
former un col étroit. Les eaux suivent les routes tortueuses et divergentes que
le caprice de la direction des montagnes leur impose, et avant que d’arriver
des neiges de 1 Himalaya, d où presque toutes descendent, à l’entrée des plaines