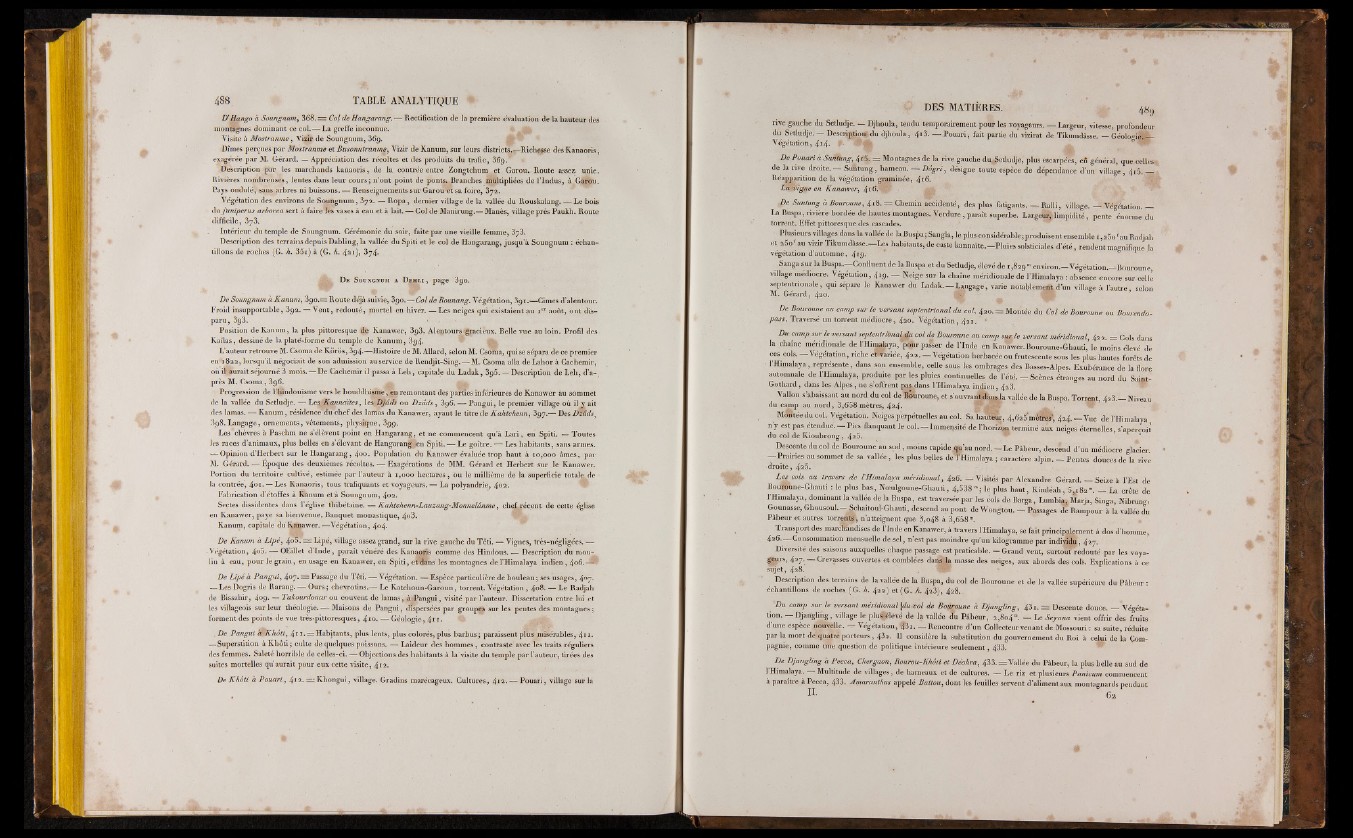
D'Hango à Soungnum, 368. = Col de Hangarang. — Rectification de la première évaluation de la hauteur des
montagnes dominant ce caTS—La greffe inconnue.
Visite à Mostranme, Vizir de Soungnum, 36g.
Dîmes perçues par Mostranme et Busomitranme, Vizir de Kanum, sur leurs districts.=-Riche^se des Kanaoris,
exagérée par M. Gérard. — Appréciation des récoltes et des produits du trafic, 369.
Description par les marchands kanaoris, de la, contrée entre Zongtchum et Garou. Route assez unie.
Rivières nombreusës, lentes dans leur cours; n’ont point de ponts..Branches jnültipliées de l’Indus, à Garou.
Pays ondulé, sans arbres ni buissons. — Renseignements sur Garou *et sa foire, 3ya.
Végétation des environs de Soungnum, 37a. — Ropa, dernier village de la vallée du Rouskalang. — Le bois
du funiperus arborea sert à faireliés vases à eau et à lait. — Col de Manirung.— Manès, village près Paukh. Route
difficile, 373.
Intérieur du temple de Soungnum. Cérémonie du soir, faite par une vieille femme, 373.
Description des terrains depuis Dabling, la vallée du Spiti et le col de Hangarang, jusqu’à Soungnum : échantillons
de roches (G. h. 35i) à (G. h. 421), 374.
fk. D e Soungnum a D e h li , page 390.
De Soungnum à Kanum, 390.= Route déjà suivie, 390.— Col de Rounang. Végétation, 391.— Cimes d’alentour.
Froid insupportable, 39a. — Vent, redouté, mortel en hiver. — Les neiges qui existaient au I er août, ont disparu,
393. -Ji
Position de Kanum, la plus pittoresque de Kanawer, 393. Alentoursfgracieux. Belle vue au loin. Profil des
Kaïlas, dessiné de la platé-forme du temple de Kanum, 3g4.
L’auteur retrouve M. Csoma de Koros, 3g4-—Histoire de M. Allard, selon M. Csoma, qui se sépara de ce premier
en'1822, lorsqu’il négociait de son admission au service de Rendjit-Sing. — M.. Csoma alla de Lahor à Cachemir,
où ilfàurait séjourné 3 mois.— De Cachemir il passa à Leh, capitale du Ladak, 395. — Description de Leh, d’a-i
près M. Csoma, 396.
Progression de l’hindouïsme vers le bouddhisme ,_en remontant des parties inférieures de Kanawer àu sommet
de la vallée du Setludje. --r- Lesjdi^annaïtes, lesÿP/«JI ou Dzâds, 396. Pangui, le premier village où il v ait
des lamas. — Kanum, résidenc^u chef des lamas du Kanawer, ayant le titre de Kahtchenn, 3g-j.— Des IÆdsy
398. Langage, ornements, vêtements, physique, 399.
Les chèvres à Paschm ne s’élèvent point en Hangarang, et ne commencent qu’à Lari, en Spiti. — Toutes
les races d’animaux, plus belles en s’élevant de Hangaran|f$en Spiti. — Le goître. — Les habitants, sans armes.
— Opinion d’Herbert sur le Hangarang, 400. Population du Kanawer évaluée trop haut à 10,000 âmes, par
Ml Gérard, Epoque des deuxièmes récoltes. — Exagérations de MM. Gérard et Herbert sur le Kanawer.
Portion du territoire cultivé, estimée par l’auteur à 1,000 hectares, bu le millième de la superficie t o t a l ■
la contrée, 401.—-Les Kanaoris, tous trafiquants et voyageurs.— La polyandrie, 402.
Fabrication d’étoffes à Kanum et’à Soungnum, 402.
Sectes dissidentes dans l’église thibétaine. — Kahtchenn-Lauzang-Monnelânme, cheLrécent de cette église
en Kanawer, paye sa bienvenue, Banquet monastique, 4o3.
Kanum, capitale du Kanawer.— Végétation, 4o4-
De Kanum à Lipé, 4657= Lipé, .village assez grand, sur la rive gauche du Têti. — Vignes, très-négligées. ^ '
■ Végétation, 4°5. — OEillet d’Inde, paraît vénéré des Kanaoris comme des Hindous. — Description du moulin
à eau, pour le grain, en usage en Kanawer, en Spiti, et Élns les montagnes del’Himalaya indien, 4o6.
De Lipé a Pangui, 407. = Passage du Têfi. — Végétation.— Espèce particulière de bouleau; ses usages, 407■
— Les Dogris de Rarang. — Ours ; chevrotins.^pLe Katchoun-Garoun, torrent. Végétation, 408; — Le Radjah
de Bissahir, 4°9* — Takourdouar ou couvent de lamas, aiPangui, visité par l’auteur. Dissertation entre lui et
les villageois sur leur théologie. — Maisons de Pangui, disperséés par groupes sur les pentes des montagnes;
forment des points de vue très-pittoresques, 4IO- ^Géologie, 411.
. De Pangui mKhôti, 411. = Habitants, plus lents, plus colorés, plus barbus; paraissent plus misérables, 4M-
— Superstition à Khôti ; culte de quelques poissons. — Laideur des hommes, contraste avec les traits réguliers
des femmes. Saleté horrible de celles-ci. — Objections des habitants à la visite du temple par l’auteur, tirées des
suites mortelles qu’aurait pour eux cette visite, 412.
De Khôti à Poudri, 412- — Khongui, village. Gradins marécageux. Cultures, 412.— Pouari, village sur la
rive gauche du Setludje.— Djhoula, tendu temporairement pouf les voyageurs. — Largeur, vitesse, profondeur
du Setludje;— Descrjpioif du djhoula , 4 l 3c 4 - Pouari, fait partie du vizirat de Tikumdisse. — Géologiljt-
Végétation, 4*4*
De Pouari à SurÊhng, 4jgp = Montagnes de la rive gauche du^etludje, plus escarpées, efi général, que celles«
de la rive droite. — Suntung, hameau. — Dôgri, désigne toute espèce de dépendance d’un village, 4i5._
Réapparition de la végétation graminée, 4*6.
Lamïïgÿe en Kanawer, 41^^üf
J)e Suntung à Bouroune, 418.BChemin accidenté, des plus .fatigants, — Ralli, village. Végitation. —
La Buspa, rivière bordée de hautes montagnes. Verdure, paraît superbe. Large^limpidité, pente énorme du
torrent. Effet pittoresque des cascades.
Plusieurs villages dans la,vallée de la Buspa ; Sangla, le plus considérable ; produisent ensemble i , z5o 'au Badjah
et. afin 'an vizir Tikumdâsse.^Les habitants, de caste kannaïte.—Pluies solsticiales d’été, rendent magnifique la
. végétation d’automne, 4I9-~ ••••• i , !. .
Sanga sur la Buspa.—Confluent de lÎ Buspa et du Setludje, élevé de 1,809- environ.-Végétation.—Bouroune,
village médiocre. Végétation, 419. — Neige sur la chaîne méridionale de l’Himalaya : absence encore sur celle
septentrionale, qui sépare le Kanawer du Ladak— Langage, varie notablement.d’un village à loutre selon
M. Gérard, 420. | B ■
De Bouroune a,i camp sur le versant septentrional dû col. 4ao,=iMontée du Col de Bouroune ou Boarendo.
pass. Traversé un torrent médiocre, 420. Végétation, 4a 1.
Du camp sur le versant septentrfônaUbi col de Bouroune au camp sur le versant méridional, 422. = Cols dans
la chaîne méridionale de l’Hingjjpya, p<8ir passer de l’Inde en KanaWer.B.quroune-Ghauti, le moins élevé de
ces cols, — Végétation, riche eWhriée, 42®g|égétation herbacée ou frutescente isous Üs plushautes forêts de
■ l’Himalaya, représente ¡¿djns. son ensemble, .celle sous les ombrages dés Basses-Àlpes. Exubérance de la flore
automnale de l’Himalaya, produite.-par les pluies .^ntinuelles d^ L’été. V Scènes étrariges au nord du Saint-
Gothard, dans les Alpes, ne s’offrent Dedans l ’Himalaya indien, 423.
Vallon s’abaissant au nord du col delg&roune, et s'ouvraiâdamla vallée de la Buspa. Torrent, 423.— Niveau
du camp au nord, 3,658 mètres, 424-
M*tée du col. Yégétation. Neiges perpétuelles au col. Sa haülur, 4,625‘m è fe , 424. — Vue de l’Himalaya
ny est;pas étendue. Pics flanquant le col. — Immensité de l’horizon terminé àux neiges éternelles, s’aperçoit
du col de Kioubrong, 425. ™ . “
Descente du col de Bouroune au sud, moins rapide ,m’au nord^Le Pâbeur, descend d’un médiocre glacier.
— Prairies au sommet de sa vallée, les plus belles deTHimalaya ; caractère alpin. — Pentes dduces de la rive
droite, 425.
'.¡¿cols au travers.de {Himalaya méridional, 426.y-Visités par Alexandre Gérard. — Seize à l'Est de
BoiiPmè-Ghauti : le plus bas, Noeulgbune-Ghauti, 4,538” ; le plùs haut, Kimléah, La crête de
l’Himalaya, dominant la vallée de la Buspà, est traversée’par les cols de Barga, LumbiauMarja, Singa,.Nibrung,
Gounasse, Ghousoul. -^çhaitoul-Gbaufi, descend au pont de Wongtou. — Passages X Rampour à la vallée du
Pâbeur et autres torrents, n’atteignent que 3,©48 à 3,658”.
Transport des marcMndises de l’Inde en Kanawer, à travers l’Himalaya, se fait principalement à dos d’homme,
426— Consommation mensuelle de sel, n’est pas moindre qu’un kilogramme par individu, 427.
Diversité des saisons auxquelles chaque passage est praticable. — Grand vent, surtoKedouté par les voya-
|||jirs, 427. Crevasses ouvertes et comblées dan&|la masse des neiges, aux abords des colfc. Explications à ce
sujet, 428.
Description des terrains de la vallée de la Buspa, du col de Bouroune et de la vallée supérieure du Pâbeur :
échantillons de roches. (G. h. 422) et (G. h. 423), 428..
‘Du camp sur le versant méridional |du.-col de Bomoune à Djangling, 43i. = Descente douce. ¿^Végétation.
— Djatfglmg, village le plu^levé de la vallée du Pâbeur, 2,804— Le Seyana vient offrir des fruits
d une espèce poùvelle. — Végétation, ^3i. — Rencontre d’un Collecteur venant de Mossouri : sa suite, réduite
par la mort deiquâtré porteurs, 43a. ' 11 considère la substitution du gouvernement du Roi à celui de la Çom-
pagnie, comme üne question de politique intérieure seulement, 433.
De Djangling a Pecca, Chergaon, Rourou-Khôti et Déohra, 433.=Vallée du Pâbeur, la plus belle au sud de
l’Himalaya. — Multitude de villages, de hameaux et de cultures. — Le riz et plusieurs Panicum commencent
a paraître à Pecca, 433. Aiparanthus appelé Battou, dont les feuilles servent d’aliment aux montagnards pendant