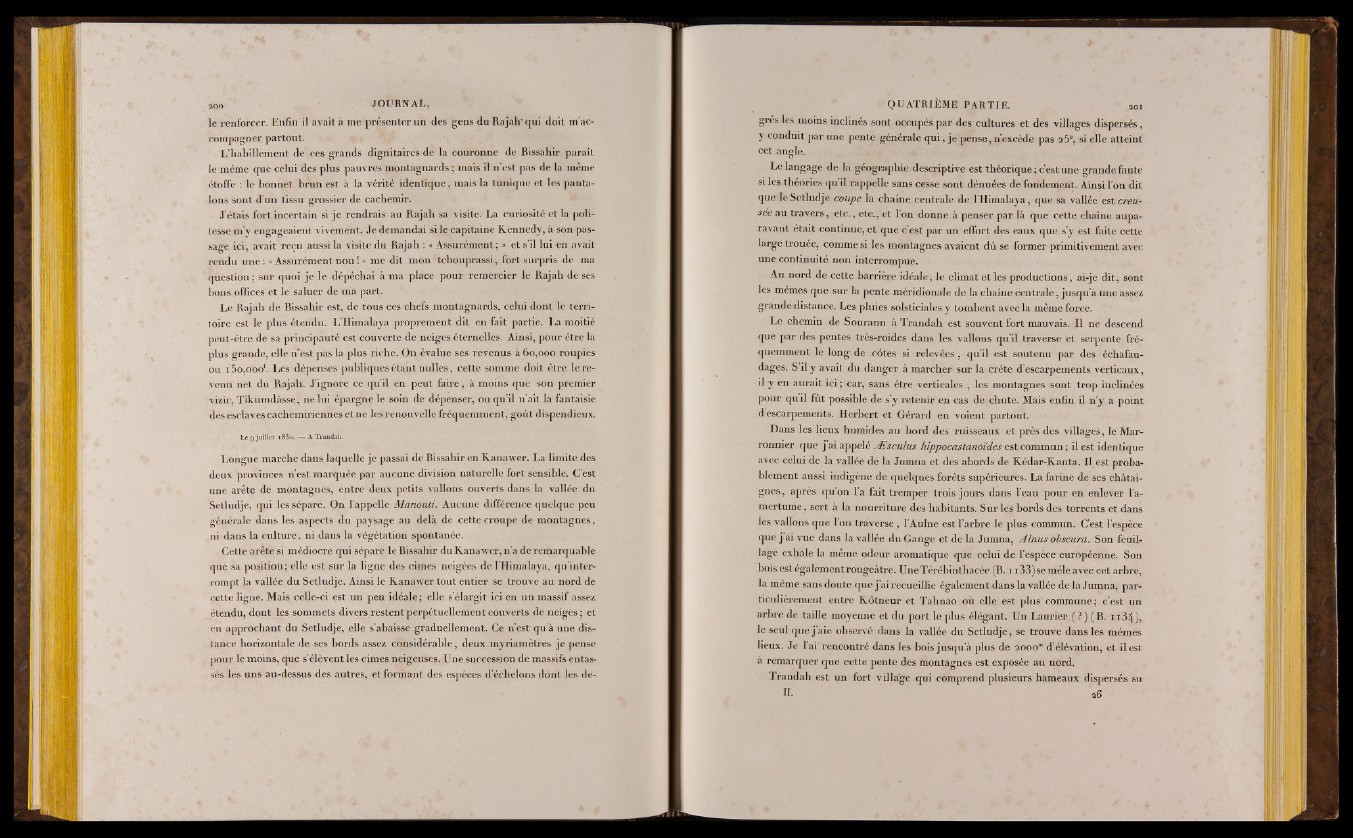
le renforcer. Enfin il avait à me présenter un des gens du Rajah'qui doit m’accompagner
partout.
L ’habillement de ces grands dignitaires de la couronne de Bissahir paraît
le même que celui des plus pauvres montagnards ; mais il n’est pas de la même
étoffe ■ le bonnet brun est à la vérité identique, mais la tunique et les pantalons
sont d’un tissu grossier de cachemir.
• J’étais fort incertain si je rendrais au Rajah sa visite. La curiosité et la politesse
m ’y engageaient vivement. Je demandai si le capitaine Kennedy, à son passage
ici, avait reçu aussi la visite du Rajah : « Assurément ; » et s’il lui en avait
rendu une : « Assurément non ! » me dit mon tchouprassi, fort surpris de ma
question; sur quoi je le dépêchai à ma place pour remercier le Rajah de ses
bons offices et le saluer de nia part.
Le Rajah de Bissahir est, de tous ces chefs montagnards, celui dont le territoire
est le plus étendu. L ’Himalaya proprement dit en fait partie. La moitié
peut-être de sa principauté est couverte de neiges éternelles. Ainsi, pour être la
plus grande, elle n’est pas la plus riche. On évalue ses revenus à 60,000 roupies
ou i 5o,ooof. Les dépenses publiques étant nulles, cette somme doit être le revenu
net du Rajah. J’ignore ce qu’il en peut faire, à moins que son premier
vizir, Tikumdâsse, ne lui épargne le soin de dépenser, ou qu’il n’ait la fantaisie
desésclavescachemiriennesetne les renouvelle fréquemment, goût dispendieux.
Le 9 juillet i83o. — À Trandah.
Longue marche dans laquelle je passai de Bissahir en Kanawer. La limite des
deux provinces n’est marquée par aucune division naturelle fort sensible. C’est
une arête de montagnes, entre deux petits vallons ouverts dans la vallée du
Setludje, qui les sépare. On l’appelle Manouti. Aucune différence quelque peu
générale dans les aspects du paysage au delà de cette croupe de montagnes,
ni dans la culture, ni dans la végétation spontanée.
Cette arête si médiocre qui sépare le Bissahir du Kanawer, n’a de remarquable
que sa position; elle est sur la ligne des cimes neigées de l’Himalaya, qu’interrompt
la vallée du Setludje. Ainsi le Kanawer tout entier se trouve au nord de
cette ligne. Mais celle-ci est un peu idéale; elle s’élargit ici en un massif assez
étendu, dont les sommets divers restent perpétuellement couverts de neiges; et
en approchant du Setludje, elle s’abaisse graduellement. Ce n’est qu’à une distance
horizontale de ses bords assez considérable, deux myriamètres je pense
pour le moins, que s’élèvent les cimes neigeuses. Une succession de massifs entas-*
sés les uns au-dessus des autres, et formant des espèces d’échelons dont les degres
les moins inclines sont occupés par des cultures et des villages dispersés,
y conduit par une pente générale qui, je pense, n’excède pas 25°, si elle atteint
cet angole.
Le langage de la géographie descriptive est théorique; c’est une grande faute
si les théories qu il rappelle sans cesse sont dénuées de fondement. Ainsi l’on dit
que le Setludje coupe la chaîne centrale de l’Himalaya, que sa vallée est creu-
see au travers, etc., etc., et l’on donne à penser par là que cette chaîne auparavant
était continue, et que c’est par un effort des eaux que s’y est faite cette
large trouee, comme si les montagnes avaient dû. se former primitivement avec
une continuité non interrompue.
Au nord de cette barrière idéale, le climat et les productions, ai-je dit, sont
les memés que sur la pente méridionale de la chaîne centrale, jusqu’à une assez
grande distance. Les pluies solsticiales y tombent avec la même force.
Le chemin de Sourann à Trandah est souvent fort mauvais. Il ne descend
que par des pentes très-roides dans les vallons qu’il traverse et serpente fréquemment
le long de côtes si relevées , qu’il est soutenu par dés échafaudages.
S il y avait du danger à marcher sur la crête d’escarpements verticaux,
il y en aurait ici ; car, sans être verticales , les montagnes sont trop inclinées
pour qu il fût possible de s’y retenir en cas de chute. Mais enfin il n’y a point
d’escarpements. Herbert et Gérard en voient partout.
Dans les lieux humides au bord des ruisseaux et près des villages, le Marronnier
que j ’ai appelé Æsculus hippocastanoïdes est commun ; il est identique
avec celui de la vallée de la Jumna et des abords de Kédar-Kanta. Il est probablement
aussi indigène de quelques forêts supérieures. La farine de ses châtaignes,
après qu’on l’a fait tremper trois jours dans l’eau pour en enlever l’amertume
, sert à la nourriture des habitants. Sur les bords des torrents et dans
les vallons que l’on traverse, l’Aulne est l’arbre le plus commun. C’est l’espèce
que j ai vue dans la vallée du Gange et de la Jumna, Alnus obscura. Son feuillage
exhale la même odeur aromatique que celui de l’espèce européenne. Son
bois est également rougeâtre. UneTérébinthacée (B. 1 1 33) se mêle avec cet arbre,
la même sans doute que j ’ai recueillie également dans la vallée de la Jumna, particulièrement
entre Kôtneur et Tahnao où elle est plus commune; c’est un
arbre de taille moyenne et du port le plus élégant. Un Laurier (? ) ( B. n 34),
le seul que j ’aie observé dans la vallée du Setludje, se trouve dans les mêmes
lieux. Je I ai” rencontré dans les bois jusqu’à plus de 2000“ d’élévation, et il est
à remarquer que cette pente des montagnes est exposée au nord.
Trandah est un fort village qui comprend plusieurs hameaux dispersés su
II. 26