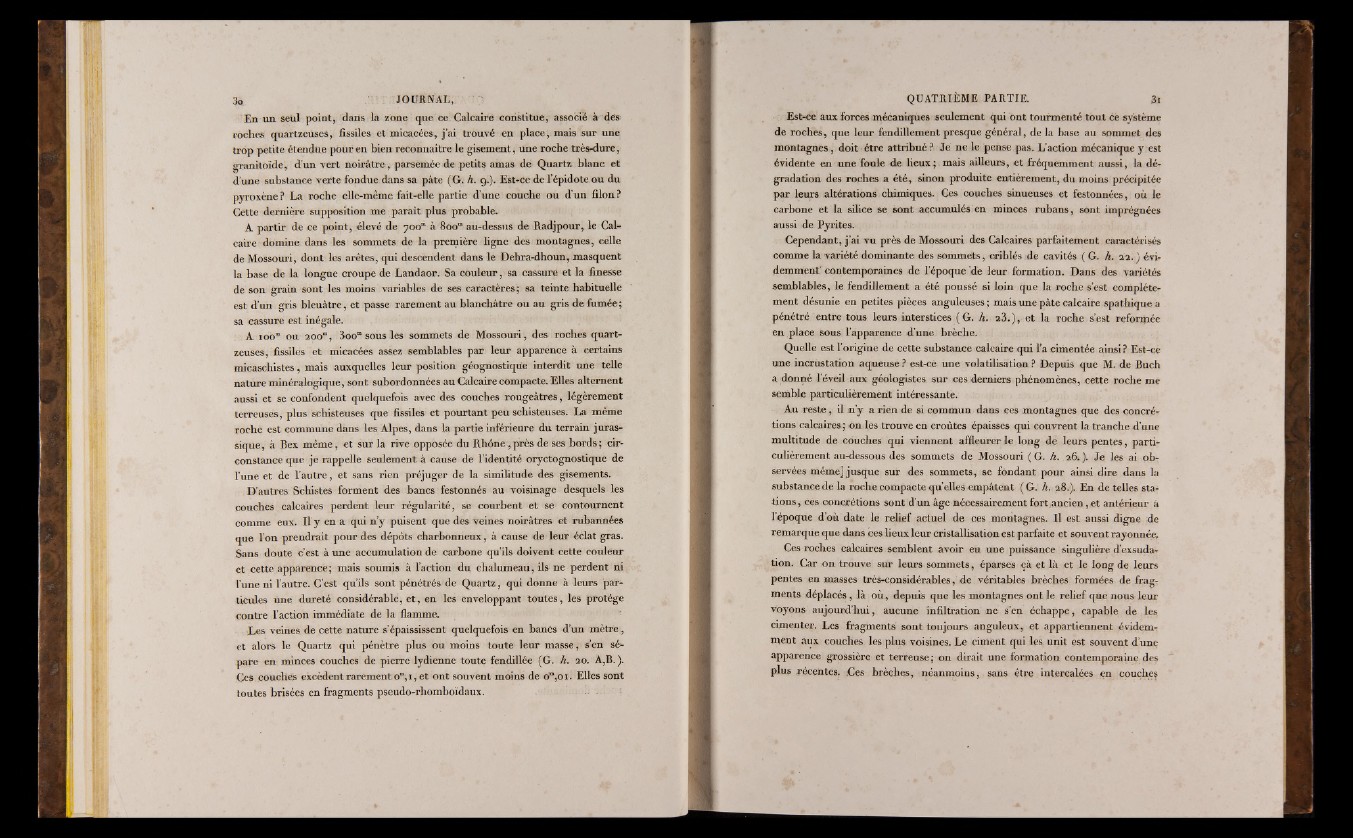
En un seùl point, ¡dans la zope que ce Calcaire constitue, associé à des
roches quartzeùseS, fissiles et micacées, j ’ai trouvé en place, mais sur une
trop petite étendue pour en bien reconnaître le gisement, une roche très-dure,
oTanitoïde, d’un vert noirâtre, parsëmée de petits amas de Quartz blanc et
d’une substance verte fondue dans sa pâte (G. h. q.). Est-ce de l’épidoteou du
pyroxène ? La roche elle-même fait-elle partie d’une couche ou d’un filon ?
Cette dernière supposition me paraît plus probable.
A partir de ce point, élevé de 700" à 800“ au-dessus de Radjpour, le Calcaire
domine dans les sommets de la première ligne des montagnes, celle
de Mossouri, dont les arêtes, qui descendent dans le Dehra-dhoun, masquent
la base de la longue croupe de Landaor. Sa couleur, sa cassure et la finesse
de son grain sont les moins variables de ses caractères; sa teinte habituelle
est d’un gris bleuâtre, et passe rarement au blanchâtre ou au gris de fumée;
sa cassure est inégale.
A 100" ou 200“ , 3oo“ sous les sommets de Mossouri, des roches quart-
zeuses, fissiles et micacées assez semblables par leur apparence à certains
micaschistes, mais auxquelles leur position géognostique interdit une telle
nature minéralogique, sont subordonnées au Calcaire compacte. Elles alternent
aussi et se confondent quelquefois avec des couches rougeâtres, légèrement
terreuses, plus Schisteuses que fissiles et pourtant peu schisteuses. La même
roche est commune dans les Alpes, dans la partie inférieure du terrain jurassique,
à Bex même, et sur là rive opposée du Rhône, près de ses bords ; circonstance
que je rappelle seulement à cause de l’identité oryctognostique de
l’une et de l ’autre, et sans rien préjuger de la similitude des gisements.
D’autres Schistes forment des bancs festonnés au voisinage desquels les
couches calcaires perdent leur régularité, se courbent et se contournent
comme eux. Il y en a qui n’y puisent que des veines noirâtres et rubannées
que l ’on prendrait pour des dépôts charbonneux, à cause de leur éclat gras.
Sans doute c’est à une accumulation de carbone qu’ils doivent cette couleur
e t cette apparence; mais soumis à l’action du chalumeau, ils ne perdent ni
l’une ni l’autre. C’est qu’ils sont pénétrés de Quartz, qui donne à leurs particules
une dureté considérable, e t, en les enveloppant toutes, les protège
contre l’action immédiate de la flamme.
Les veines de cette nature s’épaississent quelquefois en banCs d’un mètre,
et alors le Quartz qui pénètre plus ou moins toute leur masse, s’en sépare
en minces couches de pierre lydienne toute fendillée (G. h. 20. A,B. ).
Ces couches excèdent rarement o " ,i, et ont souvent moins de o“,o ï. Elles sont
toutes brisées en fragments pseudo-rhomboïdaux.
Est-ce aux forcés mécaniques seulement qui ont tourmenté tout ce système
de roches, que leur fendillement presque général, de la base au sommet des
montagnes, doit être attribué ? Je ne le pense pas. L ’action mécanique y est
évidente en une foule de lieux ; mais ailleurs, et fréquemment aussi, la dégradation
des roches a été., sinon produite entièrement, du moins précipitée
par leurs altérations chimiques. Ces couches sinueuses et festonnées, où le
carbone et la silice se sont accumulés en minces rubans, sont imprégnées
aussi de Pyrites.
Cependant, j ’ai vu près de Mossouri des Calcaires parfaitement caractérisés
comme la variété dominante des sommets, criblés de cavités ( G. h. 22. ) évidemment'
contemporaines de l’époque de leur formation. Dans des variétés
semblables, le fendillement a été poussé si loin que la roche s ’est complètement
désunie en petites pièces anguleuses; mais une pâte calcaire spathique a
pénétré entre tous leurs interstices (G . h. 23,) , et la roche s’est reformée
en place sous l’apparence d’une brèche.
Quelle est l’origine de cette substance calcaire qui l’a cimentée ainsi? Est-ce
une incrustation aqueuse ? est-cé une volatilisation ? Depuis que M. de Buch
a donné l ’éveil aux géologistes sur ces derniers phénomènes, cette roche me
semble particulièrement; intéressante.
Au reste, il n ’y arien de si commun dans ces montagnes que des concrétions
calcaires; on les trouve en croûtes épaisses qui couvrent la tranche d ’une
multitude de couches qui viennent affleurer le long de leurs pentes, particulièrement
au-dessous des sommets de Mossouri (G .h. 26. ). Je les ai observées
mêmej jusque sur des sommets, se fondant pour ainsi dire dans la
substance de la roche compacte qu’elles empâtent (G. h, 28.), En de telles stations,
ces concrétions sont d’un âge nécessairement fort ancien, et antérieur à
1 époque d’où date le relief actuel de ces montagnes. Il est aussi digne de
remarque que dans ces lieux leur cristallisation est parfaite et souvent rayonnée.
Ces roches calcaires semblent avoir eu une puissance singulière d’exsudation.
Car on trouve sur leurs sommets, éparses c i et là et le long de leurs
pentes en masses très-considérables, de véritables brèches formées de fragments
déplacés, là où, depuis que les montagnes ont le relief que nous leur
voyons aujourd’hui, aucune infiltration ne s’en échappe, capable de les
cimenter. Les fragments sont toujours anguleux, et appartiennent évidemment
aux couches les plus voisines. Le ciment qui les unit est souvent d’une
apparence grossière et terreuse; on dirait une formation contemporaine des
plus récentes. .Ces brèches, néanmoins, sans être intercalées en couches