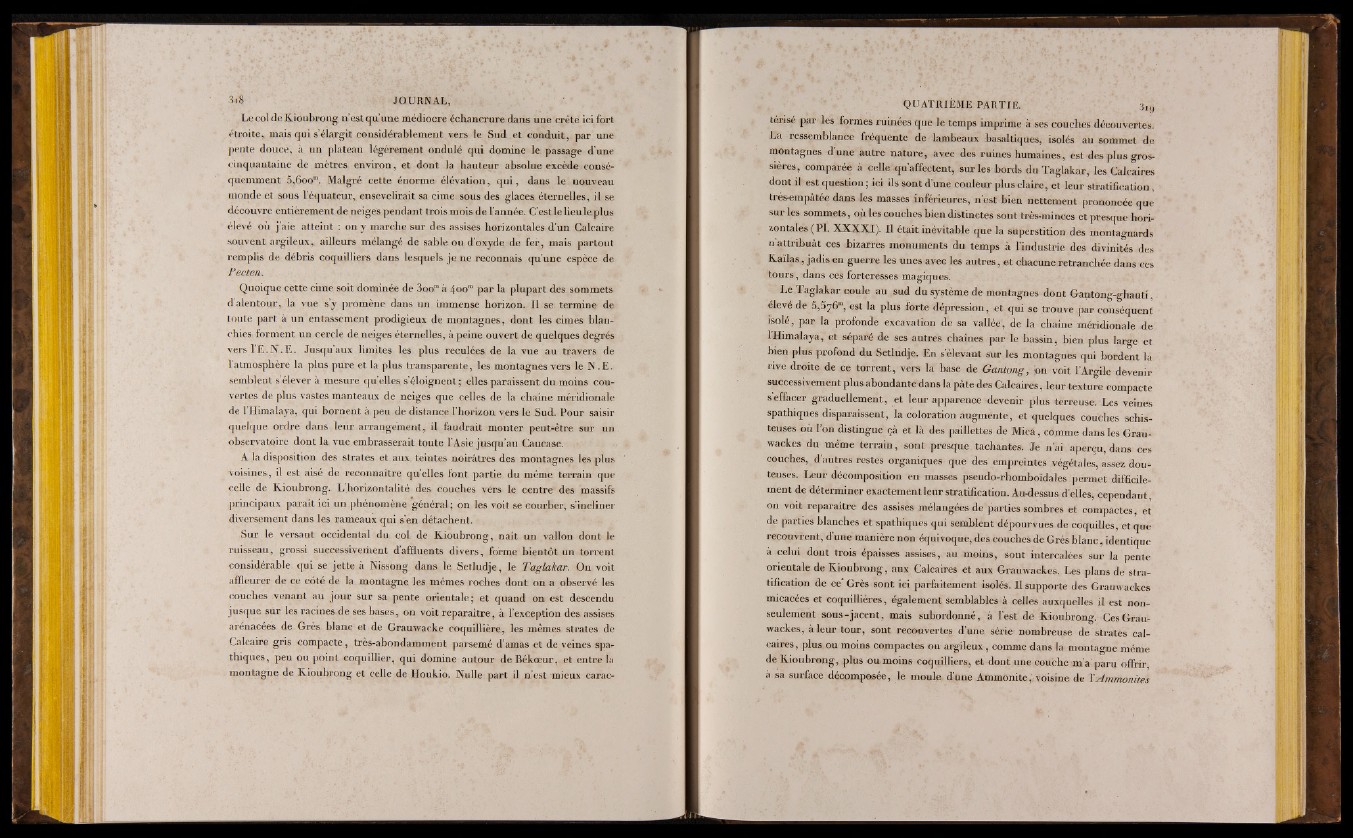
Le col de Kioubrong n’est qu’une médiocre échancrure dans une crête ici fort
étroite, mais qui s’élargit considérablement vers le Sud et conduit, par une
pente douce, à un plateau légèrement ondulé qui domine le passage d’une
cinquantaine de mètres environ, et dont la hauteur absolue excède consé-
quemment 5,600“ . Malgré cette énorme élévation, q u i, dans le nouveau
monde et sous l’équateur, ensevelirait sa cime sous des glaces éternelles, il se
découvre entièrement, de neiges pendant trois mois de l’année. C’estle lieule plus
élevé où j ’aie atteint : on y marche sur des assises horizontales d’un Calcaire
souvent argileux, ailleurs mélangé de sable ou d’oxyde de fer, mais partout
remplis de débris coquilliers dans lesquels je ne reconnais qu’une espèce de
Pecten.
Quoique cette cime soit dominée de 3qo” à 4oom par la plupart des sommets
d alentour, la vue s y promène dans un immense horizon. Il se termine de
toute part à un entassement prodigieux de montagnes,, dont les cimes blanchies
forment un cercle de neiges éternelles, à peine ouvert de quelques degrés
vers T E .N .E . Jusqu’aux limites les plus reculées de la vue au travers de
1 atmosphère la plus pure et la plus transparente, les montagnes vers le N .E .
semblent s élever à mesure qu’elles s’éloignent ; elles paraissent du moins couvertes
de plus vastes manteaux de neiges que celles de la chaîne méridionale
de l’Himalaya, qui bornent à peu de distance l’horizon vers le Sud. Pour saisir
quelque ordre dans leur arrangement, il faudrait monter peut-être sur un
observatoire dont la vue embrasserait toute l’Asie jusqu’au Caucase.
A la disposition des strates et aux teintes noirâtres des montagnes les plus
voisines, il est aisé de reconnaître qu’elles lont partie du même terrain que
celle de Kioubrong. L ’horizontalité des. couches vers le centre des massifs
principaux parait ici un phénomène général ; on les voit se courber, s’incliner
diversement dans les rameaux qui s'en détachent.
Sur le versant occidental du col de Kioubrong, naît un vallon dont le
ruissean, grossi successivement d affluents divers, forme bientôt un torrent
considérable qui se jette à Nissong dans le Setludje, le Taglakar. On voit
affleurer de ce côté de la montagne les mêmes roches dont on a observé les
couches .venant au jour sur sa pente orientale; et quand on est descendu
jusque sur les racines de ses bases, on voit reparaître, à l’exception des assises
arénacees de Grès blanc et de Grauwacke coquillière, les mêmes strates de
Calcaire gris compacte, très-abondamment parsemé d’amas et de veines spathiques,
peu ou point coquillier, qui domine autour deBékoeur, et entre la
montagne de Kioubrong et celle de Houkio. Nulle part il n’est mieux caractérisé
par les formes ruinées que le temps imprime à ses couches découvertes.
La ressemblance fréquente de lambeaux basaltiques, isolés au sommet de
montagnes d’une autre nature, avec des ruines humaines, est des plus grossières,
comparée à celle qu’affectent, sur les bords du Taglakar, les Calcaires
dont il est question ; ici ils sont d’une couleur plus claire, et leur stratification,
très-empâtée dans les masses inférieures, n’est bien nettement prononcée que
sur les sommets, où les couches bien distinctes sont très-minces et presque horizontales
(PL XX XX I). Il était inévitable que la superstition des montagnards
n attribuât ces bizarres monuments du temps à l’industrie des divinités des
K a ïlas, jadis en guerre les unes avec les autres, et chacune retranchée dans ces
tours , dans ces forteresses magiques.
Le Taglakar coule au sud du système de montagnes dont Gantong-ghauti,
élevé de 5,576“, est la plus forte dépression, et qui se trouve par conséquent
isolé, par la profonde excavation de sa vallée, de la chaîne méridionale de
1 Himalaya, et séparé de ses autres chaînes par le bassin, bien plus large et
bien plus profond du Setludje. En s’élevant sur les montagnes qui bordent la
rive droite de ce torrent, vers la base de Gantong, on voit l’Argile devenir
successivement plus abondante dans la pâte des Calcaires, leur texture compacte
seffacer graduellement, et leur apparence devenir plus terreuse. Les veines
spathiques disparaissent, la coloration augmente, et quelques couches schisteuses
où Ton distingue çà et là des paillettes de Mica, comme dans les Grauwackes
du même terrain, sont presque tachantes. Je n’ai aperçu, dans ces
couches, d’autres restes organiques que des empreintes végétales, assez douteuses.
Leur décomposition en masses pseudo-rhomboïdales permet difficilement
de déterminer exactement leur stratification. Au-dessus d’elles, cependant,
011 voit reparaître des assises mélangées de parties sombres et compactes, et
de parties blanches et spathiques qui semblent dépourvues de coquilles, et que
recouvrent, d’une manière non équivoque, des couches de Grès b lanc, identique
à celui dont trois épaisses assises, au moins, sont intercalées sur la pente
orientale de Kioubrong, aux Calcaires et aux Grauwackes. Les plans de stratification
de ce Grès sont ici parfaitement isolés. Il supporte des Grauwackes
micacées et coquillières, également semblables à celles auxquelles il est non-
seulement sous-jacent, mais subordonné, à l ’est de Kioubrong. Ces Grauwackes.,
àleu r tour, sont recouvertes d’une série nombreuse de strates calcaires
, plus ou moins compactes ou argileux, comme dans la montagne même
de Kioubrong, plus ou, moins coquilliers, et dont une couche m’a paru offrir
à sa surface décomposée, le moule d’une Ammonite, voisine de XAmmonites