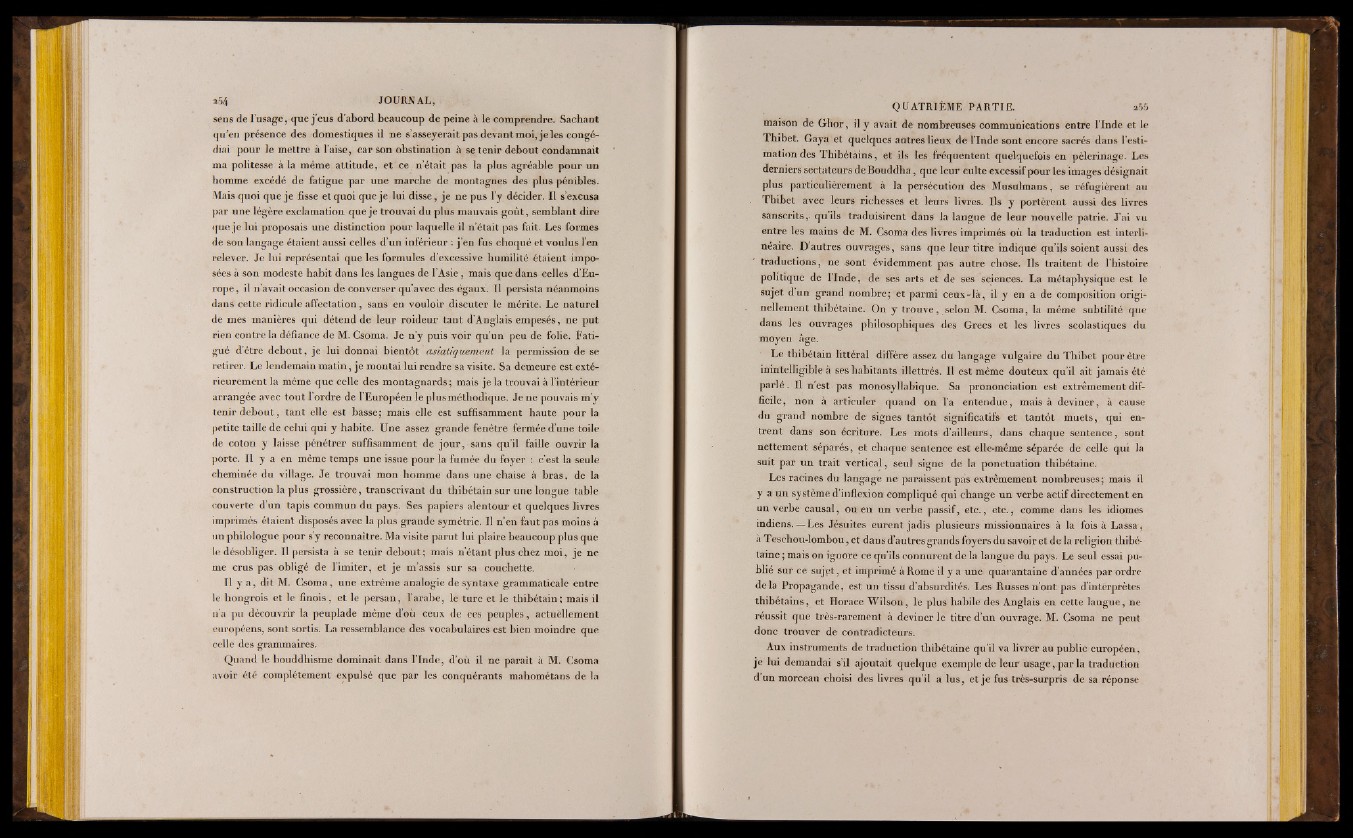
sens de l’usage, que j ’eus d’abord beaucoup de peine à le comprendre. Sachant
qu'en présence des domestiques il ne s’asseyerait pas devant moi, je les congédiai
pour le mettre à l’aise, car son obstination à se tenir debout condamnait
ma politesse à la même attitude, et ce n’était pas la plus agréable pour un
homme excédé de fatigue par une marche de montagnes des plus pénibles.
Mais quoi que je fisse et quoi que je lui disse, je ne pus l’y décider. Il s’excusa
par une légère exclamation que je trouvai du plus mauvais goût, semblant dire
que je lui proposais une distinction pour laquelle il n’était pas fait. Les formes
de son langage étaient aussi celles d’un inférieur I j ’en fus choqué et voulus l’en
relever. Je lui représentai que les formules d’excessive humilité étaient imposées
à son modeste habit dans les langues de l’Asie, mais que dans celles d’Europe
, il n’avait occasion de converser qu’avec des égaux. Il persista néanmoins
dans cette ridicule affectation, sans en vouloir discuter le mérite. Le naturel
de mes manières qui détend de leur roideur tant d’Anglais empesés, ne put
rien contre la défiance de M. Csoma. Je n’y puis voir qu’un peu de folie. Fatigué
d’être debout, je lui donnai bientôt asiatiquement la permission de se
retirer. Le lendemain matin, je montai lui rendre sa visite. Sa demeure est extérieurement
la même que celle des montagnards; mais je la trouvai à l’intérieur
arrangée avec tout l ’ordre de l’Européen le plus méthodique. Je ne pouvais m’y
tenir debout, tant elle est basse; mais elle est suffisamment haute pour la
petite taille de celui qui y habite. Une assez grande fenêtre fermée d’une toile
de coton y laisse pénétrer suffisamment de jour, sans qu’il faille ouvrir la
porte. Il y a en même temps une issue pour la fumée du foyer : c’est la seule
cheminée du village. Je trouvai mon homme dans une chaise à bras, de la
construction la plus grossière, transcrivant du thibétain sur une longue table
couverte d’un tapis commun du pays. Ses papiers alentour et quelques livres
imprimés étaient disposés avec la plus grande symétrie. Il n’en faut pas moins à
1111 philologue pour s’y reconnaître. Ma visite parut lui plaire beaucoup plus que
le désobliger. Il persista à se tenir debout ; mais n’étant plus chez moi, je ne
me crus pas obligé de limiter, et je m’assis sur sa couchette.
Il y a, dit M. Csoma, une extrême analogie de syntaxe grammaticale entre
le hongrois et le finois, et le persan, l’arabe, le turc et le thibétain; mais il
11’a pu découvrir la peuplade même d’où ceux de ces peuples, actuellement
européens, sont sortis. La ressemblance des vocabulaires est bien moindre que
celle des grammaires.
Quand le bouddhisme dominait dans l’Inde, d’où il ne paraît à M. Csoma
avoir été complètement expulsé que par les conquérants mahométans de la
maison de Ghor, il y avait de nombreuses communications entre l’Inde et le
Thibet. Gaya et quelques autres lieux de l’Inde sont encore sacrés dans l’estimation
des Thibétàins, et ils les fréquentent quelquefois en pèlerinage. Les
derniers sectateurs de Bouddha, que leur culte excessif pour les images désignait,
plus particulièrement à la persécution des Musulmans, se réfugièrent au
Thibet avec leurs richesses et leurs livres. Ils y portèrent aussi des livres
sanscrits,, qu’ils traduisirent dans lalangue de leur nouvelle patrie. J’ai vu
entre les mains de M. Csoma des livres imprimés où la traduction est interlinéaire.
D’autres ouvrages, sans que leur titre indique qu’ils soient aussi des
traductions, ne sont évidemment pas autre chose. Ils traitent de l’histoire
politique de l’Inde, de ses arts et de ses sciences. La métaphysique est le
sujet d’un grand nombre; et parmi ceu x-là, il y en a de composition originellement
thibétaine. On y trouve, selon M. Csoma, la même subtilité que
dans les ouvrages philosophiques des Grecs et les livres scolastiques du
moyen âge.
Le thibétain littéral diffère assez du langage vulgaire du Thibet pour être
inintelligible à ses habitants illettrés. Il est même douteux qu’il ait jamais été
parlé. Il n’est pas monosyllabique. Sa prononciation est- extrêmement difficile,
non à articuler quand on l’a entendue, mais à deviner, à cause
du grand nombre de signes tantôt significatifs et tantôt muets, qui entrent
dans son écriture. Les mots d’ailleurs, dans chaque sentence, sont
nettement séparés, et chaque sentence est elle-même séparée de celle qui la
suit par un trait vertical, seul signe de la ponctuation thibétaine.
Les racines du langage ne paraissent pas extrêmement nombreuses; mais il
y a un système d’inflexion compliqué qui change un verbe actif directement en
un verbe causal, ou en un verbe passif, etc., etc., comme dans les idiomes
indiens. — Les Jésuites eurent jadis plusieurs missionnaires à la fois à Lassa ,
à Teschou-lombou, et dans d’autres grands foyers du savoir et de la religion tbibé-
taine ; mais on ignore ce qu’ils connurent de la langue du pays. Le seul essai publié
sur ce sujet, et imprimé à Rome il y a une quarantaine d’années par ordre
de la Propagande, est un tissu d'absurdités. Les Russes n’ont pas d’intèrprètes
thibétàins, et Horace Wilson, le plus habile des Anglais en cette langue, ne
réussit que très-rarement à deviner le titre d’un ouvrage. M. Csoma ne peut
donc trouver de contradicteurs.
Aux instruments de traduction thibétaine qu’il va livrer au public européen,
je lui demandai s’il ajoutait quelque exemple de leur usage,.par la traduction
d’un morceau choisi des livres qu’il a lus, et je fus très-surpris de sa réponse