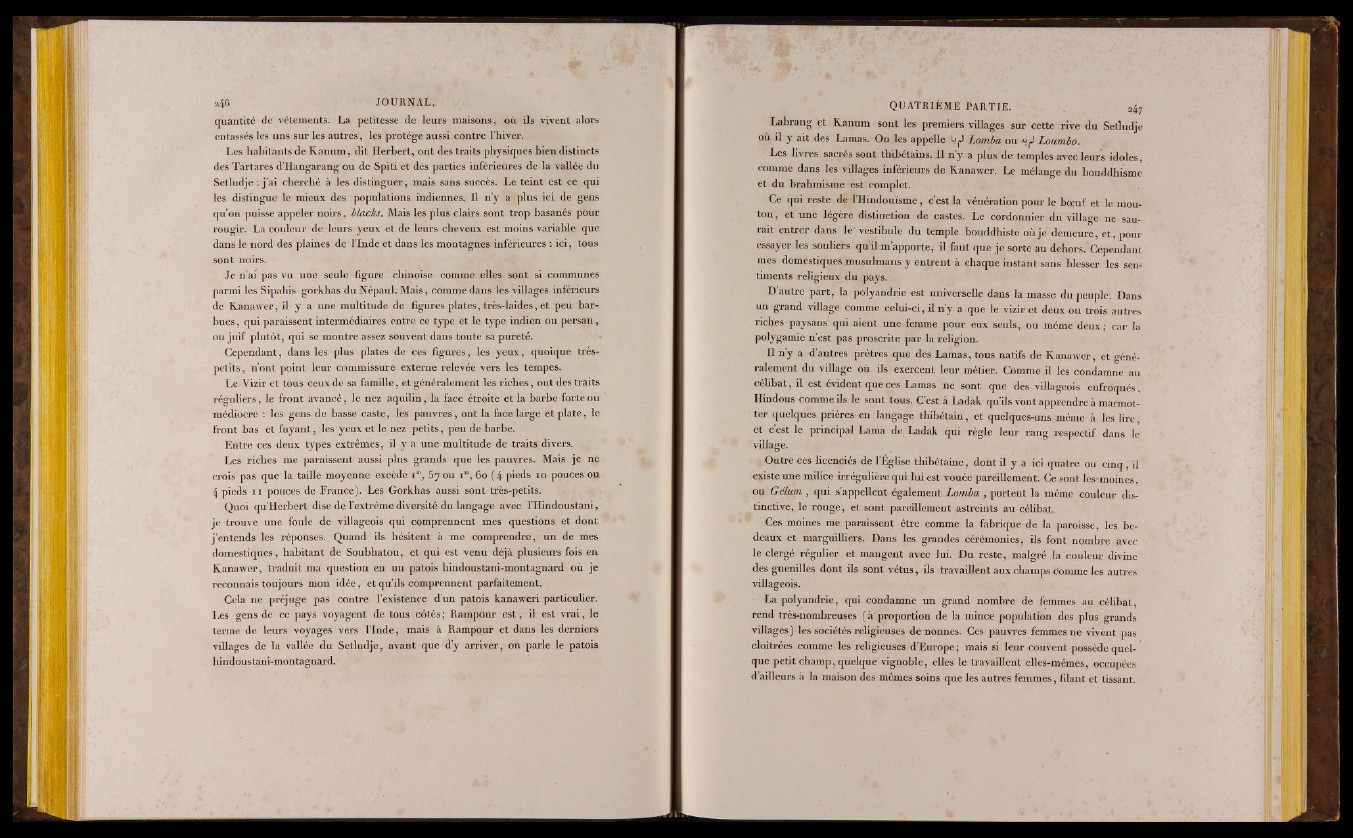
quantité de vêtements. La petitesse de leurs maisons, où ils vivent alors
entassés les uns sur les autres, les protège aussi contre l'hiver.
Les habitants de Ranum, dit Herbert, ont des traits physiques bien distincts
des Tartares d’Hangarang ou de Spiti et des parties inférieures de la vallée du
Setludje : j ’ai cherché à les distinguer, mais sans succès. Le teint est ce qui
les distingue le mieux des populations indiennes. Il n’y a plus ici de gens
qu’on puisse appeler noirs, blacks. Mais les plus clairs sont trop basanés pour
rougir. La couleur de leurs yeux et de leurs cheveux est moins variable que
dans le nord des plaines de l’Inde et dans les montagnes inférieures : ic i, tous
sont noirs.
Je n’ai pas vu une seule figure chinoise comme elles sont si communes
parmi les Sipahis gorkhas du Nèpaul. Mais, comme dans les villages inférieurs
de Ranawer, il y a une multitude de figures plates, très-laides, et peu barbues
, qui paraissent intermédiaires entre ce type et le type indien ou persan,
ou ju if plutôt, qui se montre assez souvent dans toute sa pureté.
Cependant, dans les plus plates de ces figures, les y eu x , quoique très-
petits , n’ont point leur commissure externe relevée vers les tempes.
Le Vizir et tous ceux de sa famille, et généralement les riches, ont des traits
réguliers, le front avancé, le nez aquilin, la face étroite et la barbe forte ou
médiocre : les gens de basse caste, les pauvres, ont la face large et plate, le
front bas et fuyant, les yeux et le nez petits, peu de barbe.
Entre ces deux types extrêmes, il y a une multitude de traits divers.
Les riches me paraissent aussi plus grands que les pauvres. Mais je ne
crois pas que la taille moyenne excède i" , 5y ou im, 60 (4 pieds 10 pouces ou
4 pieds 11 pouces de France). Les Gorkhas aussi sont très-petits.
Quoi qu’Herbert dise de l’extrême diversité du langage avec l’Hindoustani,
je trouve une foule de villageois qui comprennent mes questions et dont
j ’entends les réponses. Quand ils hésitent à me comprendre, un de mes
domestiques, habitant de Soubhatou, et qui est venu déjà plusieurs fois en
Ranawer, traduit ma question en un patois hindoustani-montagnard où je
reconnais toujours mon idée, et qu’ils comprennent parfaitement.
Cela ne préjuge pas contre l’existence d’un patois kanaweri particulier.
Les gens de ce pays voyagent de tous côtés; Rampour e s t, il est vrai, le
terme de leurs voyages vers l’Inde, mais à Rampour et dans les derniers
villages de la vallée du Setludje, avant que d’y arriver, on parle le patois
hindoustani-montagnard.
Labrang et Ranum sont les premiers villages sur cette rive du Setludje
où il y ait des Lamas. On les appelle Lomba ou Loumbo.
Les livres sacrés sont thibetains. Il n y a plus de temples avec leurs idoles,
comme dans les villages inférieurs de Ranawer. Le mélange du bouddhisme
et du brahmisme est complet.
Ce qui reste de l'Hindouisme, c’est la vénération pour le boeuf et le mouton,
et une légère distinction de castes. Le cordonnier du village ne saurait
entrer dans le vestibule du temple bouddhiste où je demeure, e t , pour
essayer les souliers qu’il m’apporte, il faut que je sorte au dehors. Cependant
mes domestiques musulmans y entrent à chaque instant sans blesser les sen-
timents religieux du pays.
D’autre part, la polyandrie est universelle dans la masse du peuple. Dans
un grand village comme celui-ci, il n’y a que le vizir et deux ou trois autres
riches paysans qui aient une femme pour eux seuls, ou même deux; car la
polygamie n’est pas proscrite par la religion.
Il n’y a d’autres prêtres que des Lamas, tous natifs de Ranawer, et généralement
du village où ils exercent leur métier. Comme il les condamne au
célibat, il est évident que ces Lamas ne sont que des villageois enfroqués,
Hindous comme ils le sont tous. C’est à Ladak qu’ils vont apprendre à marmotter
quelques prières'en langage thibétain, et quelques-uns même à les lire,
et c est le principal Lama (le Ladak qui règle leur rang respectif dans le
village.
Outre ces licenciés de l’Église thibétaine, dont il y a ici quatre ou c in q , il
existe une milice irrégulière qui lui est vouée pareillement. Ce sont les*moines
ou Gélum, qui s’appellent également Lomba , portent la même couleur distinctive,
le rouge, et sont pareillement astreints au célibat.
Ces moines me paraissent être comme la fabrique de la paroisse, les bedeaux
et marguilliers. Dans les grandes cérémonies, ils font nombre avec
le clergé régulier et mangent avec lui. Du reste, malgré la couleur divine
des guenilles dont ils sont vêtus, ils travaillent aux champs comme les autres
villageois.
La polyandrie, qui condamne un grand nombre de femmes au célibat,
rend très-nombreuses (à proportion de la mince population des plus grands
villages) les sociétés religieuses de nonnes. Ces pauvres femmes ne vivent pas
cloîtrées comme les religieuses d’Europe ; mais si leur couvent possède quelque
petit champ, quelque vignoble, elles le travaillent elles-mêmes, occupées
d ailleurs à la maison des mêmes soins que les autres femmes, filant et tissant.