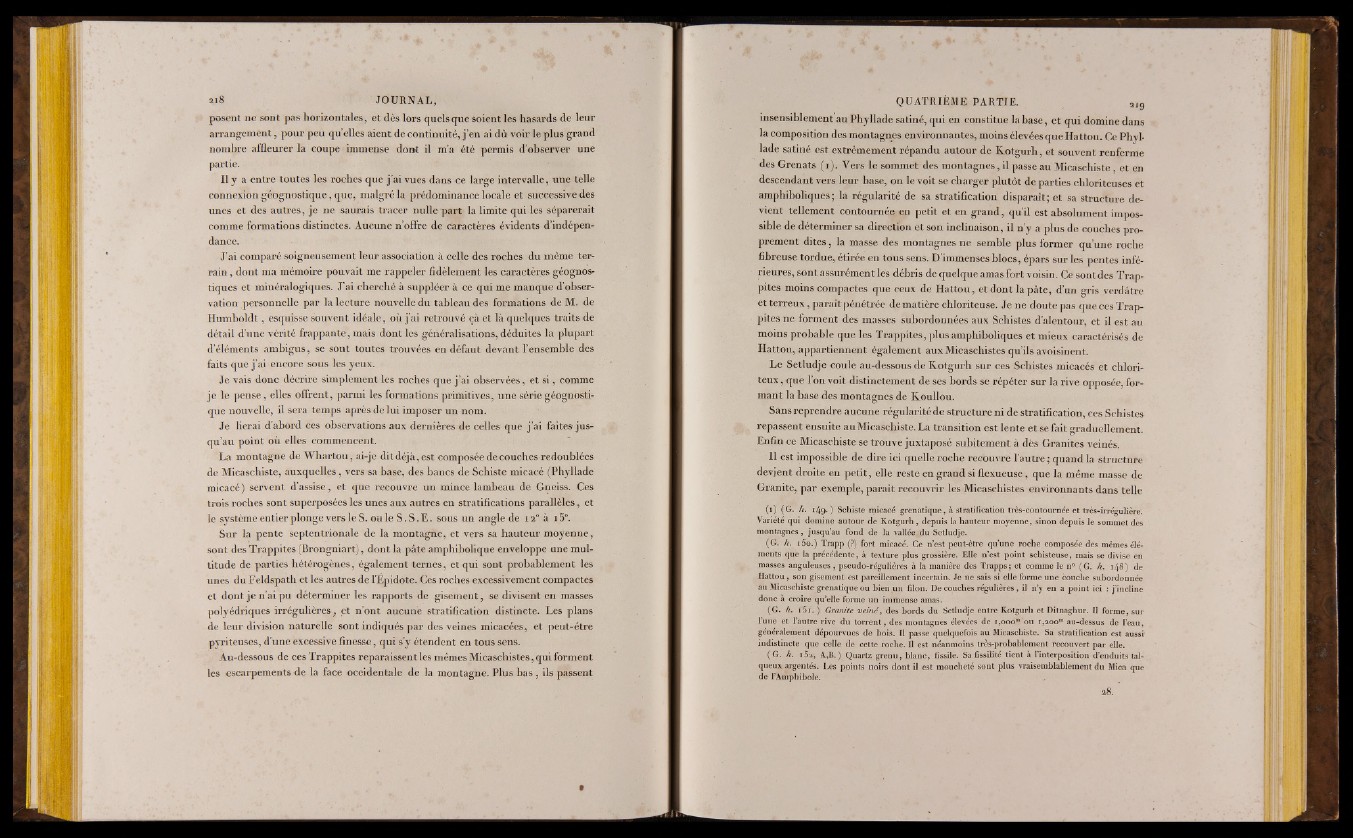
posent ne sont pas horizontales, et dès lors quels que soient les hasards de leur
arrangement, pour peu qu’elles aient de continuité, j ’en ai dû voir le plus grand
nombre affleurer la coupe immense do»t il m’a été permis d’observer une
partie.
Il y a entre toutes les roches que j'ai vues dans ce large intervalle, une telle
connexion géognostique, que, malgré la prédominance locale et successive des
unes et des autres, je ne saurais tracer nulle part la limite qui les séparerait
comme formations distinctes. Aucune n’offre de caractères évidents d'indépendance.
J’ai comparé soigneusement leur association à celle des roches du même terrain
, dont ma mémoire pouvait me rappeler fidèlement les caractères géognos-
tiques et minéralogiques. J’ai cherché à suppléer à ce qui me manque d’observation
personnelle par la lecture nouvelle du tableau des formations de M. de
Humboldt, esquisse souvent idéale, où j ’ai retrouvé çà et là quelques traits de
détail d’une vérité frappante, mais dont les généralisations, déduites la plupart
d'éléments ambigus, se sont toutes trouvées en défaut devant l’ensemble des
faits que j ’ai encore sous les yeux.
Je vais donc décrire simplement les roches que j ’ai observées, et si-, comme
je le pense, elles offrent, parmi les formations primitives, une série géognostique
nouvelle, il sera temps après de lui imposer un nom.
Je lierai d'abord ces observations aux dernières de celles que j ’ai faites jusqu’au
point où elles commencent.
La montagne de Whartou, ai-je ditdéjà,est composée de couches redoublées
de Micaschiste, auxquelles, vers sa base, des bancs de Schiste micacé (Phyllade
micacé) servent d’assise, et que recouvre un mince lambeau de Gneiss. Ces
trois roches sont superposées les unes aux autres en stratifications parallèles, et
le système entier plonge vers le S. ou le S . S . E . sous un angle de 12° à 15°.
Sur la pente septentrionale de la montagne, et vers sa hauteur moyenne,
sont des Trappites (Brongniart), dont la pâte amphibolique enveloppe une multitude
de parties hétérogènes, également ternes, et qui sont probablement les
unes du Feldspath et les autres de l’Épidote. Ces roches excessivement compactes
et dont je n’ai pu déterminer les rapports de gisement, se divisent en masses
polyédriques irrégulières, et n’ont aucune stratification distincte. Les plans
de leur division naturelle sont indiqués par des veines micacées, et peut-être
pyriteuses, d'une excessive finesse, qui s’y étendent en tous sens.
Au-dessous de ces Trappites reparaissent les mêmes Micaschistes, qui forment
les escarpements de la face occidentale de la montagne. Plus b a s , ils passent
insensiblement au Phyllade satiné, qui en constitue la base, et qui domine dans
la composition des montagnes environnantes, moins élevées que Hattou. Ce Phyllade
satiné est extrêmement répandu autour de Kotgurh, et souvent renferme
des Grenats (i|j|Vers le sommet des montagnes, il passe au Micaschiste , et en
descendant vers leur base, on le voit se charger plutôt de parties chloriteuses et
amphiboliques; la régularité de sa stratification disparait; et sa structure devient
tellement contournée, en petit et en grand, qu’il est absolument impossible
de déterminer sa direction et son inclinaison, il n’y a plus de couches proprement
dites, la masse des montagnes ne semble plus former qu’une roche
fibreuse tordue, étirée en tous sens. D’immenses blocs, épars sur les pentes inférieures,
sont assurément les débris de quelque amas fort voisin. Ce sontdes Trappites
moins compactes que ceux de Hattou, et dont la pâte, d’un gris verdâtre
et terreux, paraît pénétrée de matière chloriteuse. Je ne doute pas que ces Trappites
ne forment des masses subordonnées aux Schistes d’alentour, et il est au
moins probable que les Trappites, plus amphiboliques et mieux caractérisés de
Hattou, appartiennent également aux Micaschistes qu’ils avoisinent.
Le Setludje coule au-dessous de Rotgurh sur ces Schistes micacés et chlori-
teux, que l’on voit distinctement de ses bords se répéter sur la rive opposée, formant
la base des montagnes de Koullou.
Sans reprendre aucune régularité de structure ni de stratification, ces Schistes
repassent ensuite au Micaschiste. La transition est lente et se fait graduellement.
Enfin ce Micaschiste se trouve juxtaposé subitement à dès Granités veinés.
I l est impossible de dire ici quelle roche recouvre l’autre ; quand la structure
devient droite en petit, elle reste en grand siflexueuse, que la même masse de
Granité, par exemple, paraît recouvrir les Micaschistes environnants dans telle
( 0 (G- h. 149.) Schiste micacé grenatique, à stratification très-contournée et très-irrégulière.
Variété qui domine autour de Kotgurh, depuis la hauteur moyenne, sinon depuis le sommet des
montagnes, jusqu’au fond de la vallée.du Setludje.
(G. h. 15b-) Trapp (?) fort micacé. Ce n’est peut-être qu’une roche composée des mêmes éléments
que la précédente, à texture plus grossière. Elle n’est point schisteuse, mais se divise en
masses anguleuses , pseudo-régulières à la manière des Trapps; et comme le n° (G. h. 148) de
Hattou, son gisement est pareillement incertain. Je ne sais si elle forme une couche subordonnée
au Micaschiste grenatique ou bien un filon. De couches régulières, il n’y en a point ici : j ’incline
donc à croire qu’elle forme un immense amas.
(G. h. 15f . ) Granité veiné, des bords du Setludje entre Kotgurh et Ditnaghur. Il forme, sur
l’une et l’autre rive du torrent, des montagnes élevées de i,ooom ou i,aoom au-dessus de l’eau,
généralement dépourvues de bois. Il passe quelquefois au Micaschiste. Sa stratification est aussi-
indistincte que celle de cette roche. Il est néanmoins très-probablement recouvert par elle.
(G. h. 1S11, A,B.) Quartz grenu, blanc, fissile. Sa fissilité tient à l’interposition d’enduits tal-
queux argentés. Lès points noirs dont il est moucheté sont plus vraisemblablement du Mica que
de l’Amphibole.