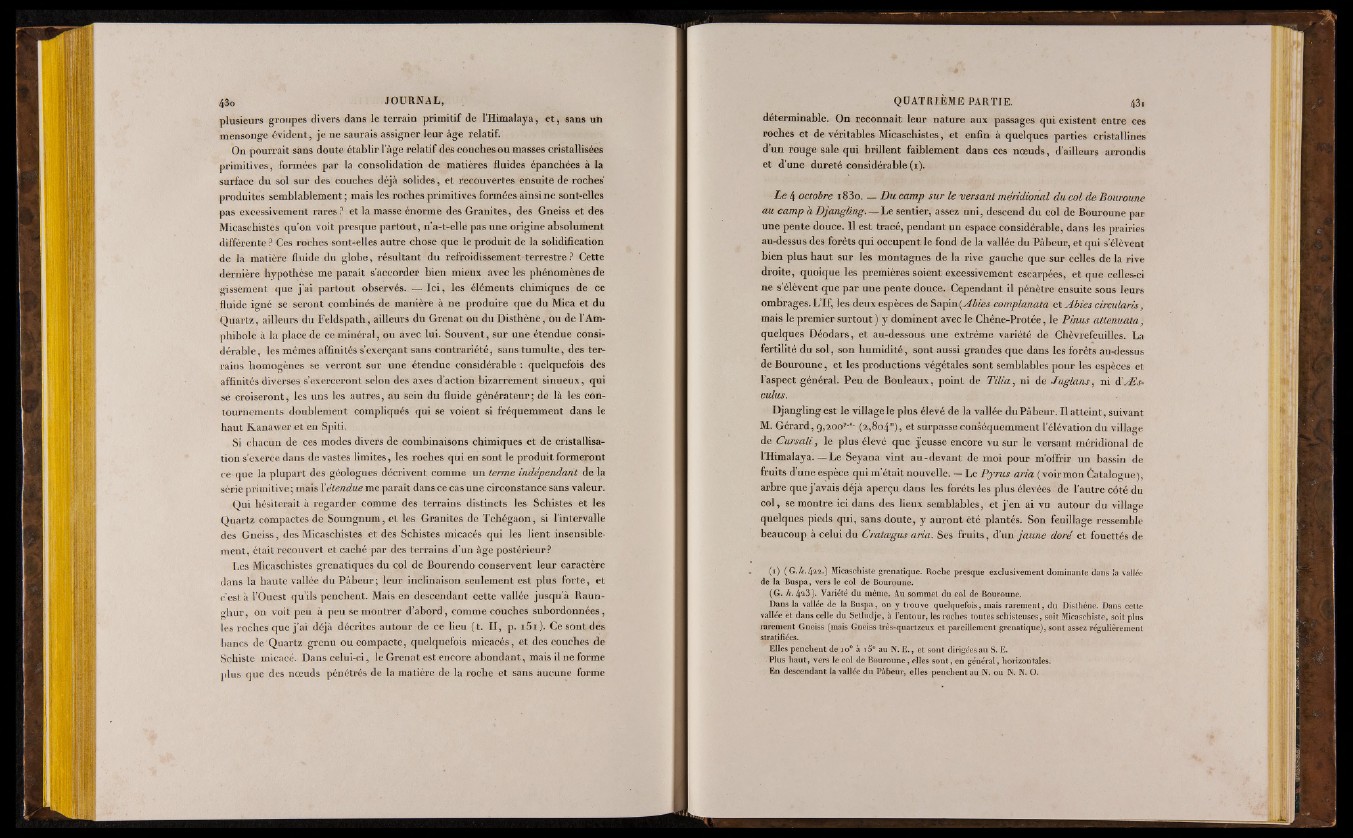
plusieurs groupes divers dans le terrain primitif de l’Himalaya, e t , sans un
mensonge évident, je ne saurais assigner leur âge relatif.
On pourrait sans doute établir l’âge relatif des couches ou masses cristallisées
primitives, formées par la consolidation de matières fluides épanchées à la
surface du sol sur des couches déjà solides, et recouvertes ensuite de roches
produites semblablement ; mais les roches primitives formées ainsi ne sont-elles
pas excessivement rares ? et la masse énorme des Granités, des Gneiss et des
Micaschistes qu'on voit presque partout, n’a-t-elle pas une origine absolument
différente ? Ces roches sont-elles autre chose que le produit de la solidification
de la matière fluide du globe, résultant du refroidissement terrestre ? Cette
dernière hypothèse me parait s’accorder bien mieux avec les phénomènes de
gissement que j ’ai partout observés. ^ I c i, les éléments chimiques de ce
fluide igné se seront combinés de manière à ne produire que du Mica et du
Quartz, ailleurs du Feldspath, ailleurs du Grenat où du Disthène, ou de l’Amphibole
à la place de ce minéral, ou avec lui. Souvent, sur une étendue considérable,
les mêmes affinités s’exerçant sans contrariété, sans tumulte, des terrains
homogènes se verront sur une étendue considérable : quelquefois des
affinités diverses s’exerceront selon des axes d’action bizarrement sinueux, qui
se croiseront, les uns les autres, au sein du fluide générateur ; de là les contournements
doublement compliqués qui se voient si fréquemment dans le
haut Kanawer et en Spiti.
Si chacun de ces modes divers de combinaisons chimiques et de cristallisation
s’exerce dans de vastes limites, les roches qui en sont le produit formeront
ce que la plupart des géologues décrivent comme un terme indépendant de la
série primitive ; mais Xétendue me paraît dans ce cas une circonstance sans valeur.
Qui hésiterait à regarder comme des terrains distincts les Schistes et les
Quartz compactes de Soungnum, et les Granités de Tchégaon, si l’intervalle
des Gneiss, des Micaschistes et des Schistes micacés qui les lient insensiblement,
était recouvert et caché par des terrains d’un âge postérieur?
Les Micaschistes grenatiques du col de Bourendo conservent leur caractère
dans la haute vallée du Pâbeur; leur inclinaison seulement est plus forte, et
c’est à l’Ouest qu’ils penchent. Mais en descendant cette vallée jusqu’à Raun-
gliur, on voit peu à peu se montrer d’abord, comme couches subordonnées,
les roches que j'ai déjà décrites autour de ce lieu (t. II, p. 15 1 ). Ce sont dés
bancs de Quartz grenu ou compacté, quelquefois micacés, et des couches de
Schiste micacé. Dans celui-ci, le Grenat est encore abondant, mais il ne forme
plus que des noeuds pénétrés de la matière de la roche et sans aucune forme
déterminable. On Reconnaît leur nature aux passages qui existent entre ces
roches et de véritables Micaschistes, et enfin à quelques parties cristallines
d’un rouge sale qui brillent faiblement dans ces noeuds, d’ailleurs arrondis
et d’une dureté considérable (i).
Le 4 octobre i 83o. — Du camp sur le versant méridional du col de Bouroune
au camp a Djangling.— Le sentier, assez uni, descend du col de Bouroune par
une pente douce. 11 est tracé, pendant un espace considérable, dans les prairies
au-dessus des forêts qui occupent le fond de la vallée du Pâbeur, et qui s’élèvent
bien plus haut sur les montagnes de la rive gauche que sur celles de la rive
droite, quoique les premières soient excessivement escarpées, et que celles-ci
ne s’élèvent que par une pente douce. Cependant il pénètre ensuite sous leurs
ombrages. L'If, les deux espèces de Sapin [Abies complanata et Abies circularis,
mais le premier surtout) y dominent avec le Chêne-Protée, le Pinus atlenuata,
quelques Déodars, et au-dessous une extrême variété de Chèvrefeuilles. La
fertilité du sol, son humidité, sont aussi grandes que dans les forêts au-dessus
de Bouroune, et les productions végétales sont semblables pour les espèces et
l’aspect général. Peu de Bouleaux, point de Tilia, ni de Juglans, ni d ' Æs-
culus.
Djangling est le village le plus élevé de la vallée du Pâbeur. Il atteint, suivant
M. Gérard, 9,200P‘ - (2,804“) , et surpasse conséquemment l'élévation du village
de Cursali, le plus élevé que j ’eusse encore vu sur le versant méridional de
l’Himalaya. — Le Seyana vint au-devant de moi pour m’offrir un bassin de
fruits d’une espèce qui m’était nouvelle. — Le Pyrus aria (voir mon Catalogue),
arbre que j ’avais déjà aperçu dans les forêts les plus élevées de l’autre côté du
co l, se montre ici dans des lieux semblables, et j’en ai z J vu autour du villa5e5e
quelques pieds qui, sans doute, y auront été plantés. Son feuillage ressemble
beaucoup à celui du Cratoegus aria. Ses fruits, d’un jaune doré et fouettés de
(ï) (G./i. 4aa.) Micaschiste grenatique. Roche presque exclusivement dominante dans ]a vallée
de la Buspa, vers le col de Bouroune.
(G. h. 4*3 ). Variété du même. Au sommet du col de Bouroune.
Dans la vallée de la Buspa, on y trouve quelquefois, mais rarement, du Disthène. Dans cette
vallée et dans celle du. Setludje, à l’en tour, les roches toutes schisteuses, soit Micaschiste, soit plus
rarement Gneiss (mais Gneiss très-quartzeux et pareillement grenatique), sont assez régulièrement
stratifiées.
Elles penchent de io° à i 5° au N. E ., et sont dirigées au S. E.
Plus haut, vers le col de Bouroune, elles sont, en général , horizontales.
En descendant la vallée du Pâbeur, elles penchent au N. ou N. N. O.