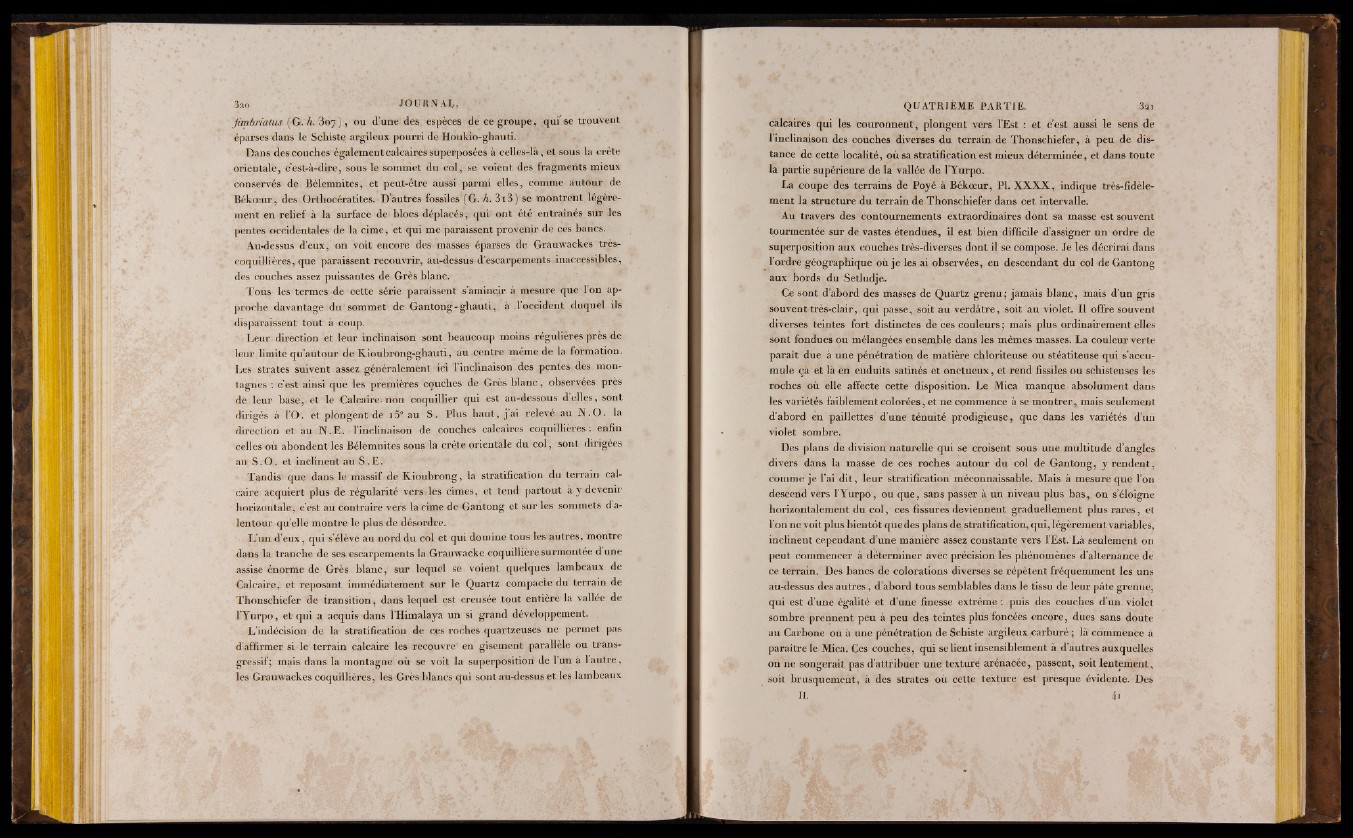
fimbriatus (G. A. 307), ou d’une des espèces de ce groupe, qui se trouvent
éparses dans le Schiste argileux pourri de Houkio-ghauti.
Dans des couches également calcaires superposées à celles-là, et sous la crête
orientale, c’est-à-dire, sous le sommet du col, se voient, des fragments mieux
conservés de Bélemnites, et peut-être aussi parmi elles, comme autour de
Békoeur, des Orthocératites. D’autres fossiles ( G. A. 3 i 3 ) se montrent légèrement
en relief à la surface de blocs déplacés ; qui ont été entraînés sur les
pentes occidentales de la cime , et qui me paraissent provenir de ces bancs.
Au-dèssus d’eux, on voit eucore des masses éparses de Grauwackes très-
coquillières, que paraissent recouvrir, au-dessus d’escarpements inaccessibles,
des couches assez puissantes de Grès blanc.
Tous les termes de cette série paraissent s’amincir à mesure que Ion approche
davantage du sommet de Gantong-ghauti, à l’occident duquel ils
disparaissent tout à coup.
Leur direction et leur inclinaison sont beaucoup moins régulières près de
leur limite qu’autour de Rioubrong-ghauti, au centre même de la formation.
Les strates suivent assez généralement ici 1 inclinaison des pentes des montagnes
: c’est ainsi que les premières couches de Grès b lan c , observées près
de leur base, et le Calcaire-non coquillier qui est au-dessous déliés, sont
dirigés à l’O. et plongent de i 5° au S . Plus haut, j ai relevé au N .O . la
direction et au N .E . l’inclinaison de couches calcaires coquillières: enfin
celles où abondent les Bélemnites sous la crête orientale du col, sont dirigées
au S . O . et inclinent au S . E .
Tandis que dans le massif de Kioubrong, la stratification du terrain calcaire
acquiert plus de régularité vers les cimes, et tend partout à y devenir
horizontale, c’est au contraire vers la cime de Gantong et sur les sommets d a-
lentour qu elle montre le plus de désordre.
L ’un d’eux, qui s’élève au nord du col et qui domine tous les autres, montre
dans la tranche de ses escarpements la Grauwacke coquillière surmontée d une
assise énorme de Grès blanc, sur lequel se voient quelques lambeaux de
Calcaire, et reposant immédiatement sur le Quartz compacte du terrain de
Thonschiefer de transition, dans lequel est creusée tout entière la vallée de
l’Yurpo, et qui a acquis dans l’Himalaya un si grand développement.
L ’indécision de la stratification de ces roches quartzeuses ne permet pas
d’affirmer si le terrain calcaire les recouvre en gisement parallèle ou trans-
gressif; mais dans la montagne où se voit la superposition de l’un à 1 autre,
les Grauwackes coquillières, les Grès blancs qui sont au-dessus et les lambeaux
calcaires qui les couronnent , plongent vers l’Est : et c’est aussi le sens de
l’inclinaison des couches diverses du terrain de Thonschiefer, à peu de distance
de cette localité, où sa stratification est mieux déterminée, et dans toute
la partie supérieure de la vallée de l’Yurpo.
La coupe des terrains de Poyé à Békoeur, Pl. X X X X , indique très-fidèlement
la structure du terrain de Thonschiefer dans cet intervalle.
Au travers des contournements extraordinaires dont sa masse est souvent
tourmentée sur de. vastes étendues, il est bien difficile d’assigner un ordre de
superposition aux couches très-diverses dont il se Compose. Je les décrirai dans
l’ordre géographique où je les ai observées, en descendant du col de Gantong
aux bords du Setludje.
Ce sont d’abord des masses de Quartz grenu; jamais blanc, mais d’un gris
souvent très-clair, qui passe, soit au verdâtre, soit au violet. Il offre souvent
diverses teintes fort distinctes de ces couleurs ; mais plus ordinairement elles
sont fondues ou mélangées ensemble dans les mêmes masses. La couleur verte
paraît due à une pénétration de matière chloriteuse ou stéatiteuse qui s’accumule
çà et là en enduits satinés et onctueux, et rend fissiles ou schisteuses les
roches où elle affecte cette disposition. Le Mica manque absolument dans
les variétés faiblement colorées, et ne commence à se montrer, mais seulement
d’abord en paillettes d’une ténuité prodigieuse, que dans les variétés d’un
violet sombre.
Des plans de division naturelle qui se croisent sous une multitude d’angles
divers dans la masse de ces roches autour du col de Gantong, y rendent,
comme je l’ai dit, leur stratification méconnaissable. Mais à mesure que l’on
descend vers l’Yurpo, ou que, sans passer à un niveau plus bas, on s’éloigne
horizontalement du c o l, ces fissures deviennent graduellement plus rares, et
l’on ne voit plus bientôt que des plans de stratification, qui, légèrement variables,
inclinent cependant d’une manière assez constante vers l’Est. Là seulement on
peut commencer à déterminer avec précision les phénomènes d’alternance de
ce terrain. Des bancs de colorations diverses se répètent fréquemment les uns
au-dessus des autres, d’abord tous semblables dans le tissu de leur pâte grenue,
qui est d’une égalité et d’une finesse extrême : puis des couches d’un violet
sombre prennent peu à peu des teintes plus foncées encore, dues sans doute
au Carbone ou à une pénétration de Schiste argileux carburé ; là commence à
paraître le Mica. Ces couches, qui se lient insensiblement à d’autres auxquelles
on ne songerait pas d’attribuer une texture arénacée, passent, soit lentement,
soit brusquement, à des strates où cette texture est presque évidente. Des
II. . ' ‘ 4 i