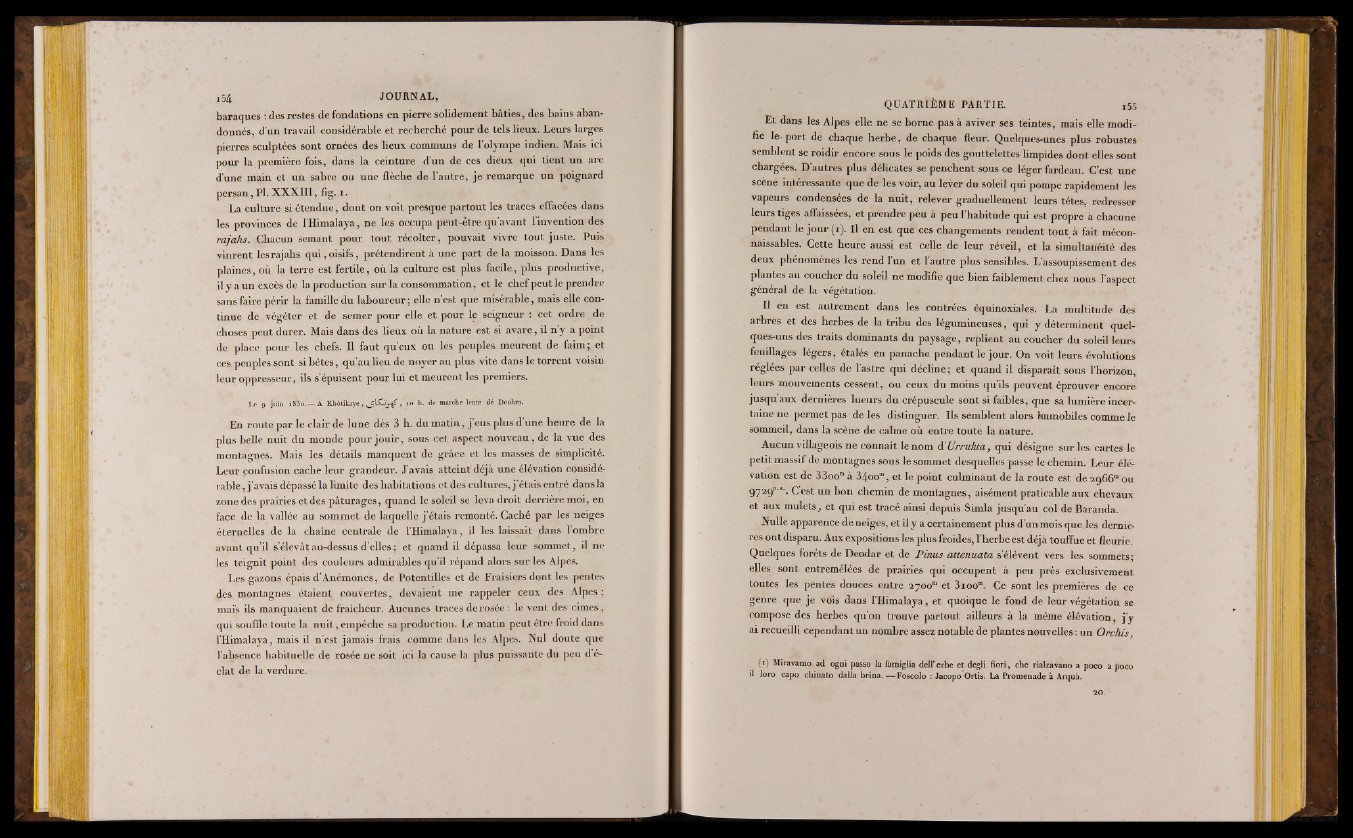
baraques : des restes de fondations en pierre solidement bâties , des bains abandonnés,
d’un travail considérable et recherché pour de tels lieux. Leurs larges
pierres sculptées sont ornées des lieux communs de l’olympe indien. Mais ici
pour la première fois, dans la ceinture d’un de ces dieux qui tient un arc
d’une main et un sabre ou une flèche de l’autre, je remarque un poignard
persan, Pl. XX.XIII, fi g. 1.
La culture si étendue, dont on voit presque partout les traces effacées dans
les provinces de l’Himalaya, ne les occupa peut-être qu’avant l’invention des
rajahs. Chacun semant pour tout récolter, pouvait vivre tout juste. Puis
vinrent lesrajahs q u i, oisifs, prétendirent à une part de la moisson. Dans les
plaines, où la terre est fertile, où la culture est plus facile, plus productive,
il y a un excès de la production sur la consommation, et le chef peut le prendre
sans faire périr la famille du laboureur ; elle n’est que misérable, mais elle continue
de végéter et de semer pour elle et pour le seigneur : cet ordre de
choses peut durer. Mais dans des lieux où la nature est si avare, il n’y a point
de place pour les chefs. Il faut qu’eux ou les peuples meurent de faim; et
ces peuples sont si bêtes, qu’au lieu de noyer au plus vite dans le torrent voisin
leur oppresseur, ils s’épuisent pour lui et meurent les premiers.
Le 9 juin i83o. — A Khôtikaye, , 10 h. de marche lente dé Deohra.
En route par le clair de lune dès 3 h. du matin, j ’eus plus d’une heure de la
plus belle nuit du monde pour jouir, sous cet aspect nouveau, de la vue des
montagnes. Mais les détails manquent de grâce et les masses de simplicité.
Leur confusion cache leur grandeur. J’avais atteint déjà une élévation considérable
, j ’avais dépassé la limite des habitations et des cultures, j ’étais entré dans la
zone des prairies et des pâturages, quand le soleil se leva droit derrière moi, en
face de la vallée au sommet de laquelle j ’étais remonté. Caché par les neiges
éternelles de la chaîne centrale de l’Himalaya, il les laissait dans l’ombre
avant qu’il s’élevât au-dessus d’elles ; et quand il dépassa leur sommet, il ne
les teignit point des couleurs admirables qu’il répand alors sur les Alpes.
Les gazons épais d’Anémones, de Potentilles et de Fraisiers dont les pentes
des montagnes étaient couvertes, devaient me rappeler ceux des Alpes;
mais ils manquaient de fraîcheur. Aucunes traces de rosée : le vent des cimes,
qui souffle toute la n u it, empêche sa production. Le matin peut être froid dans
l’Himalaya, mais il n’est jamais frais comme dans les Alpes. Nul doute que
l’absence habituelle de rosée ne soit ici la cause la plus puissante du peu d'éclat
de la verdure.
Et dans les Alpes elle ne se borne pas à aviver ses teintes, mais elle modifie
le- port de chaque herbe, de chaque fleur. Quelques-unes plus robustes
semblent se roidir encore sous le poids des gouttelettes limpides dont elles sont
chargées. D’autres plus délicates se penchent sous ce léger fardeau. C’est une
scène intéressante que de les voir, au lever du soleil qui pompe rapidement les
vapeurs condensées de la nuit, relever graduellement leurs têtes, redresser
leurs tiges affaissées, et prendre peu à peu l’habitude qui est propre à chacune
pendant le jour (1). Il en est que ces changements rendent tout à fait méconnaissables.
Cette heure aussi est celle de leur réveil, et la simultanéité des
deux phénomènes les rend l’un et l’autre plus sensibles. L’assoupissement des
plantes au coucher du soleil ne modifie que bien faiblement chez nous l’aspect
général de la végétation.
Il en est autrement dans les contrées équinoxiales. La multitude des
arbres et des herbes de la tribu des légumineuses, qui y déterminent quelques
uns des traits dominants du paysage, replient au coucher du soleil leurs
feuillages légers, étalés en panache pendant le jour. On voit leurs évolutions
réglées par celles de l’astre qui décline ; et quand il disparaît sous l’horizon,
leurs mouvements cessent, ou ceux du moins qu’ils peuvent éprouver encore
jusqu’aux dernières lueurs du crépuscule sont si faibles, que sa lumière incertaine
ne permet pas de les distinguer. Ils semblent alors immobiles comme le
sommeil, dans la scène de calme où entre toute la nature.
Aucun villageois ne connaît le nom d Urrukta, qui désigne sur les cartes le
petit massif de montagnes sous le sommet desquelles passe le chemin. Leur élévation
est de 33oo” à 34oom, et le point culminant de la route est de 2966“ ou
9729P'a’. C’est un bon chemin de montagnes, aisément praticable aux chevaux
et aux mulets, et qui est tracé ainsi depuis Simla jusqu'au col de Baranda.
Nulle apparence de neiges, et il y a certainement plus d’un mois que les dernières
ont disparu. Aux expositions les plus froides, l’herbe est déjà touffue et fleurie.
Quelques forêts de Deodar et de Pinas attenuata s’élèvent vers les sommets -
elles sont entremêlées de prairies qui occupent à peu près exclusivement
toutes les pentes douces entre 2700“ et 3 ioo". Ce sont les premières de ce
genre que je vois dans l’Himalâya, et quoique le fond de leur végétation se
compose des herbes qu’on trouve partout ailleurs à la même élévation, j ’y
ai recueilli cependant un nombre assez notable de plantes nouvelles : un Orchis,
(1) Miravamo ad ogni passo la famiglia dell’ erbe et degli fiori, che rialzavano a poco a poco
il loro capo chinato dalla brina. -—Foscolo : Jacopo Ortis. La Promenade à Arquà.