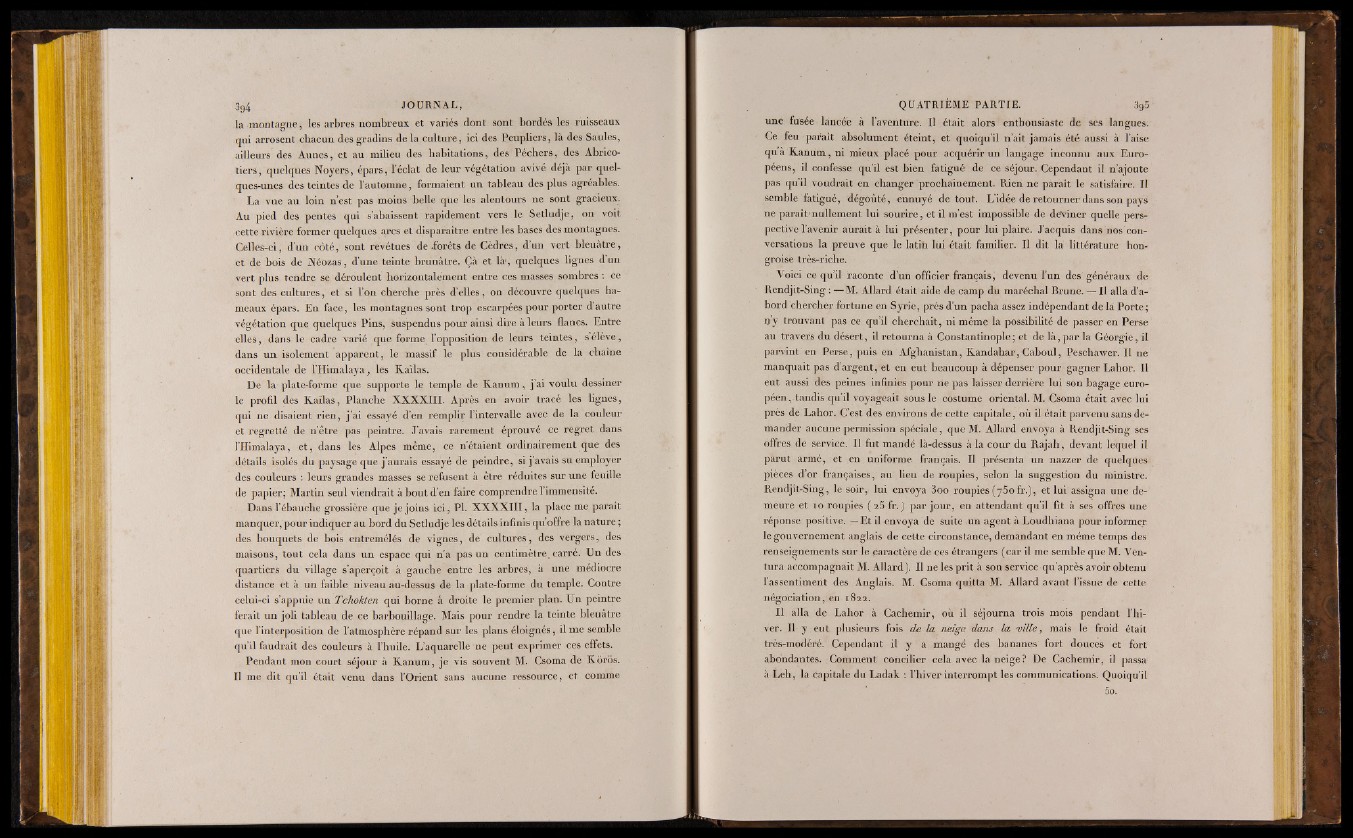
la montagne, les arbres nombreux et variés dont sont bordés les ruisseaux
qui arrosent chacun des gradins de la culture, ici des Peupliers, là des Saules,
ailleurs des Aunçs, e.t au milieu des habitations, des Pêchers, des Abricotiers,
quelques Noyers, épars, l ’éclat de leur végétation avivé déjà par quelques
unes des teintes de l’automne, formaient un tableau des plus agréables.
La vue au loin n’est pas moins belle que les alentours ne sont gracieux.
Au pied des pentes qui s’abaissent rapidement vers le Setludje, on voit
cette rivière former quelques arcs et disparaître entre les bases des montagnes.
Celles-ci, d’un côté, sont revêtues de «forêts de Cèdres, d’un vert bleuâtre,
et de bois de Néozas, d’une teinte brunâtre. Çà et là», quelques lignes d un
vert plus tendre se déroulent horizontalement entre ces masses sombres : ce
sont des cultures, et si l’on cherche près d’elles, on découvre quelques hameaux
épars. En face, les montagnes sont trop escarpées pour porter d’autre
végétation que quelques Pins, suspendus pour ainsi dire à leurs flancs. Entre
elles, dans le cadre varié que forme l’opposition de leurs teintes, s élève ,
dans un isolement apparent, le massif le plus considérable de la chaîne
occidentale de l’Himalaya, les Kaïlas.
De la plate-forme que supporte le temple de Kanum, j ’ai voulu dessiner
le profil des Kaïlas, Planche XXXXIII. Après en avoir tracé les lignes,
qui ne disaient rien, j ’ai essayé d’en remplir l’intervalle avec de la couleur
et regretté de n’être pas peintre. J’avais rarement éprouvé ce regret dans
J’Himalaya, e t, dans les Alpes même, ce n’étaient ordinairement que des
détails isolés du paysage que j ’aurais essayé de peindre, si j ’avais su employer
des couleurs : leurs grandes masses se refusent à être réduites sur une feuille
de papier; Martin seul viendrait à bout d’en faire comprendre l’immensité.
Dans l’ébauche grossière que je joins ic i, Pl. X X X X I I I , la place me paraît
manquer, pour indiquer au bord du Setludje les détails infinis qu’offre la nature ;
des bouquets de bois entremêlés de vignes, de cultures, des vergers, des
maisons, tout cela dans un espace qui n’a pas un centimètre, carré. Un des
quartiers du village s’aperçoit à gauche entre lés arbres, à une médiocre
distance et à un faible niveau au-dessus de la plate-forme du temple. Contre
celui-ci s’appuie un Tchokten qui borne à droite le premier plan. Un peintre
ferait un joli tableau de ce barbouillage. Mais pour rendre la teinte bleuâtre
que l’interposition de l’atmosphère répand sur les plans éloignés, il me semble
qu’il faudrait des couleurs à l’huile. L ’aquarelle ne peut exprimer ces effets.
Pendant mon court séjour à Kanum, je vis souvent M. Csoma de Kôrôs.
Il me dit qu’il était venu dans l’Orient sans aucune ressource, et comme
une fusée lancée à l’aventure. Il était alors ' enthousiaste de ses langues.
Ce feu paraît absolument éteint, et quoiqu’il n’ait jamais été aussi à l’aise
qua Kanum, ni mieux placé pour acquérir un langage inconnu aux Européens,
il confesse qu’il est bien fatigué de ce séjour. Cependant il n’ajoute
pas qu’il voudrait en changer prochainement. Rien ne paraît le satisfaire. Il
semble fatigué, dégoûté, ennuyé de tout. L’idée de retourner dans son pays
ne paraît'nullement lui sourire, et il m’est impossible de déViner quelle perspective
l’avenir aurait à lui présenter, pour lui plaire. J’acquis dans nos conversations
la preuve que le latin lui était familier. Il dit la littérature hongroise
très-riche.
Voici ce qu’il raconte d’un officier français, devenu l’un des généraux de
Rendjit-Sing : — M. Allard était aide de camp du maréchal Brune. — Il alla d’abord
chercher fortune en Syrie, près d’un pacha assez indépendant de là Porte;
n’y trouvant pas ce qu’il cherchait, ni même la possibilité de passer en Perse
au travers du désert, il retourna à Constantinople; et de là, par la Géorgie, il
parvint en Perse, puis en Afghanistan, Kandahar, Caboul, Peschawer. Il ne
manquait pas d’argent, et en eut beaucoup à dépenser pour gagner Lahor. Il
eut aussi des peines infinies pour rie pas laisser derrière lui son bagage européen,
tandis qu’il voyageait sous le costume oriental. M. Csoma était avec lui
près de Lahor. C’est des environs de cette capitale, où il était parvenu sans demander
aucune permission spéciale, que M. Allard envoya à Rendjit-Sirig ses
offres de service. Il fut mandé là-dessus à la cour du Rajah, devant lequel il
parut armé, et en uniforme français. Il présenta un nazzer de quelques
pièces d’or françaises, au lieu de roupies, selon la suggestion du riiinistre.
Rendjit-Sing, le soir, lui envoya 3oo roupies (7 5o fr.), et lui assigna une demeure
et 10 roupies (ü 5 fr.) par jour, en attendant qu’il fit à ses offres une
réponse positive. —Et il envoya de suite un agent à Loudhiana pour informer
le gouvernement anglais de cette circonstance, demandant en même temps des
renseignements sur le caractère de ces étrangers (car il me semble que M. Ventura
accompagnait M. Allard). Il ne les prit à son service qu’après avoir obtenu
l’assentimerit des Anglais. M. Csoma quitta M. Allard avant l’issue de cette
négociation, en 1822.
Il alla de Lahor à Cachemir, où il séjourna trois mois pendant l ’hiver.
Il y eut plusieurs fois de la neige dans la ville, mais le froid était
très-modéré. Cependant il y a mangé des bananes fort douces et fort
abondantes. Comment concilier cela avec la neige? De Cachemir, il passa
à Leh, la capitale du Ladak : l’hiver interrompt les communications. Quoiqu’il
5o.