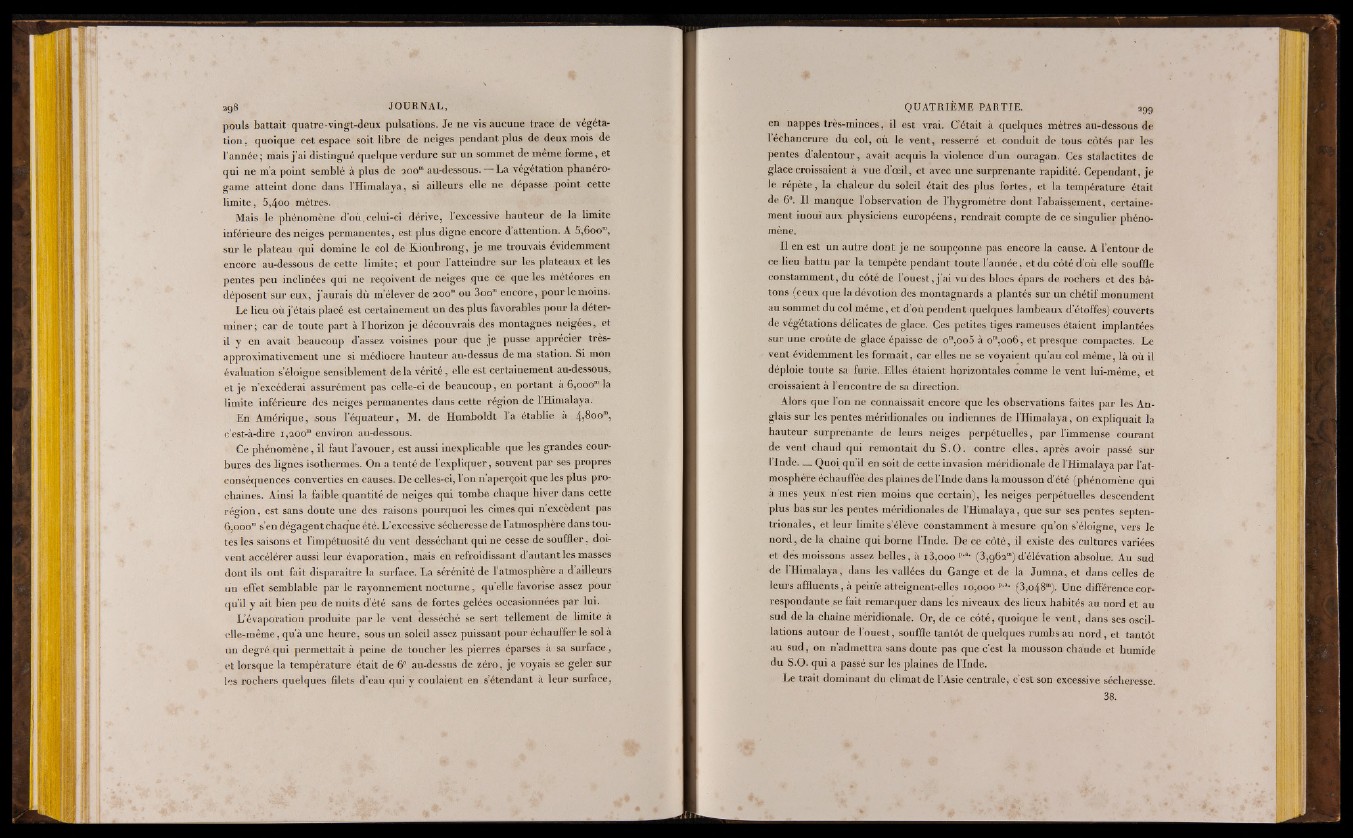
pouls battait quatre-vingt-deux pulsations. Je ne vis aucune trace de végétation,
quoique cet espace soit libre de neiges pendant plus de deux mois de
l’année ; mais j ’ai distingué quelque verdure sur un sommet de meme forme, et
qui ne m’a point semblé à plus de 200“ au-dessous. La végétation phanérogame
atteint donc dans l’Himalaya, si ailleurs elle ne dépasse point cette
limite, 5,4oo mètres.
Mais le phénomène d’où.celui-ci dérive, l ’excessive hauteur de la limite
inférieure des neiges permanentes, est plus digne encore d attention. A 5,6oom,
sur le plateau qui domine le col de Kioubrong, je me trouvais évidemment
encore au-dessous de cette limite; et pour 1 atteindre sur les plateaux et les
pentes peu inclinées qui ne reçoivent de neiges que ce que les méteores en
déposent sur eux, j ’aurais dû m’élever de 200“ ou 3oom encore, pour le moins.
Le lieu où j ’étais placé est certainement un des plus favorables pour la déterminer;
car de toute part à l’horizon je découvrais des montagnes neigées, et
il y en avait beaucoup d’assez voisines pour que je pusse apprécier très-
approximativenient une si médiocre hauteur au-dessus de ma station. Si mon
évaluation s’éloigne sensiblement delà vérité, elle est certainement au-dessous,
et je n’excéderai assurément pas celle-ci de beaucoup, en portant à 6,ooom la
limite inférieure des neiges permanentes dans cette région de 1 Himalaya.
En Amérique, sous l’équateur, M. de Humboldt l a établie à 4>8oom,
c’est-à-dire 1,200“ environ au-dessous.
Ce phénomène, il faut l’avouer, est aussi inexplicable que les grandes courbures
des lignes isothermes. On a tenté de l’expliquer, souvent par ses propres
conséquences converties en causes. De celles-ci, l ’on n’aperçoit que les plus prochaines.
Ainsi la faible quantité de neiges qui tombe chaque hiver dans cette
région, est sans doute une des raisons pourquoi les cimes qui n excèdent pas
6,ooom s’en dégagent chaque été. L ’excessive sécheresse de l’atmosphère dans toutes
les saisons et l’impétuosité du vent desséchant qui ne cesse de souffler, doivent
accélérer aussi leur évaporation, mais en refroidissant d’autant les masses
dont ils ont fait disparaître la surface. La sérénité de l’atmosphère a d ailleurs
un effet semblable par le rayonnement nocturne, qu elle favorise assez pour
qu’il y ait bien peu de nuits d’été sans de fortes gelées occasionnées par lui.
L ’évaporation produite par le vent desséché se sert tellement de limite à
elle-même, qu’à une heure, sous un soleil assez puissant pour échauffer le sol à
un degré qui permettait à peine de toucher les pierres éparses à sa surface,
et lorsque la température était de 6° au-dessus de zéro, je voyais se geler sur
les rochers quelques filets d’eau qui y coulaient en s’étendant à leur surface,
en nappes très-minces, il est vrai. C’était à quelques mètres au-dessous de
1 échancrure du col, où le vent, resserré et conduit de tous côtés par les
pentes d’alentour, avait acquis la violence d’un ouragan. Ces stalactites de
glace croissaient à vue d’oeil, et avec une surprenante rapidité. Cependant, je
le répète, la chaleur du soleil était des plus fortes, et la température était
de 6°. Il manque l’observation de l’hygromètre dont l’abaissement, certainement
inouï aux physiciens européens, rendrait compte de ce singulier phénomène.
I l en est un autre dont je ne soupçonne pas encore la cause. A l’en tour de
ce lieu battu par la tempête pendant toute l’année, et du côté d’où elle souffle
constamment, du côté de l’ouest, j ’ai vu des blocs épars de rochers et des bâtons
(ceux que la dévotion des montagnards a plantés sur un chétif monument
au sommet du col même, et d’où pendent quelques lambeaux d’étoffes) couverts
de végétations délicates de glace. Ces petites tiges rameuses étaient implantées
sur une croûte de glacé épaisse de om,oo5 à om,oo6, et presque compactes. Le
vent évidemment les formait, car elles ne se voyaient qu’au col même, là où il
déploie toute sa furie..Elles étaient horizontales comme le vent lui-même, et
croissaient à l’encontre de sa direction.
Alors que l’on ne connaissait encore que les observations faites par les Anglais
sur les pentes méridionales ou indiennes de l’Himalaya, on expliquait la
hauteur surprenante de leurs neiges perpétuelles, par l’immense courant
de vent chaud qui remontait dn S .O . contre elles, après avoir passé sur
l’Inde. _ Quoi qu’il en soit de cette invasion méridionale de l’Himalaya par l’atmosphère
échauffée des plaines de l’Inde dans la mousson d’été (phénomène qui
à mes yeux n’est rien moins que certain), les neiges perpétuelles descendent
plus bas sur les pentes méridionales de l’Himalaya, que sur ses pentes septentrionales,
et leur limite s’élève constamment à mesure qu’on s’éloigne, vers le
nord, de la chaîne qui borne l’Inde. De ce côté, il existe des cultures variées
et des moissons assez belles, à i 3,ooo p,a* (3,962“) d’élévation absolue. Au sud
de l’IIimalaya, dans les vallées du Gange et de la Jumna, et dans celles de
leurs affluents, à peine atteignent-elles 10,000 p,a# (3,o48m). Une différence correspondante
se fait remarquer dans les niveaux des lieux habités au nord et au
sud de la chaîne méridionale. Or, de ce côté, quoique le vent, dans ses oscillations
autour de l’ouest, souffle tantôt de quelques rumbsau nord, et tantôt
au sud, on n’admettra sans doute pas que c’est la mousson chaude et humide
du S.O. qui a passé sur les plaines de l’Inde.
Le trait dominant du climat de l’Asie centrale, c’est son excessive sécheresse.
38.