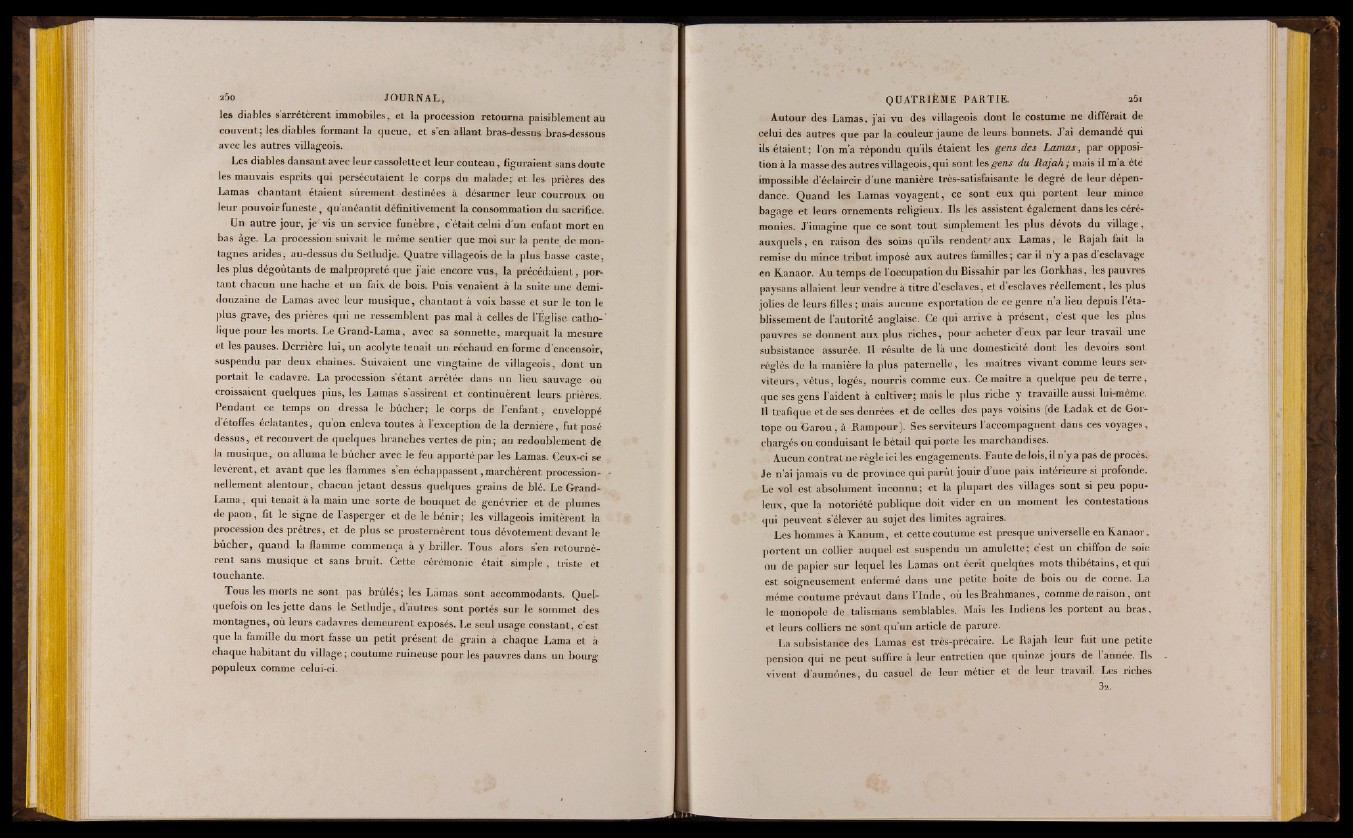
les diables s’arrêtèrent immobiles, et la procession retourna paisiblement au
couvent ; les diables formant la queue, et s’en allant bras-dessus bras-dessous
avec les autres villageois.
Les diables dansant avec leur cassolette et leur couteau,. figuraient sans doute
les mauvais esprits qui persécutaient le corps du malade;: et les prières des
Lamas chantant étaient sûrement destinées à désarmer leur courroux ou
leur pouvoir funeste, qu’anéantit définitivement la consommation du sacrifice.
Un autre jour, j e vis un service funèbre, c’était celui d’un enfant mort en
bas âge. La procession suivait le même sentier que moi sur la pente de montagnes
arides, au-dessus du Setludje. Quatre villageois de la plus basse, caste-,
les plus dégoûtants de malpropreté que j ’aie encore vus, la précédaient, portant
chacun une hache et un faix de bois. Puis venaient à la suite une demi-
douzaine de Lamas avec leur musique, chantant à voix basse et sur le ton le
plus grave, des prières qui ne ressemblent pas mal à celles de l’Église catho-'
lique pour les morts. Le Grand-Lama, avec sa sonnette, marquait la mesure
et les pauses. Derrière lui, un acolyte tenait un. réchaud en forme d'encensoir,
suspendu par deux chaînes. Suivaient une vingtaine de villageois, dont un
portait le cadavre. La procession s’étant arrêtée dans un lieu sauvage où
croissaient quelques pins, les Lamas s’assirent et continuèrent leurs prières.
Pendant ce temps on dressa le bûcher; le corps de l’enfant, enveloppé
d’étoffes éclatantes, qu’on enleva toutes à l’exception de la dernière, fut posé
dessus, et recouvert de quelques branches vertes de pin; au redoublement de
la musique , on alluma le bûcher avec le feu apporté par les Lamas. Ceux-ci se
levèrent, et avant que les flammes s’en échappassent,marchèrent procession-
nellement alentour, chacun jetant dessus quelques grains de blé.. Le:Grand-
Lama , qui tenait à la main une sorte de bouquet de genévrier et de plumes
de paon, fit le signe de l’asperger et de le bénir; les villageois imitèrent la
procession des prêtres, et de plus se prosternèrent tous dévotement devant le
bûcher, quand la flamme commença à y briller. Tous alors s’en retournèrent
sans musique et sans bruit. Cette cérémonie était simple , triste et
touchante.
Tous les morts ne sont pas brûlés.; les Lamas sont accommodants. Quelquefois
on les jette dans le Setludje, dautres sont portés sur le sommet des
montagnes, où leurs cadavres demeurent exposés. Le seul usage constant, c’est
que la famille du mort fasse un petit présent de grain à chaque Lama et à
chaque habitant du village ; coutume ruineuse pour les pauvres dans un bourg
populeux comme celui-ci.
Autour des Lamas, j ’ai vu des villageois dont le costume ne différait de
celui des autres que par la couleur jaune de leurs- bonnets. J’ai demandé qui
ils étaient; l ’on m’a répondu qu’ils étaient les gens des Lamas, par opposition
à la masse des autres villageois, qui sont les gens du Rajah; mais il m’a été
impossible d’éclaircir d’une manière très-satisfaisante lé degré de leur dépendance.
Quand les Lamas voyagent, ce sont eux qui portent leur mince
bagage et leurs ornements religieux. Ils lès assistent également dans les cérémonies.
J’imagine que ce sont tout simplement les plus dévots du village,
auxquels, en raison des soins quils rendent'aux Lamas, le Rajah fait la
remise du mince tribut imposé aux autres familles; car il n y a pas d esclavage
en Kanaor. Au temps de l’occupation du Bissahir par les Gorkhas, les pauvres
paysans allaient leur vendre à titre d’esclaves, et d esclaves réellement, les plus
jolies de leurs filles ; mais aucune exportation de ce genre n a lieu depuis 1 établissement
de l’autorité anglaise. Ce qui arrive à présent, cest que les plus
pauvres se donnent aux plus riches, pour acheter d eux par leur travail une
subsistance assurée. Il résulte de là une domesticité dont les devoirs sont
réglés de la manière la plus paternelle, les maîtres vivant comme leurs serviteurs,
vêtus, logés, nourris comme eux. Ce maître a quelque peu de terre,
que ses gens l’aident à cultiver; mais le plus riche y travaille aussi lui-méme.
Il trafique et de ses denrées et de celles des pays voisins (de Ladak et de Gor-
tope ou Garou, à Rampour). Ses serviteurs l’accompagnent dans ces voyages,
chargés ou conduisant le bétail qui porte les marchandises.
Aucun contrat ne règle ici les engagements. Faute de lois, il n y a pas de procès.
Je n’ai jamais vu de province qui parût jouir dune paix intérieure si profonde.
Le vol est absolument inconnu; et la plupart des villages sont si peu populeux,
que la notoriété publique doit vider en un moment les contestations
qui peuvent s’élever au sujet des limites agraires.
Les hommes à Kanum, et cette coutume est presque universelle en K anaor,
portent un collier auquel est suspendu un amulette; c’est un chiffon de soie
ou de papier sur lequel les Lamas ont écrit quelqùes mots thibétains, et qui
est soigneusement enfermé dans une petite boîte de bois ou de corne. La
même coutume prévaut dans lln d e , ou lesRrahmanes, comme déraison, ont
le monopole de talismans semblables. Mais les Indiens les portent au bras,
et leurs colliers ne sont qu’un article de parure.
La subsistance des Lamas est très-précaire. Le Rajah leur fait une petite
pension qui ne peut suffire à leur entretien que quinze jours de 1 année. Ils
vivent d’aumônes, du casuel de leur métier et de leur travail. Les riches
I 3a.