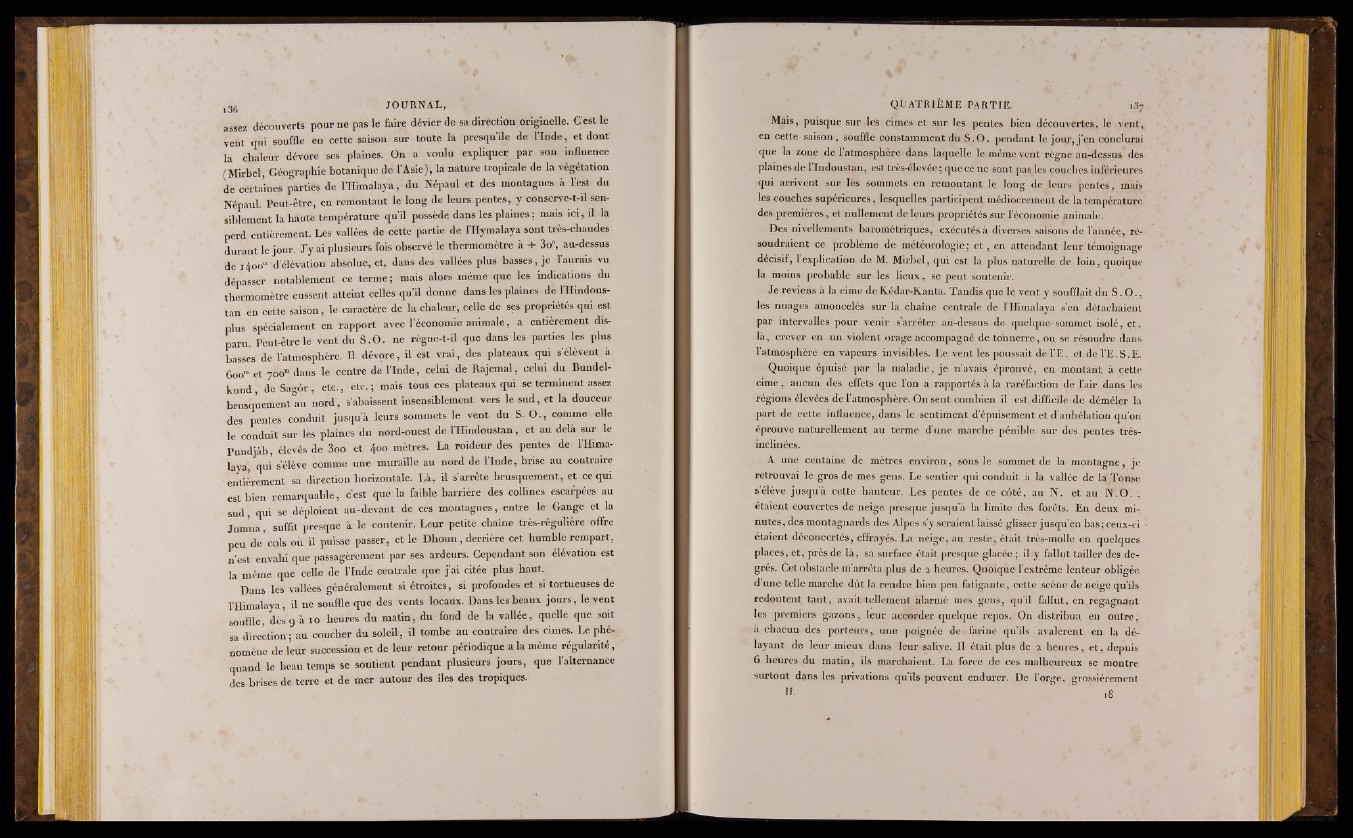
assez découverts pour ne pas le faire dévier de sa direction originelle. C est le
vent qui souffle en cette saison sur toute la presqu’île de l’Inde, et dont
la chaleur dévore ses plaines. On a voulu expliquer par son influence
(Mirbel, Géographie botanique de l’Asie), la nature tropicale de la végétation
de certaines parties de l’Himalaya, du Népaul et des montagnes à l’est du
Népaul. Peut-être, en remontant le long de leurs pentes, y conserve-t-il sensiblement
la haute température qu’il possède dans les plaines ; mais ic i, il la
perd entièrement. Les vallées de cette partie de l’IIymalaya sont très-chaudes
durant le jour. J’y ai plusieurs fois observé le thermomètre à + 3o°, au-dessus
de 1400“ d’élévation absolue, et, dans des vallées plus basses, je l’aurais vu
dépasser notablement ce terme; mais alors même que les indications du
thermomètre eussent atteint celles qu’il donne dans les plaines de l’IIindous-
tan en cette saison, le caractère de la chaleur, celle de ses propriétés qui est
plus spécialement en rapport avec l’économie animale, a entièrement disparu.
Peut-être le vent du S .O . ne règne-t-il que dans les parties les plus
basses de l’atmosphère. Il dévore, il est vrai, des plateaux qui s’élèvent à
6oom et 7 0 0 ” dans le centre de l’Inde, celui de Rajemal, celui du Bundel-
kund, de S a gô r, etc., e tc .; mais tous ces plateaux qui se terminent assez
brusquement au nord, s'abaissent insensiblement vers le sud, et la douceur
des pentes conduit jusqu’à leurs sommets le vent du S. O . , comme elle
le conduit sur lés plaines du nord-ouest de l’Hindoustan, et au delà sur le
Pundjâb, élevés de 3oo et 4<>o mètres. La roideur des pentes de l’Hima-
laya, qui s’élève comme une muraille au nord de l’Inde, brise au contraire
entièrement sa direction horizontale, Là, il s’arrête brusquement, et ce qui
est bien remarquable, c’est que la faible barrière des collines escarpées au
sud, qui se déploient au-devant de ces montagnes, entre le Gange et la
Jumna, suffit presque à le contenir. Leur petite chaîne très-régulière offre
peu de'cols oh il puisse passer, et le Dhoun, derrière cet humble rempart,
n’est envahi que passagèrement par ses ardeurs. Cependant son élévation est
la même que celle de l’Inde centrale que j ’ai citée plus haut.
Dans les vallées généralement si étroites, si profondes et si tortueuses de
l’H imalaya, il ne souffle que des vents locaux. Dans les beaux jours, lè v en t
souffle, dès 9 à 10 heures du matin, du fond de la vallée, quelle que soit
sa direction; au coucher du soleil, il tombe au contraire des cimes. Le phénomène
de leur succession et de leur retour périodique a la même régularité ,
quand le beau temps se soutient pendant plusieurs jours, que l’alternance
des brises de terre et de mer autour des îles des tropiques.
Mais, puisque sur les cimes et sur les pentes bien découvertes, le vent,
en cette saison , souffle, constamment du S . O . pendant le jour, j ’en conclurai
que la zone de l’atmosphère dans laquelle le même vent règne au-dessus des
plaines de l’Indoustan, est très-élevée ; que ce ne sont pas les couches inférieures
qui arrivent sur les sommets en remontant le long de leurs pentes, mais
les couches supérieures, lesquelles participent médiocrement de la température
des premières, et nullement de leurs propriétés sur l’économie animale.
Des nivellements barométriques, exécutés à diverses saisons de l’année, résoudraient
ce problème de météorologie: e t , en attendant leur témoignage
décisif, 1 explication de M. Mirbel, qui est la plus naturelle de loin, quoique
la moins probable sur les lieux, se peut soutenir.
Je reviens à la cime de Kédar-Kanta. Tandis que le vent y soufflait du S . O .,
les nuages amoncelés sur la chaîne centrale de l’Himalaya s’en détachaient
par intervalles pour venir s’arrêter au-dessus de quelque, sommet isolé, et,
là, crever en un violent orage accompagné dé tonnerre, ou se résoudre dans
l’atmosphère en vapeurs invisibles. Le vent les poussait de l’E . e td e l ’E .S .E .
Quoique épuisé par la maladie; je n’avais éprouvé, en montant à cette
cime, aucun des effets que l’on a rapportés à la raréfaction de l’air dans les
régions élevées de l’atmosphère. On sent combien il est difficile de démêler la
part de cette influence, dans le sentiment d’épuisement et d’anhélation qu’on
éprouve naturellement au terme d’une marche pénible sur des pentes très-
inclinées.
A une centaine de mètres environ, sous le sommet de la montagne, je
retrouvai le gros de mes gens. Le sentier qui conduit à la vallée de la Tonse
s élève jusqu’à cette hauteur. Les pentes de ce côté, au K . et au N .O . ,
étaient couvertes de neige presque jusqu’à la limite des forêts. En deux minutes,
des montagnards des Alpes s’y seraient laissé glisser jusqu’en bas; ceux-ci
étaient déconcertés, effrayés. La neige, ati reste ; était très-molle en quelques
places, et, près de là , sa surface était presque glacée; il y fallut tailler des degrés.
Cet obstacle m’arrêta plus de 2 heures. Quoique l’extrême lenteur obligée
d une telle marche dût la rendre bien peu fatigante, cette scène de neige qu’ils
redoutent tant, avait tellement alarmé mes gens, qu’il fallut, en regagnant
les premiers gazons, leur accorder quelque repos. On distribua en outre,
à chacun des porteurs, une poignée de-farine qu’ils avalèrent en la délayant
de leur mieux dans leur salive. Il était plus de 2 heures , e t, depuis
6 heures du matin, ils marchaient. L’a force de ces malheureux se montre
surtout dans les privations qu’ils peuvent endurer. De l’orge, grossièrement
If- .8