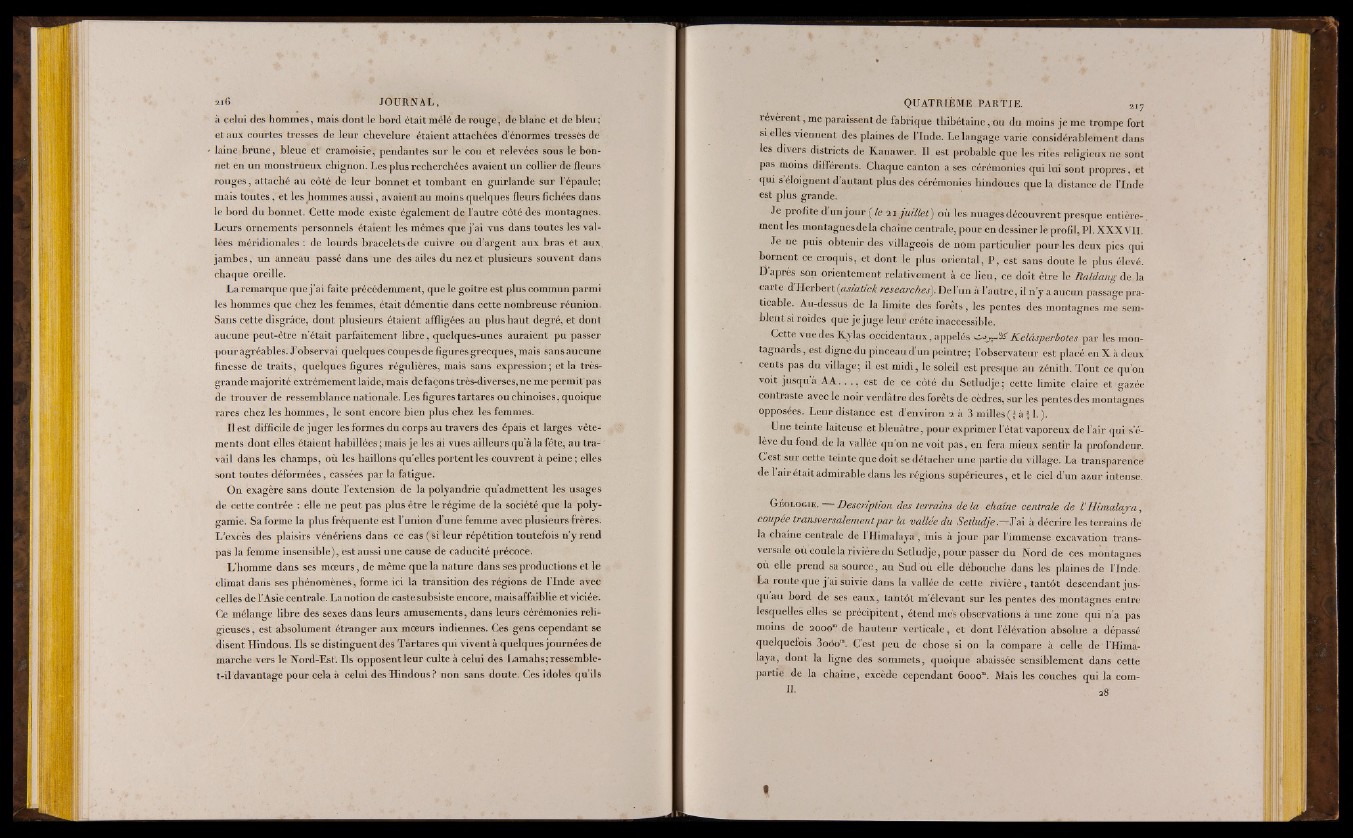
à celui des hommes, mais dont le bord était mêlé de rouge, de blanc et de bleu;
et aux courtes tresses de leur chevelure étaient attachées d’énormes tressés de
laine brune, bleue et cramoisie, pendantes sur le cou et relevées sous le bonnet
en un monstrueux chignon. Les plus recherchées avaient un collier de fleurs
rouges, attaché au côté de leur bonnet et tombant en guirlande sur l’épaule;
mais toutes, et les hommes aussi, avaient au moins quelques fleurs fichées dans
le bord du bonnet. Cette mode existe également de l’autre côté des montagnes.
Leurs ornements personnels étaient les mêmes que j ’ai vus dans toutes les vallées
méridionales : de lourds bracelets de cuivre ou d’argent aux bras et auxv
jambes, ün anneau passé dans une des ailes du nez et plusieurs souvent dans
chaque oreille.
La remarque que j ’ai faite précédemment, que le goitre est plus commun parmi
les hommes que chez les femmes, était démentie dans cette nombreuse réunion.
Sans cette disgrâce, dont plusieurs étaient affligées au plus haut degré, et dont
aucune peut-être n’était parfaitement libre , quelques-unes auraient pu passer
pour agréables. J*observai quelques coupes de figures grecques, mais sans aucune
finesse de traits, quelques figures régulières, mais sans expression; et la très-
grande majorité extrêmement laide, mais de façons très-diverses, ne me permit pas
de trouver de ressemblance nationale. Les figures tartares ou chinoises, quoique
rares chez les hommes, le sont encore bien plus chez les femmes.
Il est difficile de juger les formes du corps au travers des épais et larges vêtements
dont elles étaient habillées ; mais je les ai vues ailleurs qu’à la fête, au travail
dans les champs, où les haillons quelles portent les couvrent à peine; elles
sont toutes déformées, cassées par la fatigue.
On exagère sans doute l’extension de la polyandrie qu’admettent les usages
de cette contrée : élle ne peut pas plus être le régime de la société que la polygamie.
Sa forme la plus fréquente est l’union d’une femme avec plusieurs frères.
L'excès des plaisirs vénériens dans cé cas ( si leur répétition toutefois n’y rend
pas la femme insensible), est aussi une cause de caducité précocè.
L’homme dans ses moeurs, de même que la nature dans ses productions et le
climat dans ses phénomènes, forme ici la transition des régions de l’Inde avec
celles de l’Asie centrale. La notion de caste subsiste encore, mais affaiblie et viciée:
Ce mélange bbre des sexes dans leurs amusements, dans leurs cérémonies religieuses
, est absolument étranger aux moeurs indiennes. Ces gens cependant se
disent Hindous. Ils se distinguent des Tartares qui vivent à quelques journées de
marche vers le Nord-Est. Ils opposent leur culte à celui des Lamahs; ressemble-
t-il davantage pour cela à celui des Hindous ? non sans doute. Ces idoles qu’ils
révèrent, me paraissent de fabrique thibétaine, ôu du moins je me trompe fort
si, elles viennent des plaines de l’Inde. Le langage varie considérablement dans
les divers districts de Kanawer. Il est probable que les rites religieux ne sont
pas moins différents. Chaque canton a ses cérémonies qui lui sont propres, et
qui s éloignent d autant plus des cérémonies hindoues que la distance de l’Inde
est plus grande.
Je profite d un jour ( le 21 juillet ) où les nuages découvrent presque entièrement
les montagnes de la chaîne centrale, pour en dessiner lë profil, Pl. XXXVII.
Je ne puis obtenir des villageois de nom particulier pour les deux pics qui
bornent ce croquis, et dont le plus oriental, P, est sans doute le plus élevé.
I) après son onentement relativement à ce lieu, ce doit être le Raldang de la
carte d Herbert (asiatick researches). Del un à l’autre, il n’y a aucun passage praticable.
Au-dessus de la limite des forêts, les pentes des montagnes me semblent
si roides que je juge leur crête inaccessible.,
Cette vue des Kylas occidentaux, appelés Kelâsperbotes par les montagnards
, est digne du pinceau d un peintre; l’observateur est placé en X à deux
cents pas du village; il est midi, le soleil est presque au zénith. Tout ce qu’on
voit jusquà AA. . est de ce côté du Setludje; cette limite claire et gazée
contraste avec le noir verdâtre des forêts de cèdres, sur les pentes des montagnes
opposées. Leur distance est d’environ 2 à 3 milles(| à f 1. ).
Une teinte laiteuse et bleuâtre , pour exprimer l’état vaporeux de l’air qui s’élève
du fond de la vallée qu’on ne voit pas, en fera mieux sentir la profondeur.
Çest sur cette teinte que doit se détacher une partie du village. La transparence
de 1 air était admirable dans les régions supérieures , et le ciel d’un azur intense.
G é o l o g i e . Description des terrains de la chaîne centrale de VHimalaya,
coupce transversalement par la vallée du Setludje.—J’ai à décrire les terrains de
la chaîne centrale de 1 Himalaya, mis à jour par l’immense excavation transversale,
où coule la rivière du Setludje, pour passer du Nord de ces montagnes
où elle, prend sa source, au Sud où elle débouche dans les plaines de l’Inde.
La route que j ai suivie dans la vallée de cette rivière, tantôt descendant jus-
quau bord de ses eaux, tantôt m’élevant sur les pentes des montagnes entre
lesquelles elles se précipitent, étend mes observations à une zone qui n’a pas
moins de 2000“ de hauteur verticale, et dont l’éléyation absolue a dépassé
quelquefois 3oôom. C’est peu de chose si on la compare à celle de l’Hima-
laya, dont la 1 igne des sommets, quoique abaissée sensiblement dans cette
partie de la chaîne, excède cependant 6000“ . Mais les couches qui la com-
I 28