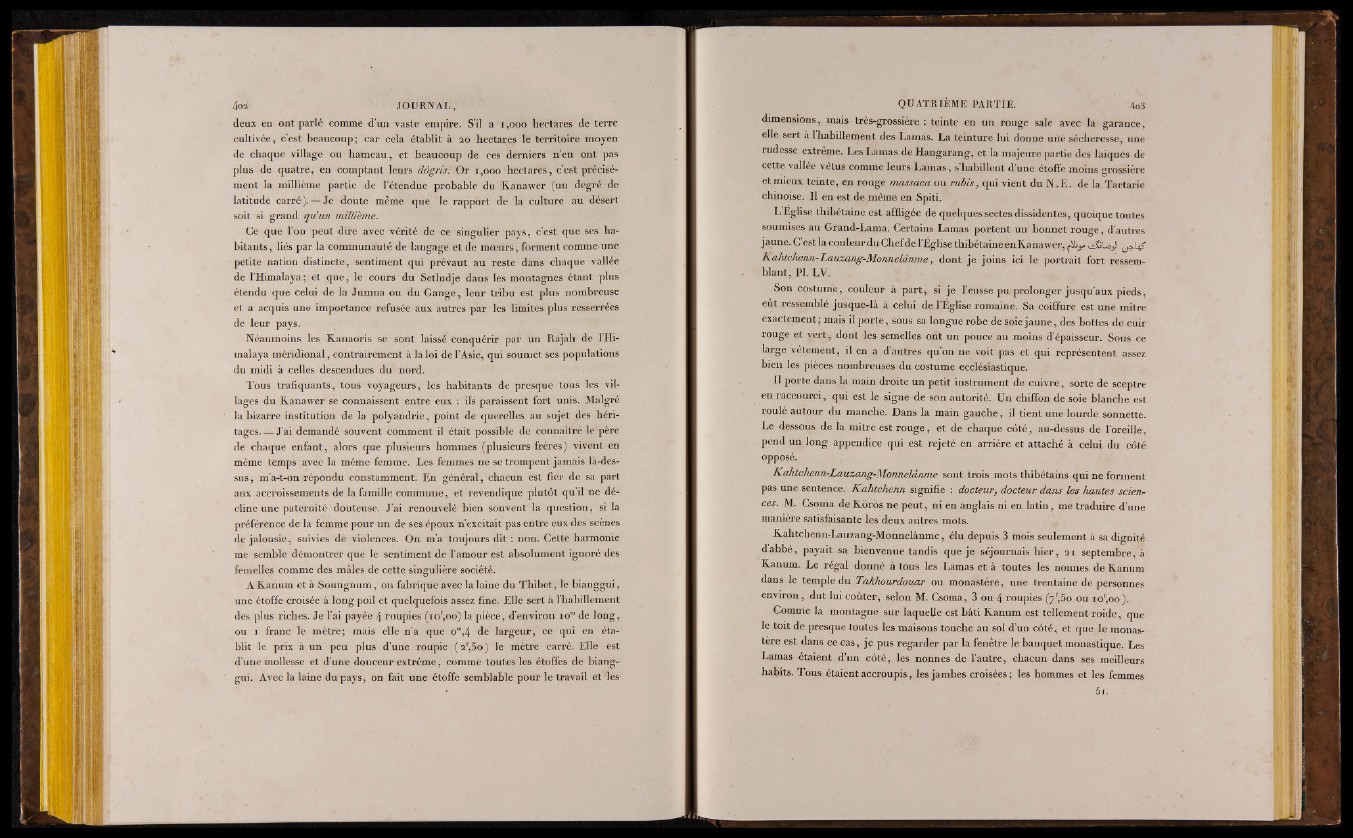
deux eu ont parlé comme d’un vaste empire. S’il a 1,000 hectares de terre
cultivée, c’est beaucoup; car cela établit à 20 hectares le territoire moyen
de chaque village ou hameau, et beaucoup de ces derniers n’en ont pas
plus de quatre, en comptant leurs dôgris. Or 1,000 hectares, c’est précisément
la millième partie de l’étendue probable du Kanawer (un degré de
latitude carré).— Je doute même que le rapport de la culture au désert
soit si grand qu’un millième.
Ce que l’on peut dire avec vérité de ce singulier pays, c’est que ses habitants,
liés par la communauté de langage et de moeurs , forment comme-une
petite nation distincte, sentiment qui prévaut au reste dans chaque vallée
de l’Himalaya; et que, le cours du Setludje dans les montagnes étant plus
étendu que celui de la Jumna ou du Gange, leur tribu est plus nombreuse
et a acquis une importance refusée aux autres par les limites plus resserrées
de leur pays.
Néanmoins les Kanaoris se sont laissé conquérir par un Rajah de l’Hi-
rnalaya méridional, contrairement à la loi de l’Asie, qui soumet ses populations
du midi à celles descendues du nord.
Tous trafiquants, tous voyageurs, les habitants de presque tous les villages
du Kanawer se connaissent entre eux : ils paraissent fort unis. Malgré
la bizarre institution de la polyandrie, point de querelles au sujet des héritages
J’ai demandé souvent comment il était possible de connaître le père
de chaque enfant, alors que plusieurs hommes (plusieurs frères) vivent en
même temps avec la même femme. Les femmes ne se trompent jamais là-dessus,
m’a-t-on répondu constamment. En général, chacun est fier de sa part
aux accroissements de la famille commune, et reveudique plutôt qu’il ne décline
une paternité douteuse. J’ai renouvelé bien souvent la question, si la
préférence de la femme pour un de ses époux n’excitait pas entre eux des scènes
de jalousie, suivies de violences. On m’a toujours dit : non. Cette harmonie
me semble démontrer que le sentiment de l’amour est absolument ignoré des
femelles comme des mâles de cette singulière société.
A Kanum et à Soungnum, on fabrique avec la laine du Thibet, le bianggui,
une étoffe croisée à long poil et quelquefois assez fine. Elle sert à l’habillement
des plus riches. Je l’ai payée 4 roupies ( io f,oo) la pièce, d’environ iom de long,
ou 1 franc le mètre; mais elle n’a que om,4 de largeur, ce qui en établit
le prix à un peu plus d’une roupie (2f,5o) le mètre carré. Elle est
d’une mollesse et d’une douceur extrême, comme toutes les étoffes de bianggui.
Avec la laine du pays, on fait une étoffe semblable pour le travail et lés
dimensions, mais tres-grossière : teinte en un rouge sale avec la garance,
elle sert à 1 habillement des Lamas. La teinture lui donne urie sécheresse, une
rudesse extreme. Les Lamas de Hangarang, et la majeure partie des laïques de
cette vallée vêtus comme leurs Lamas, s habillent dune étoffe moins grossière
et mieux teinte, en rouge massaea ou rubis, qui vient du N .E . de la Tartarie
chinoise. Il en est de même en Spiti.
L Eglise thibétaine est affligée de quelques sectes dissidentes, quoique toutes
soumises au Grand-Lama. Certains Lamas portent un bonnet rouge, d’autres
jaune. C est la couleur du Chef de l’Église thibétaine enKanawer, ^>SUyl
Kahtchenn-Lauzang-Monnelânme, dont je joins ici le portrait fort ressemblant,
Pl. LV.
Son costume, couleur à part, si je l’eusse pu prolonger jusqu’aux pieds,
eut ressemble jusque-la à celui de 1 Église romaine. Sa coiffure est une mitre
exactement ; mais il porte, sous sa longue robe de soie jaune, des bottes de cuir
rouge et vert, dont les semelles ont un pouce au moins d’épaisseur. Sous ce
large vêtement, il en a d’autres qu’on ne voit pas et qui représentent assez
bieii les pièces nombreuses du costume ecclésiastique.
Il porte dans la main droite un petit instrument de cuivre, sorte de sceptre
en raccourci, qui est le signe de son autorité. Un chiffon de soie blanche est
roulé autour du manche. Dans la main gauche, il tient une lourde sonnette.
Le dessous de la mitre est roug e , et de chaque côté , au-dessus de l’oreille,
pend un long appendice qui est rejeté en arrière et attaché à celui du côté
opposé.
Kahtchenn-Lauzang-Monnelânme sont trois mots thibétains qui ne forment
pas une sentence. Kahtchenn signifie : docteur, docteur dans les hautes sciences.
M. Csoma de Korôs ne peut, ni en anglais ni en latin, me traduire d’une
manière satisfaisante les deux autres mots.
Kahtchenn-Lauzang-Monnelânme, élu depuis 3 mois seulement à sa dignité
dabbé, payait sa bienvenue tandis que je séjournais hier, 21 septembre, à
Kanum. Le régal donné à tous les Lamas et à toutes les nonnes de Kanum
dans le temple du Takhourdouar ou monastère, une trentaine de personnes
environ, dut lui coûter, selon M. Csoma, 3 ou 4 roupies (7f,5o ou io f,oo).
Comme la montagne sur laquelle est bâti Kanum est tellement roide, que
le toit de presque toutes les maisons touche au sol d’un côté, et que le monastère
est dans ce cas, je pus regarder par la fenêtre le banquet monastique. Les
Lamas étaient d’un côté, les nonnes de l’autre, chacun dans ses meilleurs
habits. Tous étaient accroupis, les jambes croisées ; les hommes et les femmes
5r.