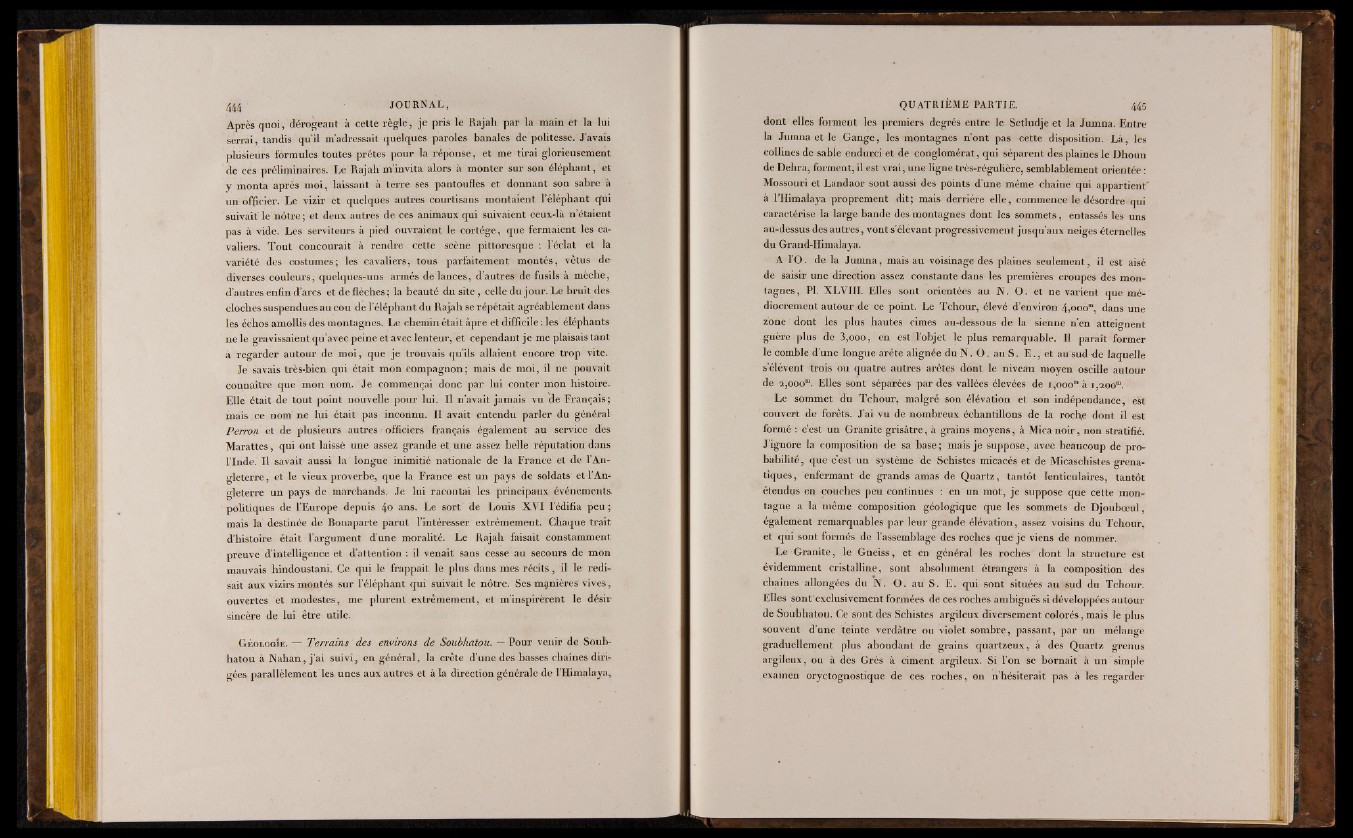
Après quoi, dérogeant à cette règle, je pris le Rajali par la main et la lui
serrai, tandis qu’il m’adressait quelques paroles banales de politesse. J’avais
plusieurs formules toutes prêtés pour la réponse, et me tirai glorieusement
de ces préliminaires. Le Rajah m’invita alors à monter sur son éléphant, et
y monta après moi, laissant à terre ses pantoufles et donnant son sabre à
un officier. Le vizir et quelques autres courtisans montaient l’éléphant qui
suivait le nôtre ; et deux autres de ces animaux qui suivaient ceux-là n’étaient
pas à vide. Les serviteurs à pied ouvraient le cortège, que fermaient les cavaliers.
Tout concourait à rendre cette scène pittoresque : l’éclat et la
variété des costumes; les cavaliers, tous parfaitement montés, vêtus de
diverses couleurs, quelques-uns armés de lances, d’autres de fusils à mèche,
d’autres enfin d’arcs et de flèches ; la beauté du site , celle du jour. Le bruit des
cloches suspendues au cou de l’éléphant du Rajah se répétait agréablement dans
les échos amollis des montagnes. Le chemin était âpre et difficile : les éléphants
ne le gravissaient qu’avec peine et avec lenteur, et cependant je me plaisais tant
à regarder autour de moi, que je trouvais qu’ils allaient encore trop vite.
Je savais très-bien qui était mon compagnon; mais de moi, il ne pouvait
connaître que mon nom. Je commençai donc par lui conter mon histoire.
Elle était de tout point nouvelle pour lui. Il n'avait jamais vu de Français;
mais ce nom ne lui était pas inconnu. Il avait entendu parler du général
Perron et de plusieurs autres officiers français également au service des
Marattes, qui ont laissé une assez grande et une assez belle réputation dans
l’Inde. Il savait aussi la longue inimitié nationale de la France et de l’Angleterre
, et le vieux proverbe, que la France est un pays de soldats et l’Angleterre
un pays de marchands. Je lui racontai les principaux événements
politiques de l’Europe depuis 4o Le sort de Louis X V I l’édifia peu ;
mais la destinée de Bonaparte parut l’intéresser extrêmement. Chaque trait
d’histoire était l’argument d’une moralité. Le Rajah faisait constamment
preuve d’intelligence et d’attention : il venait sans cessé au secours de mon
mauvais hindoustani. Ce qui lé frappait le plus dans mes récits, il le redisait
aux vizirs montés sur l’éléphant qui suivait le nôtre. Ses manières vives,
ouvertes et modestes, me plurent extrêmement, et m’inspirèrent le désir
sincère de lui être utile.
G é o l o g Î e . — Terrains des environs de Soubhatou. — Pour venir de Soüb-
hatou à Nahan, j ’ai suivi, en général, la crête d’une des basses chaînes dirigées
parallèlement les unes aux autres et à la direction générale de l'Himalaya,
dont elles forment les premiers degrés entre le Setludje et la Jumna. Entre
la Jumna et le Gange, les montagnes n’ont pas cette disposition. Là, les
collines de sable endurci et de conglomérat, qui séparent des plaines le Dhoun
de Dehra, forment, il est vrai, une ligne très-régulière, semblablement orientée :
Mossouri et Landaor sont aussi des points d’une même chaîne qui appartient'
à l'Himalaya proprement dit; mais derrière elle, commence le désordre qui
caractérise la large bande des montagnes dont les sommets, entassés les uns
aU-dessus des autres, vont s’élevant progressivement jusqu’aux neiges éternelles
du Grand-Himalaya.
A T O . de la Jumna, mais au voisinage des plaines seulement, il est aisé
de saisir une direction assez constante dans les premières croupes des montagnes
, PI. XLVIII. Elles sont orientées au H . O . et ne varient que médiocrement
autour de ce point. Le Tchour, élevé d’environ 4,000“ , dans une
zone dont les plus hautes cimes au-dessous de la sienne n’en atteignent
guère plus de 3,000, en est l’objet le plus remarquable. Il parait former
le comble d’une longue arête alignée du N . O . au S . E ., et au sud -de laquelle
s’élèvent trois ou quatre autres arêtes dont le niveau moyen oscille autour
de 2,000” . Elles sont séparées par des vallées élevées de i,ooo” à 1,200“ .
Le sommet du Tchour, malgré son élévation et son indépendance, est
couvert de forêts. J’ai vu de nombreux échantillons de la roch,e dont il est
formé : c’est un Granité grisâtre, à grains moyens, à Mica noir, non stratifié.
J’ignore la composition de sa base ; mais je suppose, avec beaucoup de probabilité,
que c’est un système de Schistes micacés et de Micaschistes grena-
tiques, enfermant de grands amas de Quartz, tantôt lenticulaires, tantôt
étendus en couches peu continués : en un mot, je suppose que cette montagne
a la même composition géologique qüe les sommets de Djouboeul,
également remarquables par léur grande élévation, assez voisins du Tchour,
et qui sont formés de l’assemblage dés roches que je viens de nommër.
Le Granité, le Gneiss, et en général lés roches dont la structure est
évidemment cristalline, sont absolument étrangers à la composition des
chaînes allongées du N . O . au S. E. qui sont situées au sud du Tchour.
Elles sont exclusivement formées de ces roches ambiguës si développées autour
de Soubhatou. Ce sont des Schistes argileux diversement colorés, mais le plus
souvent d’une teinte verdâtre ou violet sombre, passant, par un mélange
graduellement plus abondant de grains quartzeux, à des Quartz grenus
argileux, ou à des Grès à ciment argileux. Si l’on se bornait à un simple
examen oryctognostique de ces roches, on n’hésiterait pas à les regarder