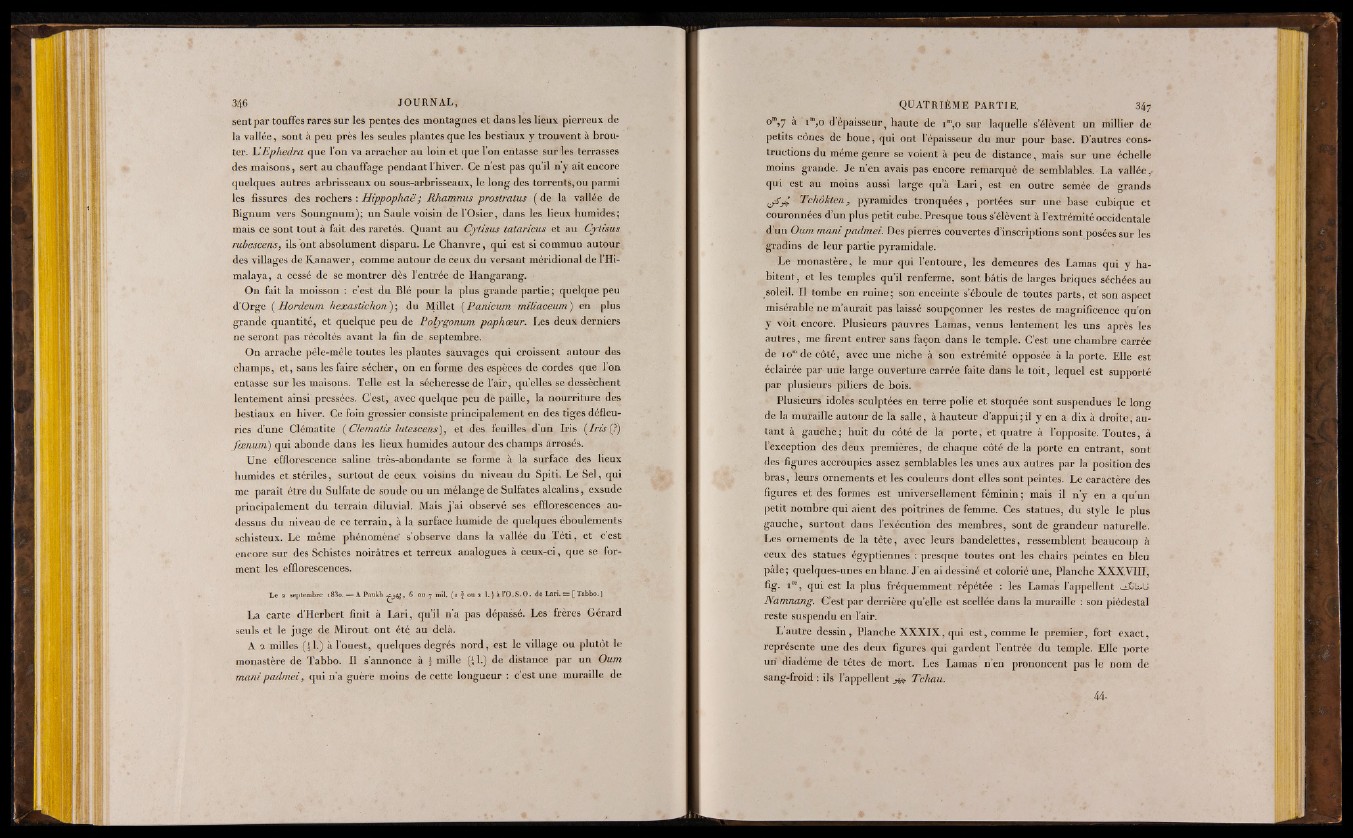
sent par touffes rares sur les pentes des montagnes et dans les lieux pierreux de
la vallée, sont à peu près les seules plantes que les bestiaux y trouvent à brouter.
L'Ephedra que l’on va arracher au loin et que l’on entasse sur les terrasses
des maisons, sert au chauffage pendant l’hiver. Ce n'est pas qu’il n y ait encore
quelques autres arbrisseaux ou sous-arbrisseaux, le long des torrents, ou parmi
les fissures des rochers : Hippophaë; Rhamnus prostratus (de la vallée de
Bignum vers Soungnum); un Saule voisin de l’Osier, dans les lieux humides;
mais ce sont tout à fait des raretés. Quant au Cytisus tataricus et au Cy'tisus
rubescens, ils ont absolument disparu. Le Chanvre, qui est si commun autour
des villages de Kanawer, comme autour de ceux du versant méridional de l’Hi-
malaya, a cessé de se montrer dès l’entrée de Hangarang.
On fait la moisson : c’est du Blé pour la plus grande partie; quelque peu
d’O rge ( Hordeum hexastichon ) ; du Millet ( Panicum miliaceum ) en plus
grande quantité, et quelque peu de Polygonum paphoeur. Les deux derniers
ne seront pas récoltés avant la fin de septembre.
On arrache pèle-mêle toutes les plantes sauvages qui croissent autour des
champs, et, sans les faire sécher, on en forme des espèces de cordes que l’on
entasse sur les maisons. Telle est la sécheresse de l’air, quelles se dessèchent
lentement ainsi pressées. C’est, avec quelque peu de paille, la nourriture des
bestiaux en hiver. Ce foin grossier consiste principalement en des tiges défleuries
d’une Clématite ( Clematis lutescens), et des feuilles d’un Iris (Iris (?)
foenum) qui abonde dans les lieux humides autour des champs arrosés.
Une efflorescence saline très-abondante se forme à la surface des lieux
humides et stériles, surtout de ceux voisins du niveau du Spiti. Le Sel, qui
me paraît être du Sulfate de soude ou un mélange de Sulfates alcalins, exsude
principalement du terrain diluvial. Mais j ’ai observé ses efflorescences au-
dessus du niveau de ce terrain, à la surface humide de quelques éboulements
schisteux. Le même phénomène* s’observe dans la vallée du T é t i, et c’est
encore sur des Schistes noirâtres et terreux analogues à ceux-ci, que se forment
les efflorescences.
Le a septembre i83o. — A Paukh > 6 ou 7 mil. ( 1 1 ou î 1. ) à l’O ,S O . de Lari. = [ Tabbo. ]
La carte d’Herbert finit à L a ri, qu’il n’a pas dépassé. Les frères Gérard
seuls et le juge de Mirout ont été au delà.
A 1 milles ( ■, llfcà l’ouest, quelques degrés nord, est le village ou plutôt le
monastère de Tabbo. Il s’annonce à \ mille (j 1.) de distance par un Oum
mani padmei, qui n’a guère moins de cette longueur : c’est une muraille de
om,7 à i ,=,o d épaisseur 5 haute de im,o sur laquelle s’élèvent un millier de
petits cônes de boue, qui ont l’épaisseur du mur pour base. D’autres constructions
du meme genre se voient à peu de distance, mais sur une échelle
moins grande. Je n’en avais pas encore remarqué de semblables. La vallée,-
qui est au moins aussi large qu’à Lari, est en outre semée de grands
Tchôkten, pyramides tronquées, portées sur une base cubique et
couronnées d’un plus petit cube. Presque tous s’élèvent à l’extrémité occidentale
d uù Oum mani padmei. Des pierres couvertes d’inscriptions sont posées sur les
gradins de leur partie pyramidale.
Le monastère, le mur qui l’entoure, les demeures des Lamas qui y habitent,
et les temples qu’il renferme, sont bâtis de larges briques séchées au
soleil. Il tombe en ruine; son enceinte s’éboule de toutes parts, et son aspect
misérable ne m’aurait pas laissé soupçonner les restes de magnificence qu’on
y voit encore. Plusieurs pauvres Lamas, venus lentement les uns après les
autres, me firent entrer sans façon dans le temple. C’est une chambre carrée
de 10" de côté, avec une niche à son extrémité opposée à la porte. Elle est
éclairée par une large ouverture carrée faite dans le toit, ,lequel est supporté
par plusieurs piliers de bois.
Plusieurs idolés sculptées en terre polie et stuquée sont suspendues le long
de la muraille autour de la salle, à hauteur d’appui; il y en a dix à droite, autant
à gauche ; huit du côté de la porte, et quatre à l’opposite. Toutes, à
l’exception des deux premières, de chaque côté de la porte en entrant, sont
des figures accroupies assez semblables les unes aux autres par la position des
bras, leurs ornements et les couleurs dont elles sont peintes. Le caractère des
figures et des formes est universellement féminin ; mais il n’y en a qu’un
petit nombre qui aient des poitrines de femme. Ces statues, du style le plus
gauche, surtout dans l’exécution dès membres, sont de grandeur naturelle.
Les ornements de la tête, avec leurs bandelettes, ressemblent beaucoup à
ceux des statues égyptiennes’ : presque toutes ont les chairs peintes en hleu
pâle ; quelques-unes en blanc. J’en ai dessiné et colorié une, Planche XXXVIII,
fig. 1 " , qui est la plus fréquemment, répétée : les Lamas l’appellent -¿filnU
Namnang. C’est par derrière qu elle est scellée dans la muraille : son piédestal
reste suspendu en l’air.
L autre dessin, Planche X X X IX , qui est, comme le premier, fort exact,
représente une des deux figures qui gardent l’entrée du temple. Elle porte
un diadème de tètes de mort. Les Lamas n’en prononcent pas le nom de
sang-froid : ils l ’appellent Tchau.