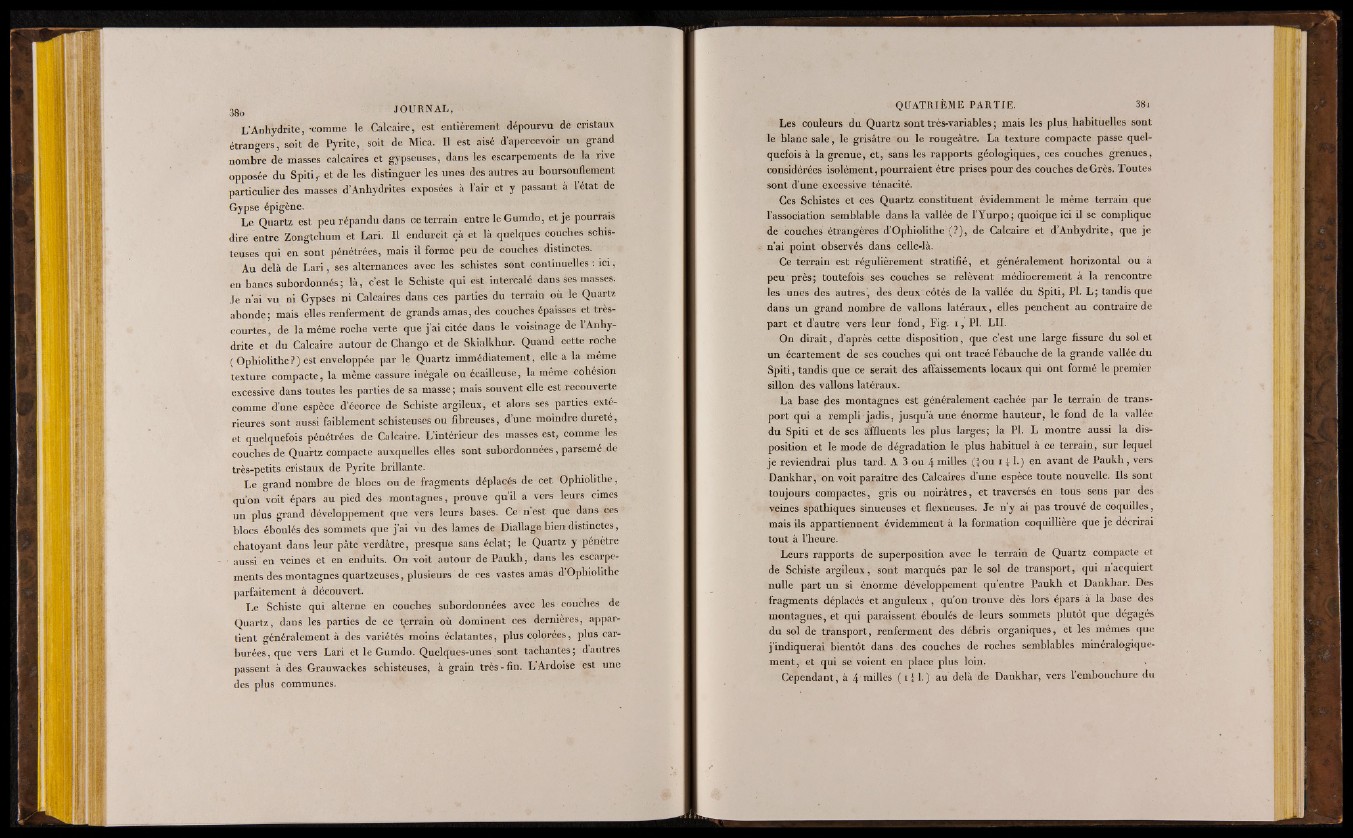
38.. JOURNAL, ;
L’Anhydrite, -comme le Calcaire, est entièrement dépourvu dé cristaux
étrangers, soit de Pyrite, soit de Mica. Il est aisé d’apercevoir un grand
nombre de masses calcaires et gypseuses, dans les escarpements de la rive
opposée du Spiti f et de les distinguer les unes des autres au boursouflement
particulier des masses d’Anhydrites exposées à l’air et y passant à lé ta t de
Gypse épigène.
Le Quartz est peu répandu dans ce terrain entre le Gumdo, et je pourrais
dire entre Zongtchum et Lari. Il endurcit çà et là quelques couches schisteuses
qui en sont pénétrées, mais il forme peu de couches distinctes.
Au delà de L a r i, ses alternances avec les schistes sont continuelles-: ic i,
en bancs subordonnés; là , c’est le Schiste qui est intercalé dans ses masses.
Je n’ai vu ni Gypses ni Calcaires dans ces parties du terrain où le Quartz
abonde; mais elles renferment de grands amas, des couches épaisses et tres-
courtes, de la même roehe verte que j ’ai citée dans le voisinage de lAnhy-
drite et du Calcaire autour de Chango et de Skialkhur. Quand cette roche
( Ophiolithe?) est enveloppée par le Quartz immédiatement, elle a la même
texture compacte, la même cassure inégale ou écailleuse, la même cohésion
excessive dans toutes les parties de sa masse ; mais souvent elle est recouverte
comme d’une espèce d’écorce de Schiste argileux, et alors ses parties extérieures
sont aussi faiblement schisteuses ou fibreuses, dune moindre dureté,
et quelquefois pénétrées de Calcaire. L ’intérieur des masses est, comme les
couches de Quartz compacte auxquelles elles sont subordonnées, parsemé de
très-petits cristaux de Pyrite brillante.
Le grand nombre de blocs ou de fragments déplacés de cet Ophiolithe,
qu’on voit épars au pied des montagnes, prouve qu’il a vers leurs cimes
un plus grand développement que vers leurs bases. Ce n est que dans ces
blocs éboulés des sommets que j ’ai vu des lames de Diallage bien distinctes,
chatoyant dans leur pâte verdâtre, presque sans éclat; le Quartz y pénètre
■ aussi en veines et en enduits. On voit autour de Paukh, dans les escarpements
des montagnes quartzeuses, plusieurs de ces vastes amas d Ophiolithe
parfaitement à découvert.
Le Schiste qui alterne en couches subordonnées avec les couches de
Quartz, dans les parties de ce terrain où dominent ces dernières, appartient
généralement à des variétés moins éclatantes, plus colorées, plus car-
burées, que vers Lari et le Gumdo. Quelques-unes .sont tachantesj ;dautres
passent à des Grauwackes schisteuses, à grain très-fin. L ’Ardoise est une
des plus communes.
Les couleurs du Quartz sont très-variables ; mais les plus habituelles sont
le blanc sale, le grisâtre ou le rougeâtre. La texture compacte passe quelquefois
à la grenue, et, sans les rapports géologiques, ces couches grenues,
considérées isolément, pourraient être prises pour des couches de Grès. Toutes
sont d’une excessive ténacité.
Ces Schistes et ces Quartz constituent évidemment le même terrain que
l’association semblable dans la vallée de l’Yurpo ; quoique ici il se complique
de couches étrangères d’Ophiolithe (?), de Calcaire et d’Anhydrite, que je
n’ai point observés dans celle-là.
Ce terrain est régulièrement stratifié, et généralement horizontal ou à
peu près; toutefois ses couches se relèvent médiocrement à la rencontre
les unes des autres’, des deux côtés de la vallée du Spiti, Pl. L ; tandis que
dans un grand nombre de vallons latéraux, elles penchent au contraire de
part et d’autre vers leur fond, Fig. i , Pl. LII.
On dirait, d’après cette disposition, que c’est une large fissure du sol et
un écartement de ses couches qui ont tracé l’ébauche de la grande vallée du
Spiti, tandis que ce serait des affaissements locaux qui ont formé le premier
sillon des vallons latéraux.
La base (les montagnes est généralement cachée par le terrain de transport
qui a rempli jadis, jusqua une énorme hauteur, le fond de la vallée
du Spiti et de ses SÎfluents les plus larges; la Pl. L montre aussi la disposition
et le mode de dégradation le plus habituel à ce terrain, sur lequel
je reviendrai plus tard. A 3 ou 4 milles (fou i J I. ) en avant de Paukh, vers
Dankhar, on voit paraître des Calcaires d’une espèce toute nouvelle. Us sont
toujours compactes, gris ou noirâtres, et traversés en tous sens par des
veines spathiques sinueuses et flexueuses. Je n’y ai pas trouvé de coquilles,
mais ils appartiennent évidemment à la formation coquillière que je décrirai
tout à l’heure.
Leurs rapports de superposition avec le terrain de Quartz compacte et
de Schiste argileux, sont marqués par le sol de transport, qui n acquiert
nulle part un si énorme développement qu’entre Paukh et Dankhar. Des
fragments déplacés et anguleux , qu’on trouve dès lors épars à la base des
montagnes, et qui paraissent éboulés de leurs sommets plutôt que dégagés
du sol de transport, renferment des débris organiques, et les mêmes que
j ’indiquerai bientôt dans des couches de roches semblables minéralogique-
ment, et qui se voient en place plus loin.
Cependant, à 4 milles ( i 11.) au delà de Dankhar, vers 1 embouchure du