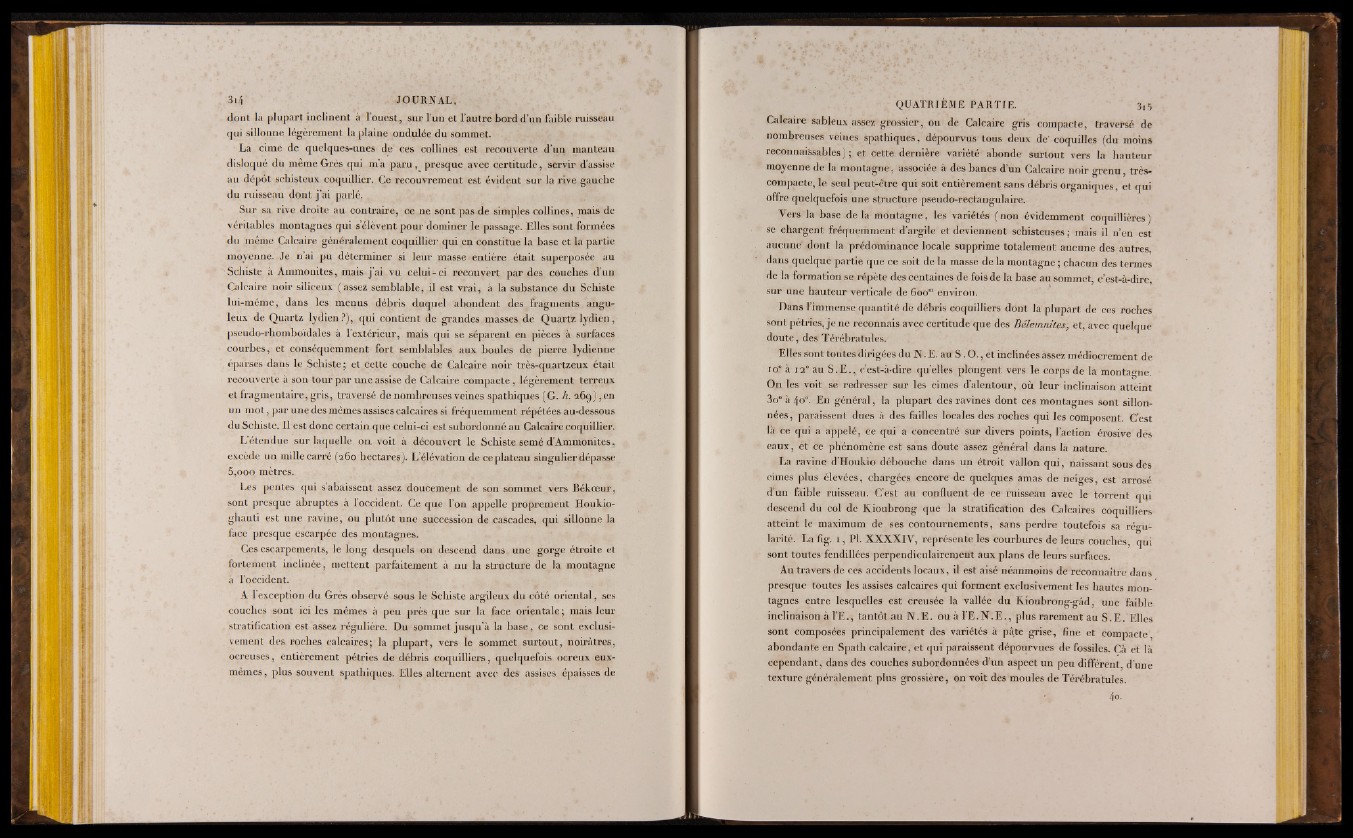
dont la plupart inclinent à l’ouest , sur l'un et l’autre bord d’un faible ruisseau
qui sillonne légèrement la plaine ondulée du sommet.
La cime de quelques-unes de ces collines est recouverte d’un manteau
disloqué du meme Grès qui m’a p aru , presque avec certitude, servir d’assise
au dépôt schisteux coquillier. Ce recouvrement est évident sur la rive gauche
du ruisseau dont j ’ai parlé; .
Sur sa rive droite au contraire, ce ne sont pas de simples collines, mais de
véritables montagnes qui s’élèvent pour dominer le passage. Elles sont formées
du même Calcaire généralement coquillier qui en constitue la base et la partie
moyenne. Je n’ai pu déterminer si leur masse entière était superposée au
Schiste à Ammonites, mais j ’ai vu celui-ci recouvert par des couches d’un
Calcaire noir siliceux (assez semblable, il est vrai, à la substance du Schiste
lui-même, dans les menus débris duquel abondent des fragments anguleux
de Quartz lydien?), qui contient de grandes masses de Quartz lydien,
pseudo-rhomboïdales à l’extérieur, mais qui se séparent en pièces à surfaces
courbes, et conséquemment fort semblables aux boules de pierre lydienne
éparses dans le Schiste; et cette couche de Calcaire noir très-quartzeux était
recouverte à son tour par une assise de Calcaire compacte , légèrement terreux
et fragmentaire, gris, traversé de nombreuses veines spathiques (G. h. 269) , en
un mot, par une des mêmes assises calcaires si fréquemment répétées au-dessous
du Schiste. Il est donc certain que celui-ci est subordonné au Calcaire coquillier.
L’étendue sur laquelle on voit à découvert le Schiste semé d’Ammonites,
excède un mille carré (260 hectares). L’élévation de ce plateau singulier dépasse
5,ooo mètres.
Les pentes qui s’abaissent assez doucement de son sommet vers Békoeur,
sont presque abruptes à l’occident. Ce que1 l’on appelle proprement Houkio-
ghauti est une ravine, ou plutôt une succession de cascades, qui sillonne la
face presque escarpée des montagnes.
Ces escarpements, le long desquels on descend dans une gorge étroite et
fortement inclinée, mettent parfaitement à nu la structure de la montagne
à l’occident.
A 1 exception du Grès observé sous le Schiste argileux du côté oriental, ses
couches sont ici les mêmes à peu près que sur la face orientale ; mais leur
stratification est assez régulière. Du sommet jusqu’à la base, ce sont exclusivement
des roches calcaires; la plupart, vers le sommet surtout, noirâtres,
ocreuses, entièrement pétries de débris coquilliers, quelquefois ocreux eux-
mêmes, plus souvent spathiques. Elles alternent avec des assises épaisses de
Calcaire sableux assez grossier, ou de Calcaire gris compacte, traversé de
nombreuses veines spathiques, dépourvus tous deux de' coquilles (du moins
reconnaissables); et cette dernière variété abonde surtout vers la hauteur
moyenne de la montagne, associée à des bancs d’un Calcaire noir grenu, très-
compacte, le seul peut-être qui soit entièrement sans débris organiques, et qui
offre quelquefois une structure pseudo-rectangulaire.
Vers la base de là montagne, les variétés (non évidemment coquillières)
se chargent fréquemment d’argile et deviennent schisteuses ; mais il n’en est
aucune dont la prédominance locale supprime totalement aucune des autres
dans quelque partie que ce soit de la masse de la montagne ; chacun des termes
de la formation se répète des centaines de fois de la base au sommet, c’est-à-dire,
sur une hauteur verticale de 6oom environ.
Dans l’immense quantité de débris coquilliers dont la plupart de ces roches
sont pétries, je ne reconnais avec certitude que des Bêlemnites, et, avec quelque
doute, des Térébratules.
EllesAont toutes dirigées du N.E. au S. O ., et inclinées assez médiocrement de
1 o° à 12° au S .E ., c’est-à-dire quelles plongent vers le corps de la montagne.
On les voit se redresser sur les cimes d’alentour, où leur inclinaison atteint
3o° à 40“. En général, la plupart des ravines dont ces montagnes sont sillonnées,
paraissent dues à des failles locales des roches qui les composent. C’est
là ce qui a appelé, ce qui a concentré sur divers points, l'action érosive des
eaux, et ce phénomène est sans doute assez général dans la nature.
La ravine d’Houkio débouche dans un étroit vallon qui, naissant sous des
cimes plus élevées, chargées encore de quelques amas de neiges, est arrosé
d'un faible ruisseau. C’est au confluent de ce ruisseau avec le torrent qqi
descend du col de Kioubrong que la stratification des Calcaires coquilliers
atteint le maximum de ses contournements, sans perdre toutefois sa régularité.
La fig. 1, Pl. X X X X IV , représente les courbures de leurs couches, qui
sont toutes fendillées perpendiculairement aux plans de leurs surfaces.
Au travers de ces accidents locaux, il est aisé néanmoins de reconnaître dans
presque toutes les assises calcaires qui forment exclusivement les hautes montagnes
entre lesquelles est creusée la vallée du Rioubrong-gâd, une faible
inclinaison à l’E ., tantôt au N .E . ou à l’E .N .E . , plus rarement au S .E . Elles
sont composées principalement des variétés à pâte grise, fine et compacte,
abondante en Spath calcaire, et qui paraissent dépourvues de fossiles. Cà et là
cependant, dans des couches subordonnées d’un aspect un peu différent, d’une
texture généralement plus grossière, on voit des moules de Térébratules.
4o.