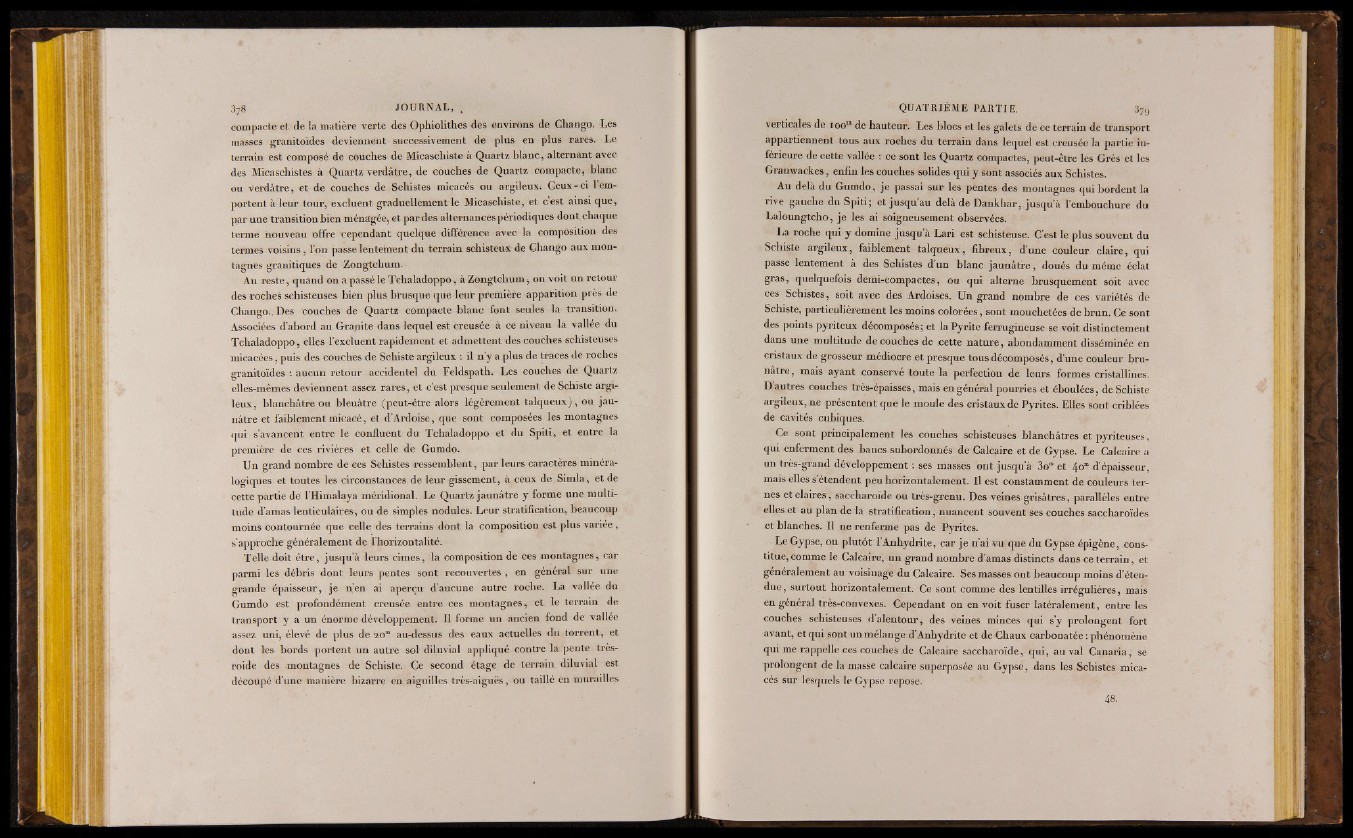
compacte et de la matière verte des Ophiolithes des environs de Chango. Les
masses granitoïdes deviennent successivement de plus en plus rares. Le
terrain est composé de couches de Micaschiste à Quartz blanc, alternant avec
des Micaschistes à Quartz verdâtre, de couches de Quartz compacte, blanc
ou verdâtre, et de couches de Schistes micacés ou argileux. Ceux-ci l'emportent
à leur tour, excluent graduellement le Micaschiste, et cest ainsi que,
par une transition bien ménagée-, et pardes alternances périodiques dont chaque
terme nouveau offre cependant quelque différence avec la composition des
termes voisins, l’on passe lenteïnent du terrain schisteux de Ghango aux montagnes
granitiques de Zongtchum.
Au reste, quand on a passé le Tehaladoppo| à Zongtchum, on voit un retour
des roches schisteuses bien pliis brusque que leur première apparition près de
Chango., Des couches de Quartz compacte blanc font seules la transition,
Associées d'abord au Granité dans lequel est creusée à cé niveau la vallée du
Tehaladoppo, elles l’excluent rapidement et admettent des couches schisteuses
micacées, puis des couches de Schiste argileux : il n’y a plus de tracés de roches
granitoïdes : aucun retour accidentel du Feldspath. Les couches de Quartz
elles-mêmes deviennent assez rares, et cest presque seulement de Schiste argileux,
blanchâtre ou bleuâtre (peut-être alors légèrement talqueux), ou jaunâtre
et faiblement micacé, et d’Ardoise, que sont composées les montagnes
qui s’avancent entre le confluent du Tehaladoppo et du Spiti', et entre la
première de ces rivières et celle de Gumdo.
Un grand nombre de ces Schistes ressemblent, par leurs caractères minéra-
logiques et toutes les circonstances.de leur gissement, à ceux de Simla, et de
cette partie dé l ’Himalaya méridional. Le Quartz jaunâtre y forme une multitude
d’amas lenticulaires, ou de simples nodules. Leur stratification, beaucoup
moins contournée que celle des terrains dont la composition est plus variée ,
s’approche généralement de l’horizontalité.
Telle doit être, jusqu’à leurs cimes, la composition de ces montagnes, oar
parmi les débris dont leurs pentes sont recouvertes , en général sur une
grande épaisseur, je nen ai aperçu d’aucune autre roche. La vallée du
Gumdo est profondément creusée entre ces montagnes, et le terrain de
transport y a un énorme développement. Il forme un ancien fond de vallée
assez uni, élevé de plus de 20“ au-dessus des eaux actuelles du torrent, et
dont les bords portent un autre sol diluvial appliqué contre la. pente très-
roide des montagnes de Schiste. Ce second étage de terrain diluvial est
découpé d’une manière bizarre en aiguilles très-aiguës, ou taillé en murailles
verticales de ioow de hauteur. Les blocs et les galets de ce terrain de transport
appartiennent tous aux roches du terrain dans lequel est creusée la partie inférieure
de cette vallée : ce sont les Quartz compactes, peut-être les Grès et les
Grauwackes, enfin les couches solides qui y sont associés aux Schistes.
Au delà du Gumdo, je passai sur les pentes des montagnes qui bordent la
rive gauche du Spiti; et jusqu’au delà de Dankhar, ju sq u a l’embouchure du
Laloungteho, je les ai soigneusement observées.
La roche qui y domine jusqu’à Lari est schisteuse. G’est le plus souvent du
Schiste argileux, faiblement talqueux, fibreux, d’une couleur claire, qui
passe lentement à des Schistes dun blanc jaunâtre, doués du même éclat
gras, quelquefois demi-compactes, ou qui alterne brusquement soit avec
ces Schistes, soit avec des Ardoises. Un grand nombre de ces variétés de
Schiste, particulièrement les moins colorées, sont mouchetées de brun. Ce sont
des points pyriteux décomposés; et la Pyrite ferrugineuse se voit distinctement
dans une multitude de couches .de cette nature, abondamment disséminée en
cristaux de grosseur médiocre et presque tous décomposés, d’une coule ur brunâtre,
mais ayant conservé toute la perfection de leurs formes cristallines.
D autres couches très-épaisses, mais en général pourries et éboulées, de Schiste
argileux, ne présentent que le moule des cristaux de Pyrites. Elles sont criblées
de cavités cubiques.
Ce sont principalement les couches schisteuses blanchâtres ët pyriteuses,
qui enferment des bancs subordonnés de Calcaire et de Gypse. Le Calcaire a
un très-grand développement : ses masses ont jusqu’à 3o" et 40" d’épaisseur,
mais elles s’étendent peu horizontalement. Il est constamment de couleurs ternes
et claires, saceharoïde ou très-grenu. Des veines grisâtres, parallèles entre
elles et au plan de la stratification, nuancent souvent ses couches saecharoïdes
e t blanches. I l ne renferme pas de Pyrites.
Le Gypse, ou plutôt l’Anhydrite, car je n’ai vu que du Gypse épigène, constitue,
comme le Caleaire, un grand nombre d’amas distincts dans ce terrain, et
généralement au voisinage du Calcaire. Ses masses ont beaucoup moins d étendue,
surtout horizontalement. Ce sont comme des lentilles irrégulières, mais
en général très-convexes. Cependant on en voit fuser latéralement, entre les
couches schisteuses d alentour, des veines minces qui s’y prolongent fort
avant, et qui sont un mélange d’Anhydrite et de Chaux carbooatée : phénomène
qui me rappelle ces couches de Caleaire saceharoïde, qui, au val Canaria, se
prolongent de la masse calcaire superposée au Gypse, dans les Schistes micacés
sur lesquels le Gypse repose.