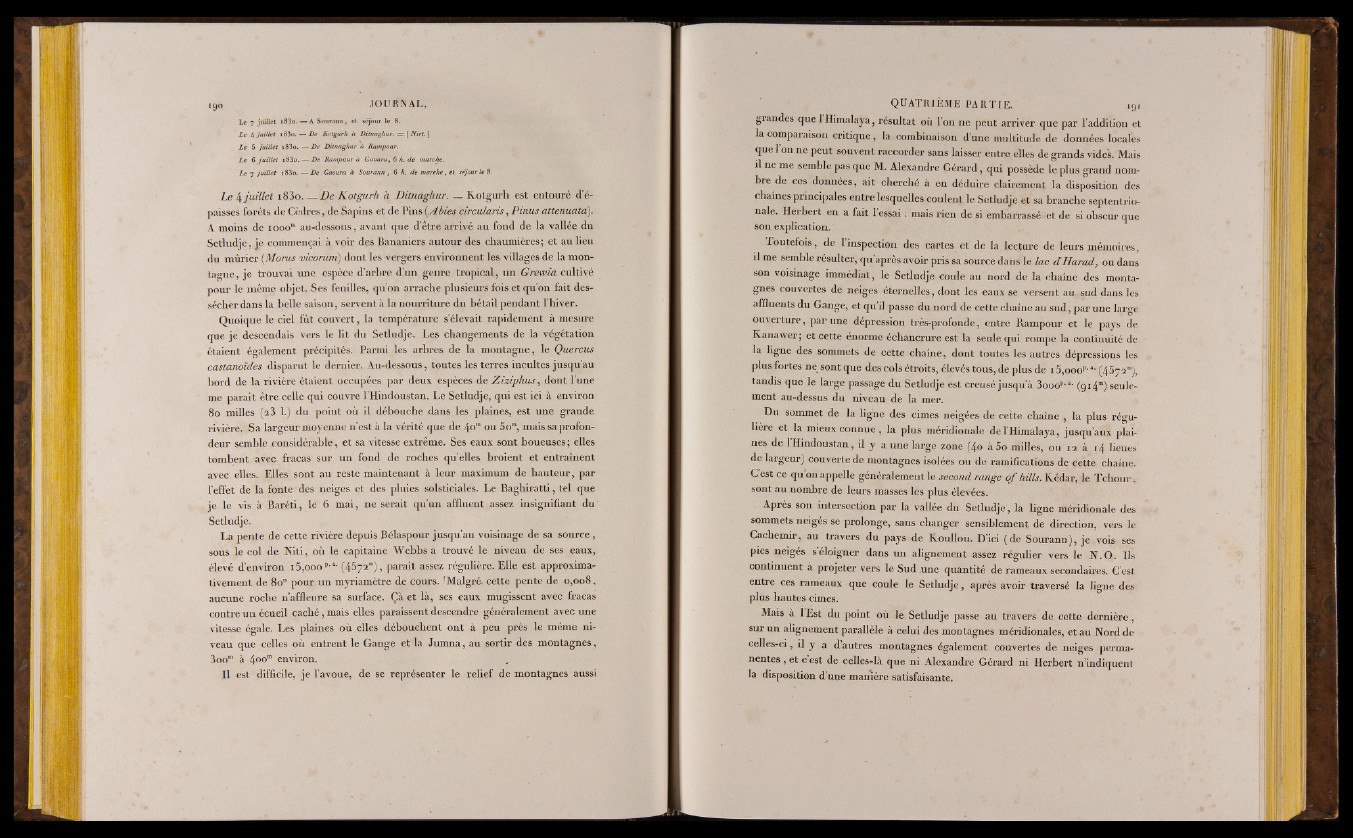
Le 7 juillet j8 3 o .— A Sourann, et séjour le 8.
L e 4 juillet i8 3 o .— De Kolgurh à Ditnaghur. — [Nirt.]
Le 5 juillet i83o. — De Ditnaghur à Ram pour.
L e S ju ille t x83o. — De Rampour à Gaoura, 6 h. de marche.
Le 7 juillet 1 83o. — De Gaoura à Sourann , 6 h. de marche, et séjour le 8.
Le 4 juillet i 83o . De Kotgurh à Ditnaghur. — Kotgurh est entouré d’épaisses
forêts de Cèdres, de Sapins et de Pins (Abies circularis, Pinus attenuatà).
A moins de iooom au-dessous, avant que d’être arrivé au fond de la vallée du
Setludje, je commençai à voir des Bananiers autour des chaumières; et au lieu
du mûrier (Morus vicorum) dont les vergers environnent les villages de la montagne,
je trouvai une espèce d’arbre d'un genre tropical, un Grewia cultivé
pour le même objet. Ses feuilles, qu’on arrache plusieurs fois et qu’on fait dessécher
dans la belle saison, servent à la nourriture du bétail pendant l’hiver.
Quoique le ciel fût couvert, la température s’élevait rapidement à mesure
que je descendais vers le lit du Setludje, Les changements de la végétation
étaient également précipités. Parmi les arbres de la montagne, le Quercus
castanoïdes disparut le dernier. Au-dessous, toutes les terres incultes jusqu’au
bord de la rivièrè étaient occupées par deux espèces de Ziziphus, dont l’une
me paraît être celle qui couvre l’Hindoustan. Le Setludje, qui est ici à environ
8o milles Çû3 1.) du point où il débouche dans les plaines, est une grande
rivière. Sa largeur moyenne n’est à la vérité que de 4om ou 5om, mais sa profondeur
semble considérable, et sa vitesse extrême. Ses eaux sont boueuses ; elles
tombent avec fracas sur un fond de roches qu’elles broient et entraînent
avec elles. Elles sont au reste maintenant à leur maximum de hauteur, par
l'effet de la fonte des neiges et des pluies solsticiales. Le Bagbiratti, tel que
je le vis à Baréti, le 6 mai, ne serait qu’un affluent assez insignifiant du
Setludje.
La pente de cette rivière depuis Bélaspour jusqu’au voisinage de sa source ,
sous le col de Niti, où le capitaine Webbs a trouvé le niveau de ses eaux,
élevé d'environ i 5,ooopa- (4572”) , parait assez régulière. Elle est approximativement
de 80” pour un myriamètre de cours. (Malgré, cette pente de 0,008,
aucune roche n’affleure sa surface. Çà et là, ses eaux mugissent avec fracas
contre un écueil caché, mais elles paraissent descendre généralement avec une
vitesse égale. Les plaines où elles débouchent ont à peu près le même niveau
que celles où entrent le Gange et la Jurnna, au sortir des montagnes,
3oom à 4°om environ.
Il est difficile, je l’avoue, de se représenter le relief de montagnes aussi
grandes que 1 Himalaya, résultat où l’on ne peut arriver que par l’addition et
la comparaison critique, la combinaison d’une multitude de données locales
que 1 on ne peut souvent raccorder sans laisser entre elles de grands vides. Mais
il ne me semble pas que M. Alexandre Gérard, qui possède le plus grand nombre
de ces données, ait cherché à en déduire clairement la disposition des
chaines principales entre lesquelles coulent le Setludje et sa branche septentrionale.
Herbert en a fait 1 essai : mais rien de si embarrassé*et de si obscur que
Son explication.
Toutefois, de 1 inspection des cartes et de la lecture de leurs mémoires,
il me semble résulter, qu’après avoir pris sa source dans le lac dHarad, ou dans
son voisinage immédiat, le Setludje coule au nord de la chaîne des montagnes
couvertes de neiges éternelles, dont les eaux se versent au sud dans les
affluents du Gange, et qu’il passe du nord de cette chaîne au sud, par une large
ouverture, par une dépression très-profonde, entre Rampour et le pays de
Kanawer; et cette énorme échancrure est la seule qui rompe la continuité de
la hgne des sommets de cette chaîne, dont toutes les autres dépressions les
plus fortes ne sont que des cols étroits, élevés tous, de plus de 15,ooop' “• (4572“),
tandis que le large passage du Setludje est creusé jusqu’à 3ooopa’ (g 14m) seulement
au-dessus du niveau de la mer.
Du sommet de la ligne des cimes neigées de cette chaîne , la plus régulière
et la mieux connue, la plus méridionale de l’Himalaya, jusqu’aux plaines
de IHindoustan, d y a une large zone (40 à 5 o milles, ou 12 à 14 lieues
de largeur) couverte de montagnes isolées ou de ramifications de cette chaîne.
C’est ce qu’on appelle généralement le second range of hills. Kédar, le Tchour,
sont au nombre de leurs masses les plus élevées.
Après son intersection par la vallée du Setludje, la ligne méridionale des
sommets neigés se prolonge, sans changer sensiblement dé direction, vers le
Cachemir, au travers du pays de K.oullou. D’ici (de Sourann), je vois ses
pics neigés s éloigner dans un alignement assez régulier vers le N .O . Ils
continuent à projeter vers le Sud ,une quantité de rameaux secondaires. C’est
entre ces rameaux que coule le Setludje, après avoir traversé la ligne des
plus hautes çimes.
Mais à 1 Est du point où le Setludje passe au travers de cette dernière,
sur un alignement parallèle à celui des montagnes méridionales, et au Nord de
celles-ci, il y a d autres montagnes également couvertes de neiges permanentes
, et c est de celles-là que ni Alexandre Gérard ni Herbert n’indiquent
la disposition d’uije manière satisfaisante.