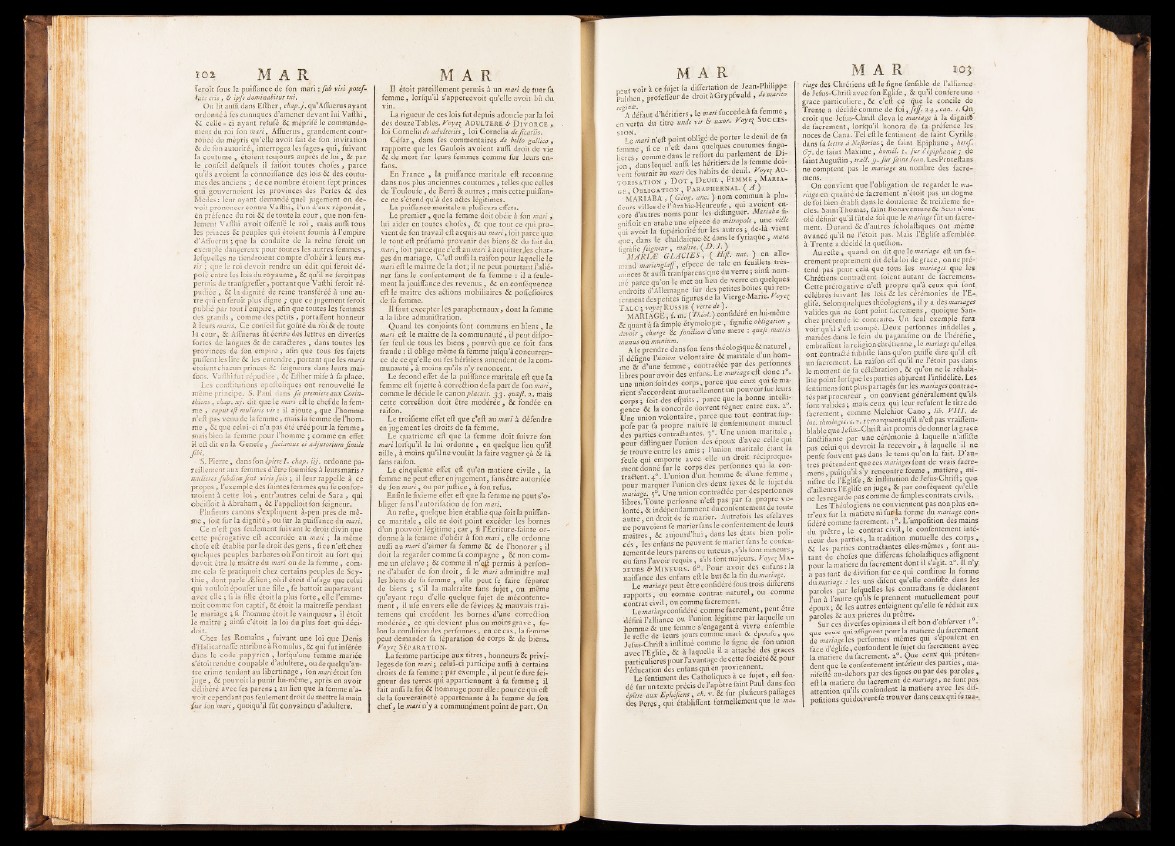
ÏG 2 M A R
feroit fous la puiffance de fon mari : fub viri potef-
ïate ëris , & ipfe dominabitur tut.
On lit auffi dans Efther, chap.j. qu’Affuerus ayant
ordonné à fes eunuques d’amener devant lui Vafthi,
& celle - ci ayant refufé & méprifé le commandement
du roi fon mari, Affuerus , grandement courroucé
du mépris qu’elle avoit fait de fon invitation
& de fon autorité;, interrogea les fages, qui, fuivant
Ta coutume , étoient toujours auprès de lu i, & par
le confeil defquels il faifoit toutes chofes, parce
qu’ils avoient la connoiffance des lois 8c des coutumes
des anciens ; de ce nombre étoient fept princes
qui gouvemoient les provinces des Perfes Sc des
Médes : leur ayant demandé quel jugement on de-
voit prononcer contre Vafthi, l ’un d’eux répondit,
On préfence du roi 8c de toute la cour, que non-feulement
Vafthi avoit offenfé le ro i, mais auffi tous
les princes 8c peuples qui étoient fournis à l’empire
d’Affuerus ; que la conduite de la reine feroit un
exemple dangereux pour toutes les autres femmes,
lefquelles ne tiendroient compte d’obéir à leurs maris
; que le roi devoit rendre un édit qui feroit dé-
pofé entre les lois du royaume, 8c qu’il ne feroit pas
permis de tranfgreffer, portant que Vafthi feroit répudiée
, 8c la dignité de reine transféréé à une autre
qui en feroit plus digne ,• que ce jugement feroit
publié par tout l’empire, afin que toutes les femmes
des grands , comme des petits , portaffent honneur
à leurs maris. Ce confeil fut goûté du roi & de toute
la cour, & Affuerus fit écrire des lettres en diverfes
fortes de langues 8c de caractères , dans toutes les
provinces de fon empire , afin que tous fes fujets
puffent les lire 8c les entendre, portant que les maris
étoient chacun princes 8c feigneurs dans leurs mai-
fons. Vafthi fut répudiée , 8c Efther mife à fa place.
Les conftitutions apoftoliques ont renouvellé le
même principe. S. Paul dans fa première aux Corinthiens
, chap. xj. dit que le mari eft le chef de la femme
, caput efl mulieris vir : il ajoute , que l’homme
n’eft pas venu de la femme, mais la femme de l’homme
, & que celui-ci n’a pas été créé pour la femme,
mais bien la femme pour l’homme ; comme en effet
il eft dit en la Genefe, faciamus ei adjutorium Jimile
JH . WÊÈÊÊk
'S. Pierre, dans fon epitreI. chap. iij. ordonne pareillement
aux femmes d’être foumifes à leurs maris :
mulieres fubditee jint viris fuis ; il leur rappelle à ce
propos, l’exemple des faintes femmes qui fe confor-
moient à cette lo i, entr’autres celui de Sara , qui
obéiffoit à Abraham, & l’appelloitfon feigneur.
Plufieurs canons s’expliquent à-peu-près de même
, l'oit fur la dignité, ou fur la puiffance du mari.
Ce n’eft pas feulement fuivant le droit divin que
cette prérogative eft accordée au mari ; la même
chofe eft établie par le droit des gens, fi ce n’eft chez
quelques peuples barbares où l’on droit au fort qui
devoit être le maître du mari ou de la femme , comme
cela fe pratiquoit chez certains peuples de Scy-
th ie, dont parle Ælien ; où il étoit d’ufage que celui
qui vouloit époufer une fille, fe battoit auparavant
avec elle ; fi la fille étoit la plus forte, elle l’emme-
noit comme fon captif, & étoit la maîtreffe pendant
le mariage ; fi 1 homme étoit le vainqueur, il étoit
le maître ; ainfi c’étoit la loi du plus fort qui déci-
doit.
Chez les Romains , fuivant une loi que Denis
d’Halicarnaffe attribue à Romulus, 8c qui fut inférée
dans le code papyrien , lorfqu’une femme mariée
s’étoit rendue coupable d’adultere, ou de quelqu’au-
tre crime tendant au libertinage , fon mari étoit fon
juge , 8c pou voit la punir lui-même, après en avoir
délibéré avec fes parent ; au lieu que la femme n’a-
voit cependant pas feulement droit de mettre la main
jfiu- ion'mari,r quoiqu’il fût convaincu d’adultere.
M A R
Il étoit pareillement permis à un mari de tuer fa
femme , lorfqu’il s’appercevoit qu’elle avoit bû du
vin.L
a rigueur de ces lois fut depuis adoucie par la loi
des douze Tables. Voyei Adultéré & Divorce ,
loi Cornelia de adulteriis, loi Cornelia deficariis.
Céfar , dans fes commentaires de bello gallico ,
rapporte que les Gaulois avoient auffi droit de vie
8c de mort fur leurs femmes comme fur leurs en-
fans..
En France , la puiffance maritale eft reconnue,
dans nos plus anciennes coutumes, telles que celles
de Touloufe , de Berri & autres ; mais cette puiffance
ne s’étend qu’à des aâes légitimes.
La puiffance maritale a plufieurs effets.
Le premier , que la femme doit obéir à fon mari ,
lui aider en toutes chofes, 8c que tout ce qui provient
de fon travail eft acquis au mari, {oit parce que
le tout eft préfumé provenir des biens 8c du fait du.
mari, foit parce que c’eft au mari à acquitter Jles charges
du mariage, C ’eft auffi la raifon pour laquelle le
mari eft le maure de la dot ; il ne peut pourtant l’aliéner
fans le confentement de fa femme : il a feulement
la jouiffance des revenus, 8c en conféquence
eft le maître des aérions mobiliaires 8c poffeffoires
de fa femme.
Il faut excepter les paraphernaux, dont la femme
a la libre adminiftration.
Quand les conjoints font communs en biens, le
mari eft le maître de la communauté, il peut difpo-
fer feul de tous les biens , pourvû que ce foit fans
fraude : il oblige même fa femme jufqu’à concurrence
de ce qu’elle ou fes héritiers.amendent de la communauté
, à moins qu’ils n’y renoncent.
Le fécond effet de la puiffance maritale eft que la
femme eft fujette à correérion de la part de fon mari,
comme le décide le canonplacuit. j j . quoejl. a. mais
cette correérion doit être modérée, 8c fondée en
raifon.
Le troifieme effet eft que c’eft au mari à défendre
en jugement les droits de fa femme.
Le quatrième eft que la femme doit fuivre fon
mari lorfqu’il le lui ordonne , en quelque lieu qu’il
aille, à moins qu’il ne voulût la faire vaguer çà & là
fans raifon.
Le cinquième effet eft qu’en matière civile , la
femme ne peut efter en jugement, fans être autorifée
de fon mari, ou par juftice, à fon refus.
Enfin le fixieme effet eft que la femme ne peut s’obliger
fans l’autorifation de fon mari.
Au refte, quelque bien établie que foit la puiffance
maritale, elle ne doit point excéder les bornes
d’un pouvoir légitime ; car , fi l’Ecriture-fainte ordonne
à la femme d’obéir à fon mari, elle ordonne
auffi au mari d’aimer fa femme 8c de l’honorer ; il
doit la regarder comme fa compagne , 8c non comme
un efclave ; 8c comme il n’<ffl permis à perfon-
ne d’abufer de fon droit, fi le mari adminiftre mal
les biens de fa femme , elle peut fe faire féparer
de biens ; s’il la maltraite fans fujet, ou même
qu’ayant reçu d’elle quelque fujet de mécontentement
, il ufe envers elle de févices 8c mauvais trai-
temens qui excédent les bornes d’une correérion
modérée, ce qui devient plus ou moins grave , félon
la condition des perfonnes, en ce cas, la femme
peut demander fa féparation de corps & de biens.
Voye{ SÉPARATION.
La femme participe aux titres, honneurs 8c privilèges
de fon mari ; celui-ci participe auffi à certains
droits de fa femme : par exemple, il peut fe dire feigneur
des terres qui appartiennent à fa femme ; il
fait auffi la foi 8c hommage pour elle: pour ce qui eft
de la fouveraineté appartenante à la femme de fon
chef, le mari n’y a communément point de part. On
il
M A R
M v0;r à Ce fujet la differtation de Jean-Philippe
Palthen, profeffeurde droitàGrypfwald, demarito
r‘Sk défaut d’héritiers, le mari fuccede.à fa femme ,
eu vertu dti jitre m i t »JW6" axor. R<ry‘ l S o c c is -
SIL e'mari n’eft point obligé-de porter le deuil; de fa
femme y fi ce n'eft dans quelques coutumesTingu-
lierés, comme dansle reffort du parlement de Dijon
, dans lequel a'uffi les héritiers de la femme doi- :
vent fournir au mari des habits de demi. ^ Autorisation
, Dot , Deuil-' Femme, Maria-
ge, Obligation , Paraphernal. ( A )
MARIABA, (Géog. anc. ) nom commun à plufieurs
villes de l’Arabie-Heureufe, qui avoient encore
d’autres noms pour lesAiftinguer. Manabaix-
gnifioit en arabe une efpece de métropole , une ville
qui avoit là fupériorité fur les autres ; de-la vient
que,;dan-s le -chaldaïqu;e.&dansle.fyriaqùe:, rmm
ftgnifiefeignèiir\ rnaîtreJ^D.J.J
MARIAE U LACIE S, .(•■ ?/<//. rrat. ) en allemand
mariehgUJp, efpece’ de- talc en feuillets très- -
minces & auffi tranfp'arenfque du verre ; ainfi mom-
riié parce qu’on le met au lieu de.verre en. quelques
endroits d’Allemagne fur des petites boites qui renferment
despétitêsifiguresde la Vierge-Marie. Voyt®\
T a l c ; tw -r Russie ( v in tdt!):,'■ ■ , I . ■
MARIAGE-, f.'m. («feA)confidere en lui-même
& quant à fa fimple étymologie , lignifie obligation r-
ditfoir ■ Èharge i c ‘fànSioa’ d’une mere : quaji..matns
munus ou -mûnium. . „ ,
A le prendre dans fon fens theologique &; naturel,
U âêûehe l’uhion volontaire & maritale d un homme
& d’une femme, cô.n-traâée par des perlonnes
libres pour avoir des enfans. Le-mariage elt donc i .
une union foitdes corps, parce.que ceux qui le marient
S’accordent mutuellement un pouvoir fur leurs
corps ; foit des efprits,’ parce que la bonne intelligence
& la concorde doivent régner entre eux. 2 .
XJne union volontaire, parce que tout contrat lup-
pofe par fa propre nature le conlentement mutuell
des parties contrariantes. 30. Une union maritale ,
pour diftinguer l’union des époux d avec celle qui
fe trouve entre les amis ; l ’union maritale étant la
feule qui. empçrte avec elle un droit réciproquement
donné fur le corps des perfonnes qui la contrarient.
40. L’union d’un homme & d une remme,
pour marquer l’union des deux fexes & le fujet du
mariage, f . Une union contrariée par des perfonnes
libres. Toute perfonne n’eft pas par fa propre volonté
, & indépendamment du confentement de toute
autre en droit de fe marier. Autrefois les efclaves
ne pouvoient fe marier fans le confentement de leurs
maîtres, & aujourd’hui, dans les états bien policés
, les enfans ne peuvent fe marier fans le confen-
îementde leurs parens ou tuteurs, s ils font mineurs,
ou fans l’avoir requis , s’ils font majeurs. Voye^ Majeurs
& Mineurs. 6°. Pour avoir des enfans : 1a
naiffance des enfans eft le but & la fin du mariage.
Le mariage peut être confidéré fous, trois différens
rapports, ou somme contrat naturel, ou comme
contrat c ivil, ou comme facrement.
Le mariage confidéré comme facrement, peut être
défini l’alliance ou l’union légitime par laquelle un
homme & une femme s’engagent à vivre enfemble
le refte de leurs jours comme mari & epoufe, que
Jefus-Chrift a inftitué comme le figne de fon union
avec l’Eglife, & à laquelle il a attaché des. grâces
particulières pour l’avantage de cette focieté& pour
l ’éducation des enfans qui en proviennent.
Le fentiment des Catholiques a ce fujet, ell fondé
fur un texte précis de l’apôtre faint Paul dans fon
épître aux Ephéfiens, ch. v. & fur plufieurs paffages
M A R 103
riage des Chrétiens eft le figne fenfible de l’alliance
de Jefus-Chrift avec fon Eglife , & qu’il conféré une -
grâce particulière, 8c c’ell ce (fue le concile de
Trente a décidé comme de {oi,fejf.Z4y can. /.On
croit que Jefus-Chrift éleva le mariage à la dignité
de facrement, lorfqu’il honora de fa préfence les
noces de Cana. T el eft le fentiment de làint Cyrille,
dans fa lettre à Neforius ; de faint Epiphane , heref, ,
Gy. de faint Maxime, homél. 1. fur Cépiphanie ; de
faint Auguftin, tracl. 9 . fur faint Jean. Les Proteftans
ne comptent pas le mariage au nombre des facre- j
mens. . '
On convient que l’obligation de regarder le ma--
riage en qualité de facrement n’étoit pas un dogme
de foi bien établi dans le douzième 8c treizième fie-
cles. SainiThomas, faint Bonaventure 8c Scot n’ont
ofé définir qu’il fût de foi que le mariage fut un facre-;
ment. Durand 8c d’autres fcholaftiques ont même
avancé qu’il ne l’étoit pas. Mais l’Eglife affemblée
à Trente a décidé la queftion.
Au. refte , quand on dit que lq mariage eft un fa-,
crement proprement dit de la loi de grâce, on ne pré-'
tend pas pour cela que tous les mariages que les
Chrétiens comiaêlent foient autant de facremens.
Cette prérogative n’eft propre qu’à ceux qui font
célébrés fuivant les lois 8c les cérémonies de TE-,
glife. Sèlonquelques théologiens, il y a des mariages
valides qui ne font point facremens, quoique Sanchez
prétende le contraire. Un feul exemple fera-
voir qu’il s’eft trompé. Deux perfonnes infidelles ,
mariées dans le fein du paganifme ou de l’héréfie,
embraffent la religion chrétienne, le mariage qu’elles
! ont contrarié fubfifte fans qu’on puiffe dire qu’il eft
un facrement. La raifon eft qu’il ne l’étoit pas dans
le moment de fa célébration, 8c qu’on ne le, réhabilite
point, lorfq.ue les parties abjurent l’infidélité. Les
fentimens font plus partagés fur les mariages contrac-
I tés par procureur , on convient généralement qu’ils
font valides ; mais ceux qui leur refufent le titre de
facrement, comme Melchior Cano , lib. VIII. de
loc. théologie, c.v. remarquent qu’il n’eft pas vraiffem-
f blable que Jefus-Chrift ait promis de donner la grâce;
fan&ifiante par une cérémonie à laquelle n’affifte
pas celui qui devroit la recevoir S à laquelle il ne
penfe fouvent pas dans le tems qu’on la fait. D ’autres
prétendent que ces mariages font de vrais facremens
puifqu’il s’y rencontre forme , matière, mi-
niftre de l’Eglife, & inftitution de Jefus-Chrift ; que
d’ailleurs l’Eglife en juge, & par çonféquent qu’elle
ne les regarde pas comme de fimples contrats civils. ;
Les Théologiens ne conviennent pas non plus en-
tr’eux fur la matière ni fuWa forme du mariage confidéré
comme facrement. i° . L ’impofition des mains’
du prêtre, le contrat civil, le confentement intérieur
des parties, la tradition mutuelle des corps ,
8c les parties contractantes elles-mêmes , font autant
de chofes que différens fcholaftiques affignent
pour la matière du facrement dont il s’agit. z°. Il n’y.
a pas tant de divifion fur ce qui conftitue la forme
du mariage : les uns difent qu’elle confifte dans les
paroles par lefquelles les contra&ans fe déclarent
l’un à l’autre qu’ils fe prennent mutuellement pour
époux ; 8c les autres enl'eignent qu’elle fe réduit aux
paroles 8c aux prières du prêtre. ô -
Sur ces diverfes opinions il eft bon d’obferver 1 .
que ceux qui affignent pour la matière du facrement
de mariage les perfonnes mêmes qui s’epoufent en
face d’églife, confondent le fujet du facrement avec
la matière du facrement. z°. Que c®ux qui prétendent
que le confentement intérieur des parties, ma*
nifefte au-dehors par des figues ou par des paroles ,
eft la matière du facrement de mariage, ne font pas
attention qu’ils confondent la matière avec les g g j
polirions qui doivent fe trouver dans ceux.qui fo ma