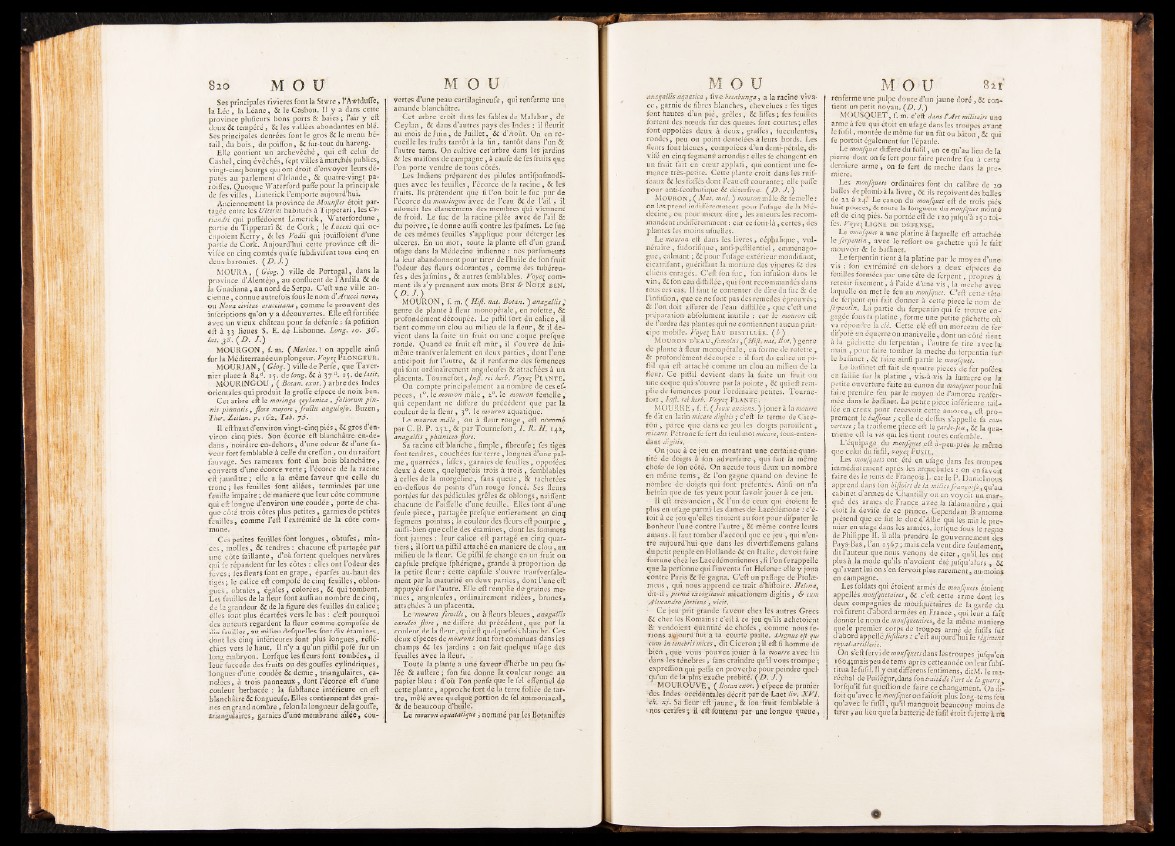
Ses principales rivières font la Stwre, l’Awtduffe,
!a Lée , la Léane, & le Cashou. Il y a dans cette
province plufieurs bons ports & baies ; l’air y eft
doux 6c tempéré, & les Vallées abondantes en blé.
Ses principales denrées font le gros 6c le menu bétail
, du bois, du poiffon, 6c fur-tout du hareng.
Elle contient un archevêché, qui eft celui de
Cashel, cinq évêchés, fept villes à marchés publics,
vingt-cinq bourgs qui ont droit d’envoyer leurs députés
au parlement d’Irlande, & quatre-vingt pa-
roiffes. Quoique Waterford paffe pour la principale
de fes villes, Limerick l’emporte aujourd’hui.
Anciennement la province de Mounfler étoit partagée
entre les Ultcrni habitués à Tipperari, les Co-
riandri qui poffédoient Limerick, Waterfordune,
partie du Tipperari 6c de Cork ; le Luctni qui oc-
cupoient Kerry, & les Vodiiqui jouiflbient d’une
partie de Cork. Aujourd’hui cette province eft di-
vifée en cinq comtés qui fe fubdivilent tous cinq en
deux baronies. ( D. J. )
MOURA, ( Géog. ) ville de Portugal, dans la
province d’Alentéjo, au confluent de l’Ardila 6c de
la Guadiana, au nord de Serpa. C ’eft une ville ancienne
, connue autrefois fous le nom d'Arucci nova,
ou Nova civitas aruccitana j comme le prouvent des
infcriptions qu’on y a découvertes. Elle eft fortifiée
avec un vieux château pour fa défènfe : fa polition
eft à 33 lieues S. E. de Lisbonne. Long. 10. 3 6 .
lut. 38. ( D . J .)
MOURGON, f.m . (Marine. ) on appelle ainfi
fur la Méditerranée un plongeur. Foye{ Plongeur.
MOURJAN, ( Géog. ) ville de Perfe, que Taver-
nier place à 84d. 15. de long. & à 37 d. 15. delatit.
MOURINGOU, ( Botan. exot. ) arbre des Indes
orientales qui produit la groffe efpece de.nOix ben.
Cet arbre eft le moringa çeylanica, foliorum pin*
nis pinnatis, flore majore , fruclu anguLofo. Buzen ,
Ther. Z bilan. p. iGz. Tab. y S.
Il eft haut d’environ vingt-cinq piés, & gros d’environ
cinq piés. Son écorce eft blanchâtre en-de-?
dans, noirâtre en-dehors, d’une odeur & d’une faveur
fort femblable à celle du creffon, ou du raifort
fauvage. Ses rameaux font d’un bois blanchâtre,
couverts d’une écorce verte ; l’écorce de la racine
eft jaunâtre ; elle a la même faveur que celle du
tronc ; les feuilles font ailées, terminées par une
feuille impaire ; de maniéré que leur côte commune
qui eft longue d’environ une coudée , porte de chaque
côté trois côtes plus petites, garnies de petites
feuilles, comme l’eft l’extrémité de la côte commune.
Ces petites feuilles font longues, obtufes, mince
s, molles, & tendres : chacune eft partagée par
une côte faillante, d’oiifbrtent quelques nervures
qui fe répandent fur les côtes : elles ont l’odeur des
fèves ; fes fleurs font en grape, éparfés au-haut des
ti«és; le calice eft compofé'de cinq feuilles, oblon-
gues, obtufes , égaies , colorées, 6c qui tombent.
Les feuilles de la fleur font aufliau nombre de cinq,,
de la grandeur 6c déjà figure des feuilles du.calice ;
elles font plus écartées vers le bas : c’eft pourquoi
des auteurs regardent la fleur comme .compôfée de
dix feuilles, au milieu defquelles font dix étamines,
dont les cinq inférieures font plus longues, réfléchies
vers le haut. Il n’y a qu’un piftil pofé fur un
long embryon. Lorfque les fleurs font tombées , il
leur fuccede des fruits ou des goufles cylindriques,
longues d’une coudée & demie, triangulaires, ca-
nelées,. à trois panneaux, dont l’écorcè eft d’une
couleur herbacée : la fubftance intérieure en eft
-blanchâtre & fongueufe. Elles contiennent des graines
en grand nombre, félon la longueur de la goufle,
triangulaires, garnies d’une membrane ailée, côiivertes
d’une peau cartilagineufe, qui renferme une
amande blanchâtre.
■ Cet arbre croît dans les fables de Malabar, de
Ceylan, 6c dans d’autres pays des Indes : il fleurit
au mois de Juin, de Juillet, 6c d’Âout. On en recueille
les fruits tantôt à la fin, tantôt dans l’un &
l’autre tems. On cultive cet’arbre dans les jardins
& les maifons de campagne, à caufe de fes fruits que
l’on porte vendre de tous côtés.
Les Indiens préparent des pilules antifpafmodi-'
ques avec les feuilles, l’écoxce de la racine, & les
fruits. Ils prétendent que fi l’on boit le fuc pur de
l’écorce du mouringöu avec de l’eau & de l ’a i l, it
adoucit les élancèmens des membres qui viennent
de froid. Le fuc de là racine pilée avec de l’ail &
du poivre, fe donne aufli contre les fpafmes. Le fuc
de ces mêmes feuilles s’applique pour déterger les
ulcérés. En un mot, toute la plante eft d’un grand
ufage dans la Médecine indienne : nos parfumeurs
la leur abandonnent pour tirer de l’huile de fon fruit
l’odeur des fleurs odorantes, comme des tubéreu-
fes , desjafmins, & autres femblables. Foye^ comment
ils s’y prennent aux mots Ben & N o ix b en; Sh I MOURON , f. m. ( Hfi. nat. Botan. ) anagallis ,
genre de plante à fleur monopétale, en rofette, &
profondément découpée. Le piftil fort du calice, il
tient comme un clou au milieu de la fleur, & il devient
dans la fuite un fruit ou une coque prefqüé
ronde. Quand ce fruit eft mûr, il s’ouvre de lui-
même tranfverfalemcnt en deux parties , dont l’une
anticipoit fur l’autre, 6c il renferme des femences
qui font ordinairement anguleufes & attachées à un
placenta. Tournefort, biß. rei herb. Foye[ Plante.
On compte principalement au nombre de ces efr
peces, i° . le mouron mâle , z°. le mouton femelle
qui cependant ne différé du précédent que parla
couleur de la fleur , 30. le mouron aquatique.
Le mouron mâle , ou à fleur rouge, eft nommé
par C. B. P. 252, & par Tournefört, 1. R. H. 142,
anagallis , phceniceo flore.
Sa racine eft blanche , fimple, fibreufe ; fes tiges
font tendres, couchées fur terre , longues d’une palmé
, quarrées , liffes, garnies de feuilles, oppofées
deux' à deux, quelquefois trois à trois , femblables
à celles de la morgeline, fans queue , & tachetées
en-deffous de points d’un rouge foncé. Ses fleurs
portées fur des pédicules grêles & oblongs, naiffent
chacune de l’aiflelle d’une feuille. Elles font d’une
feule piece, partagée prèfque'entièrement en cinq
fegmens pointus ; la- couleur des fleurs eft pourpre ,
aufli-bien que celle des étamines, dont les fommets
font jaunes ': leur calice eft partagé en cinq quartiers
; il fort un piftil attaché en maniéré de clou, au
milieu de la fleur. Ce piftil fe change en un fruit où
capfule prefque fphérique, grande à proportion de
la petite fleur : cette capfule s’ouvre tranfverfale-'
ment par la maturité en deux parties, dont.l’une eft
appuyée fur l’autre. Elle eft remplie de-graines me?
nues, anguleufes, ordinairement ridées, brunes ,
attachées à un placenta.
Le*mouron femelle, ou à fleurs bleues , anagallis
carüleo flore, ne différé du précédent, que par la
couleur de la fleur, qui eft quelquefois blanche! Ces
deux efpeces de mourons font fort communs dans les
champs 6c les jardins ; on fait quelque ufage des
feuilles avec la fleur. .
Toute la plante a une faveur d’herbe un peu fa-‘
lée & auftere ; fon fuc donne là couleur rouge au
papier bleu : d’où l’onpénfe que le fel eflentiel.de
cette plante, approche fort de la terre foliée de tar-'
tre, mêlé avec quelque portion de fel ammoniacal,
& de beaucôup d’huile'.
Le mouron aquatâtïquenommé par les Botaniftés
anagallis.aquatica , five btcabunga, a la racine vivace
, garnie de fibres blanches, chevelues : fes tiges
font hautes d’un pie, grêles , 6c liffes; fes feuilles
fortent des noeuds fur des queues fort courtes; elles
font oppofées deux à deux, graffes, fucculentes,
rondes, peu ou point dentelées à leurs bords. Les
fleurs font bleues, compofées d’un demi-pétale, di-
vifié en cinq fegmens^ arrondis : elles fe changent en
lin fruit fait en coeur applati, qui contient une fe-
mence très-petite. Cette plante croît dans les ruif-
feaux 6c leS'foffes dont l’eau eft courante ; elle paffe
pour anti-feorbutique 6c déterfive. ( D . J. )
Mouro n, ( Mat. med. ) mouron mâle & femelle :
on les prend indifféremment pour l’ufage de la Médecine
, on pour mieux dire, les auteurs les recommandent
indifféremment : car ce font-là, certes, des
plantes les moins ufuelles.
Le mouron eft dans les livres, céphalique, vulnéraire
, fudorifique, anti-peftilentiel, emmenago-
gue, calmant ; & pour l’ufage extérieur mondifiant,
cicatrifant , guériffant la morfure des viperes & des
chiens enragés. C ’eft fon fuc, fon infufion dans le
v in , & fon eau diftillée, qui font recommandés dans
tous ces'cas. Il faut fe contenter de dire du fuc & de
l ’infufion, que ce ne font pas des remedes éprouvés ;
& l’on doit affurer de l’eau diftillée, que c’eft une
préparation- abfolument inutile : car le mouron eft
de l’ordre des plantes qui ne contiennent aucun principe
mobile. Foye^YLw distillée. (Æ)
Mouron d’eau,famolus, (Hiß. nat. Botj) genre
de plante à fleur monopétale, en forme de rofette ,
& profondément découpée : il fort du calice un piftil
qui eft attaché comme un clou au milieu de la
fleur. Ce piftil devient dans la fuite un fruit ou
une coque qui s’ouvre par la pointe, & qui eft remplie
de femences pour l’ordinaire petites. Tourne-,
fo r t , Infi, rei herb. Foyeç Plante.
MOÜRRE, f. f. ( Jeux anciens. ) jouer à la mourre
fe dit en latin micare dïgitis ; c’eft le terme de Cicéron
, parce que dans ce jeu les doigts paroiffent,
micant. Pétrone fe fert du leulmot micare, fous-enten-
dant digitis. .
On joue à ce jeu en montrant une certaine quantité
de doigts à fon adverfaire , qui fait la même
chofe de fon côté. On aéeufe tous deux un nombre
en même tems, & l’on gagne quand on devine le
nombre de doigts qui font préfentés. Ainfi on n’a
befoin que de fes yeux pour favoir jouer à ce jeu.
• Il eft très-ancien, & l’un de ceux qui étoient le
plus en ufage parmi les dames de1 Lacédémone : e’é-
toit à ce jeu qu’elles tiroient au fort pour difputer le
bonheur l-’une contre l’autre , & même contre leurs
amans. Il faut tomber d’accord que ce jeu , qui n’en-
tre aujourd’hui que dans-les dïvertiffemens galans
du petit peuple en Hollande & en Italie , devoit faire
for tune chez les Lacédémoniennes, fi l’on fe rappelle
que la perfbhne qui l’inventa fut Helene : elle y joua
contre Paris & le-gagna. C’eft unpaffage de Ptolæ-
meus , qui^ nous apprend ce trait d’hiftoire. Helena,
dit-il, prima èxcogitavit micatîonem digitis , 6* cum
Akxandro fortiens , vielt.
1 Ce jeu prit grande faveur chez- les autres Grecs
& chez les Romains: c’eft à ce jeu qu’ils àchetoient
& vendoient quantité de chofes ; comme nous ferions
aujourd’hui à la courte paille. Dignus efl qui
cum in tenebris rriiees, dit Cicéron ; il eft fi homme de
bien , que voits pouvez jouer à la mourre avec lui
dans les ténèbres, fans craindre qu’il vous trompe ;
expreffion qui.paffa en provqrbe pour peindre quelqu’un
de'la plii's'èxaûe probité; (D . / .)
MOUROUVE,; ( Botan exot‘. ) efpece de prunier
‘*d'és Indes Occidentales'décrit par de Laet Uv. X F I .
'ch. xj. Sa fleiif eft jaune, & fon fruit femblable à
'-nos cerilès ; il eft foutenu par une longue queue.,
renferme une pulpe douce d’un jaune doré, & con-
tient un petit noyau. (D. ƒ.)
MOUSQUET, f. m. c’eft dans P Art militaire une
arme à feu qui etoit en ufage dans les troupes avant
le fufil, montée de même fur un fût ou bâton, 6c qui
fe portoit également fur l’épaule.
Le moufquet diffère du fufil, en ce qu’au lieu de la
pierre dont on fe fert pour faire prendre feu à cette
derniere arme, on fe fert de meche dans la première.
Les moufquets ordinaires font du calibre de 20
balles de plomb à la livre, & ils reçoivent des balles
de 22 à 24. Le canon du moufquet eft de trois piés
huit pouces, & toute la longueur du moufquet monté
eft de cinq piés. Sa portée eft de 120 jufqu’à 150 toi-
f e s . Ligne de défense.
Le moufquet a une platine à laquelle eft attachée
le ferpentin, avec le reffort ou gâchette qui le fait
mouvoir & le bafîinet.
Le ferpentin tient à la platine, par le moyen d’une-
vis : fon extrémité en dehors a deux efpeces de
feuilles formées par une tête dè ferpent, propres à
retenir fixement, à l’aide d’une vis , la meche avec
laquelle on met le feu au moufquet. C ’eft cette tête-
de ferpent qui fait donner à cette piece le nom de
ferpentin. La partie du ferpentin qui fe trouve engagée
fous ia platine, forme une petite gâchette où
va répondre la cle. Cette clé eft un morceau de fer:
difpofé en équerre ou manivelle, dont un côté tient
à la gâchette du ferpentin ■ , l’autre fe tire avec la'
main ^ pour faire tomber la meche du ferpentin fur*
le bafîinet, 6c faire ainfi partir le moufquet.
Le bafîinet eft fait de quatre pièces de fer pofées,
en faillie fur la platine , visrà-vis la lumière ou la
petite ouverture faite au canon du mo.uf'quet pour lui-'
faire prendre feu parle moyen de l’amorce renfermée
dans le baffinet. La petite piece inférieure- tail-
lée en creux ponr recevoir.,cette amorce, eft pro^
prement le bafjinet ; celle de deffus s’appelle couverture
; la troifieme piece eft Le garde-feu, 6c la quatrième
eft la vis qui les tient toutes enfemble. :
L’équipage, du moufquet eft à-peu-près le même
que celui du fufil, voye[ Fusil.
Les moufquets ont été en ufage dans les troupes
immédiatement après les arquebufes : on en fayoit
faire dès le tems de François I. car le P. Daniel nous
apprend dans .fon hifloire de là milice françoife, qu’au
cabinet d’armes de Chantilly on en voyoit unlnar-?
que des armes de France avec,la falamana.re, qui
étoit la devife de ce prince. Cependant Brantôme
prétend que ce fut le ducd’ÀIbe qui les mirle premier
en ufage'dans les armées, lorfque fous le régné
de Philippe II. il alla prendre le gouvernement des
Pays-Bas, l’an 1567 ; mais cela veut dire feulemenr;
dit l’auteur que nous venons de citer, qu’j Lies mit
I plus à la mode qu’ils n’avoient été jufqu’alprs , 6c
qu’avant lui on s’en fervoit.plus,rarement, au-moin?
en campagne..
Les foldats qui étoient armés‘ de moufquets étoient
appellés moufquetaires., 6c c’eft cette arme dent les
deux compagnies de môiifquétaires de la garde du
roi furent d’abord armées en France, qui leur a fait
donner le nom de moufquetaires, de la même maniéré
que le premier corps de troupes armé de. fufils fut
d’abord appelle fuflliers : c’eft aujourd’hui le régiment
royaï-artillerie.
On s’eft fervi de moufquets dans les troupes jufqu’erï
i 6o4;maispeu de tems après cetteannéeonleùr fubf-
titua lefufil. Il. y eut différens fentimens, dirM. le maréchal
de Puifégur,dans fort traité de Part de La guerre '
l'orfqu’il fut queft'ion de faire ce changement. On dx-
foi't qu’avec le moufquet on faifoit plus long-tems feu
qu’avec le fufil, qu’il manquoit beaucoup moins de
tirer, au lieu que la batterie de fufil étoit f j jette à nfc