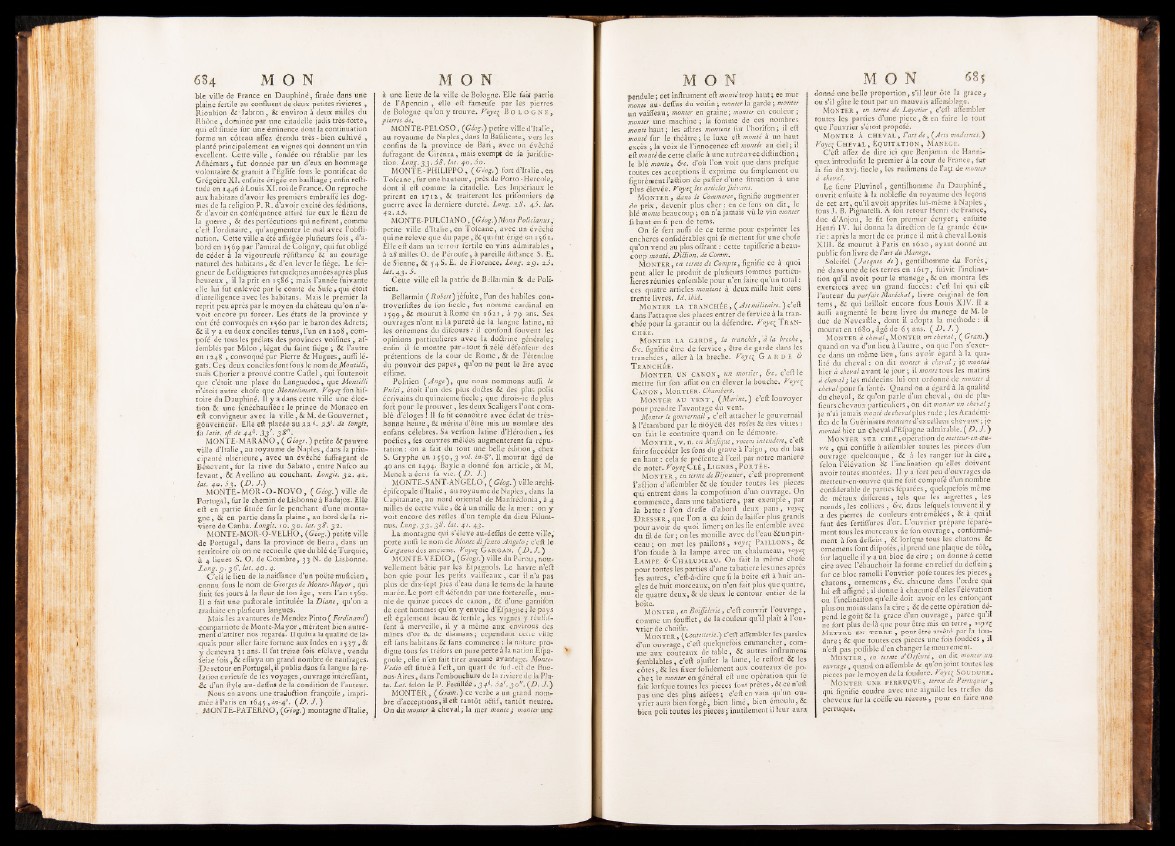
6 S4 M O N
ble ville de France en Dauphiné, lituée dans une
plaine fertile au confluent de deux petites rivières ,
Rioubion 8c Tabron, 8c environ à deux milles du
Rhône , dominée par une citadelle jadis très-forte,
qui eft fituée fur une éminence dont la continuation
forme un coteau affez étendu très - bien cultivé ,
planté principalement en vignes qui donnent un vin
excellent. Cette v ille , fondée ou rétablie par les
Adhémars, fut donnée par un d’eux en hommage
volontaire 8c gratuit à l’Eglife fous le pontificat de
Grégoire X I. enfuite érigée en bailliage ; enfin refti-
tuée en 1446 à Louis XI. roi de France. On reproche
aux habitans d’avoir les premiers embraffé les dogmes
de la religion P. R. d’avoir excité des féditions,
& d’avoir en conféquence attiré fur eux le fléau de
la guerre , & des perfécutions qui ne firent, comme
c’eft l’ordinaire, qu’augmenter le mal avec l’obfti-
nation. Cette ville a été afliégée plufieurs fois , d’abord
en 1 ^69 par l’amiral de Coligny, qui fut obligé
de céder a la vigoureufe réfiftance & au courage
naturel des habitans, 8c d’en lever le fiége. Le fei-
gneur de Lefdiguieres fut quelques années après plus
heureux , il la prit en 1586; mais l’année fuivante
elle lui fut enlevée par le comte de Sufe, qui étoit
d’intelligence avec les habitans. Mais le premier la
reprit peu après par le moyen du château qu’on n’a-
vpit encore pu forcer. Les états de la province y
ont été convoqués en 1560 par le baron des Adrets;
& il y a eu deux conciles tenus,l’un en 1208, com-
pofé de tous les prélats des provinces voifines , af-
femblés par Milon , légat du faint fiége ; 8c l’autre
en 1248 » convoqué par Pierre 8c Hugues, aufli légats.
Ces deux conciles font fous le nom de Montilli,
mais Chorier a prouvé contre Ca ftel, qui îoutenoit
que c’étoit une place du Languedoc, que Montilli
n’étoit autre chofe que Montelimart. Voyez fon hif-
toire du Dauphiné. Il y a dans cette ville une élection
& une fénéchauffée : le prince de Monaco en
eft convigneur avec la ville ,&M.d eGou vern et,
gouverneur. Elle eft placée au 22 d. 26'. de longit.
fa latii. ejl de 44d. 33 '• 38 "•
MONTE-MARANO, ( Géogr. ) petite & pauyre
ville d’Italie, au royaume de Naples, dans la principauté
ultérieure, avec un évêché fuffragant de
Béaevent, fur la rive du Sabato, entre Nufco au
levant, 8c Avellino au couchant. Longit. 32. 42.
lai. 4o. 63. {D . /.)
M ON TE -M O R -O -N O VO , ( Géog. ) ville de
Portugal, fur le chemin de Lisbonne à Badajoz. Elle
eft en partie fituée fur le penchant d’une montagne
, & en partie dans la plaine, au bord de la rivière
de Canha. Longit. 10. go. lat. 38. 32. •
MONTE-MOR-O-VELHO, {Géog.') petite ville
de Portugal, dans la province deBeira, dans un
territoire où on ne recueille que du blé de Turquie,
ù 4 lieues S. O. de Coimbre, 33 N. de Lisbonne.
Long. g. 3 6. lat. 40. 4.
C ’eft le lieu de la naiffance d’un poëte muficien,
■ connu fous le nom de Georges de Monte-Mayor, qui
finit fes jours à la fleur de fon âge, vers l ’an 1560.
Il a fait une paftorale intitulée la Diane, qu’on a
traduite en plufieurs langues.
Mais les avantures de Mendez Pinto ( Ferdinand)
■ compatriote de Monte-Mayor, méritent bien autrement
d’attirer nos regards. Il quitta la qualité de laquais
pour aller faire fortune aux Indes en 15 3 7 , &
y demeura 31 ans. Il fut treize fois efclave, vendu
leize fois, 8c eflùya un grand nombre de naufrages.
D e retour en Portugal, il publia dans fa langue la relation
curieufe de fes voyages, ouvrage intéreffant,
£c d’un ftyle au-deffus de la condition de l’auteur.
Nous en avons une traduftion françoife, imprimée
à Paris en 1645 ■> in~4°* (^ * -^ )
MONTE-PATERNO, {Géog.) montagne d’Italie,
MO N
à une lieue de la ville de Bologne. Elle fait partie
de l’Apennin , elle eft fameufe par les pierres
de Bologne qu’on y trouve. Voyez B o l o g n e ,
PUMONTE-PELOSO, {Géog.) petite ville d’Italie,
au royaume de Naples, dans la Bafilicate, vers les
confins de la province de Bari, avec un évêché
fufragant de Cirenza, mais exempt de fa jurifdic-
tion. Long. 33.68. lat. 40.60.
MONTE-PHILIPPO, {Géog.) fort d’Italie, en
Tofcane, fur une hauteur, près de Porto-Hercole,
dont il eft comme la citadelle. Les Impériaux le
prirent en 17 12 , 8c traitèrent les prifonniers de
guerre avec la derniere dureté. Long. 28. 46. lat.
42. 26.
MONTE-PULCIANO, {Géog.)Mons Policianus,'
petite ville d’Italie, en Tofcane, avec un évêché
qui ne releve que du pape, 8c qui fut érigé en 1561.
Elle eft dans un terroir fertile en vins admirables ,
à 28 milles O. de Péroufe, à pareille diftance S. E.
de Sienne, 8c 54 S. E. de Florence. Long. 2 c). 26+
lat. 43. 6.
Gette ville eft la patrie de Bellai min & de Poli-
tien.
Bellarmin {Robert) jéfuite, l’un des habiles con-
troverfiftes de fon fiecle, fut nommé cardinal en
1599,8c mourut à Rome en 16 21 , à 79 ans. Ses
ouvrages n’ont ni la pureté de la langue latine, ni
les ornemens du difeours : il confond fouvent Jes
opinions particulières avec la do&rine générale;
enfin il fe montre par-tout fi zélé défenfeur des
prétentions de la cour de Rome, 8c de l’étendue
du pouvoir des papes, qu’on ne peut le lire avec
eftime.
Politien {Ange), que nous nommons aufli le
Pulci, étoit l’un des plus doftes 8c des plus polis
écrivains du quinzième fiecle ; que dirois-je déplus
fort pour le prouver, les deux Scaligers l’ont comblé
d’éloges ! Il fe fit connoître avec éclat de très-
bonne heure, 6c mérita d’être mis au nombre des
enfans célébrés. Sa verfion latine d’Hérodien, fes
poéfies, fes oeuvres mêlées augmentèrent fa réputation
: on a fait du tout une belle édition, chez
S. Gryphe en 1550,3 vol. in-8°. Il mourut âgé de
40 ans en 1494- Bayle a donné fon article, 8c M.
Menekaécrit fa vie. {D . J.)
MONTE-SANT-ANGELO, ( Géog.) ville archi-
épifcopale d’Italie, au royaume de Naples, dans la
Capitanate, au nord oriental de Manfrédonia, à 4
milles de cette v ille , 8c à un mille de la mer : on y
voit encore des relies d’un temple du dieu Pilum-
nus. Long.3 3 .3 8 . lat. 41. 43.
La montagne qui s’élève au-deflùs de cette ville,'
porte aufli le nom de Monte di fanto Angelo; c’eft le
Garganus des anciens. Payez G argan. {D . J .)
MONTE-VEDIO, {Géogr.) ville du Pérou, nouvellement
bâtie par les Etpagnols. Le havre n’eft
bon que pour les petits vaiffeaux, car il n’a pas
plus de dix-fept pies d’eau dans le tems de la haute
marée. Le port eft défendu par une fortereffe, munie
de quinze pièces de canon, 8c d’une garnifon
de cent hommes qu’on y envoie d’Efpagne ; le pays
eft également beau 8c fertile, les vignes y réuflil-
fent à merveille, il y a même aux environs des
mines d’or 8c de diamans; cependant cette ville
eft fans habitans 8c fans commerce : la nature pn>
digue tous fes tréfors en pure perte à la nation Elpa-
gnole, elle n’en fait tirer aucune avantage. Monte-
Vedio eft fitué à l’eft,un quart de fud-eftAe Buenos
Aires , dans l’embouchure de la rivière de la Pla-
ta. Lat. félon le P. Feuillée,3 4 d. 62'. 30". {D. J .)
MONTER, {Gram.) çe verbe a un grand nombre
d’acceptions, il eft tantôt aftif, tantôt neutre.
On dit monter à cheval ; la mer monte ; monter une
MO N
pendule ; cet inftrument eft monté trop haut ; e e mur
monte au-deflùs du voifin ; monter la garde ; monter
lin vaiffeau; monter en graine; monter en couleur ;
monter une machine ; la fomme de ces nombres
monte haut ; les aftres montent fur l’horifon ; il eft
monté fur le théâtre ; le luxe eft monté à un haut
excès ; la voix de l’innocence eft montée au ciel; il
e f t monté de cette claffe à une autre avec diftinftion ;
l e blé monte, &c. d’où l’on voit que dans prefque
toutes ces acceptions il exprime ou Amplement ou
figurénaent l’a&ion de paffer d’une fituation à une
plus élevée. Voyelles articlesfuir ans.
Mo n t e r , dans le Commerce, fignifie augmenter
de prix, devenir plus cher : en ce fens on dit, le
blé monte beaucoup ; on n’a jamais vu le vin monter
fi haut en fi peu de tems.
On fe fert aufli de ce terme pour exprimer les
enchères confidérables qui fe mettent fur une chofe
qu’on vend au plus offrant : cette tapifferie a beaucoup
monté. Diction. de Comm.
M o n t e r , en terme de Compte, fignifie ce à quoi
peut aller le produit de plufieurs fommes particulières
réunies enfemble pour n’en faire qu’un total :
ces quatre articles montent à deux mille huit cens !
trente livres. Id.ibid.
M o n t e r l a t r a n c h é e , {Art militaire.) c’eft
dans l’attaque des places entrer de fervice à la tranchée
pour la garantir ou la défendre. Voyez T r a n c
h é e . M
M o n t e r l a GARDE, la tranchée, à la breche,
&c. fignifie être de fervice , être de garde dans les
tranchées, aller à la breche. Voyez G a r d e &
T r a n c h é e .
M o n t e r u n CANON, un mortier, 6*c. è’ efl: le
mettre fur fon affût ou en élever la bouche. Voyez
C a n o n , Mo r t ie r . Chambers.
M o n t e r a u v e n t , {Marine. ) c’eft louvoyer
pour prendre l’avantage du vent.
Monter le gouvernail, c’eft attacher le gouvernail
à l’étambord par le moyen des rofes & des vittes :
on fait le contraire quand on le démonte.
MONTER, v. n. en Mujique, vocem intendere, c’eft
faire fuccéder les fons du grave à l’aigu, ou du bas
en haut : cela fe pré fente à l’oeil par notre maniéré
de noter. VoyezC l é , L ig n e s ,,Portée.
M o n t e r , en terme de Bijoutier, c’eft proprement
l’aftion d’affembler & de fouder toutes les pièces
qui entrent dans la compofition d’un ouvrage. On
commence, dans une tabatière, par exemple, par
la batte: l’on dreffe d’abord deux pans, voyez
D r e sser , que l’on a eu foin de laiffer plus grands
pour avoir de quoi limer; onle.s lie enfemble avec
du fil de fer ; on les mouille avec de l’eau & un pinceau;
on met les paillons, voyez Pa i l l o n s , 8c
l’on foude à la lampe avec un chalumeau, voyez
L am p e 6* C h a l u m e a u . On fait la même chofe
pour toutes les parties d’une tabatière les unes après
les autres, c’eft-à-dire que fi la boîte eft à huit angles
de huit morceaux, on n’en fait plus que quatre,
de quatre deux, & de deux le contour entier de la
boîte.
Mo n t e r , en Boijfelerie, c’eft couvrir 1 ouvrage,
comme un foufflet, de la couleur qu’il plaît à l’ouvrier
de choifir.
Mo n t e r , {Coutellerie.) c’eft affembler les parties
d’un ouvrage, c’eft quelquefois emmancher, comme
aux couteaux de table, 8c autres inftrumens
femblables, c’eft ajufter la lame, le reffort 8c les
côtes, 8t les fixer folidemeDt aux couteaux de poche
; le monter en général eft une operation qui^ fe
fait lorfque toutes les pièces font prêtes, & ce n eft
pas une des plus aifées ; c’eft en vain qu un ouvrier
aura bien forgé, bien limé, bien émoulu, &
bien poli toutes les pièces ; inutilement il leur aura,
M O N 6 8 J
donné une belle proportion, s’il leur ôte la grâce
ou s’il gâte le tout par un mauvais affemblage.
MONTER , en terme de Layetier, c’eft affembler
toutes les parties d’une piece, 8c en faire le tout
que l’ouvrier s’étoit propofé.
Monter à cheval , Part de, {Arts modernes.)
Voyez C heval , Éq u it a t io n , Manege.
C’eft affez de dire ici que Benjamin de Hanni-
quez introduifit le premier à la cour de France, fur
la fin du xvj. fiecle, les rudimens de Kaçt de monter
à cheval.
Le fieur Pluvinel, gentilhomme du Dauphiné,
ouvrit errfuite à la nobleffe du royaume des leçons
de cet art, qu’il avoit apprifes lui-même à Naples
fous J. B. Pignatelli. À fon retour Henri de France,
duc d’Anjou, le fit fon premier écuyer; enfuite
Henri IV. lui donna la direction de fa grande écurie
: après la mort de ce prince il mit à cheval Louis
XIII. 8c mourut à Paris en 1620, ayant donné au
public fon livre de Part du Manege.
Soleifel ( Jacques de ) , gentilhomme du Forés
né dans une de fes terres en 1617, fui vit l’inclination
qu’il avoit pour le manege, 8c en montra les
exercices avec un grand fuccès: c’eft lui qui eft
l ’auteur du parfait Maréchal, livre original de fon
tems, 8c qui brilloit encore fous Louis XIV. II a
aufli augmenté le beau livre du manege de M. le
duc de Nevcaftle, dont il adopta la méthode: il
mourut en 1680, âgé de 65 ans. { D . J .)
Monter à cheval, Monter un cheval, ( Gram.j
quand on va d’un lieu à l’autre, ou que l’on s’exerce
dans un même lieu, fans avoir égard à la qualité
du cheval : on dit monter à cheval ; je montai
hier à cheval avant le jour ; il monte tous les matins
a chevai ; les médecins lui ont ordonné de monter à.
cheval pour fa fanté. Quand on a égard à la qualité
du cheval, 8c qu’on parle d’un cheval, ou de plufieurs
chevaux particuliers, on dit monter un cheval;
je n’ai jamais monté de cheval plus rude ; les Academi-
ftes de la Guérinieremo/ne/zr d’excellens chevaux ; je
montai hier un cheval d’Efpagne admirable. {D . J .)
Monter SUR CIRE, opération de metteur-en-oeuvre
, qui confifte à affembler toutes les pièces d’un
ouvrage quelconque, 8c à les ranger fur la cire ,
félon l’élévation 8c l’inclination qu’elles doivent
avoir toùtes montées. Il y a fort peu d’ouvrages de
metteur-en-oeuvre qui ne foit compofé d’un nombre
confiderable de parties féparées, quelquefois même
. de métaux différens, tels que les aigrettes, les
noeuds, les colliers , &c, dans lefquels l'ouvent il y
a des pierres de couleurs entremêlées, 8c à qui il
faut des fertiflùres d’or. L’ouvrier prépare féparé-
ment tous les morceaux de fon ouvrage, conformément
à fon deffein , 8c lorfque tous les chatons 8c
ornemens font difpofés, il prend une plaque de tôle,
fur laquelle il y a un bloc de cire ; on donne à cette
cire avec l’ébauchoir la forme en relief du deffein ;
fur ce bloc ramolli l’ouvrier pofe toutes fes pièces ,
chatons, ornemens, &c. chacune dans l’ordre qui
lui eft afligné ; il donne à chacune d’elles l’élévation
ou l’inclinaifon qu’elle doit avoir en les enfonçant
plus ou moins dans la cire ; 8c de cette opération dépend
le goût 8c la grâce d’un ouvrage , parce qu’il
ne fort plus de-là que pour être mis en terre , voyez
Mettre en terre , pour être arrêté par la fou-
dure ; 8c que toutes ces pièces une fois foudées , il
n’eft pas poflible d’en changer le mouvement.
Monter , en terme d’Orfevrè, on dit monter un
ouvrage, quand on affemble & qu’on joint toutes les
pièces par le moyen de la foudure. Voyez Soudure.
Monter une perruque,, terme de Perruquier,
qui fignifie coudre avec une aiguille les treffes de
cheveux fur la coeffe ou rézeau, pour en faire une
perruque.