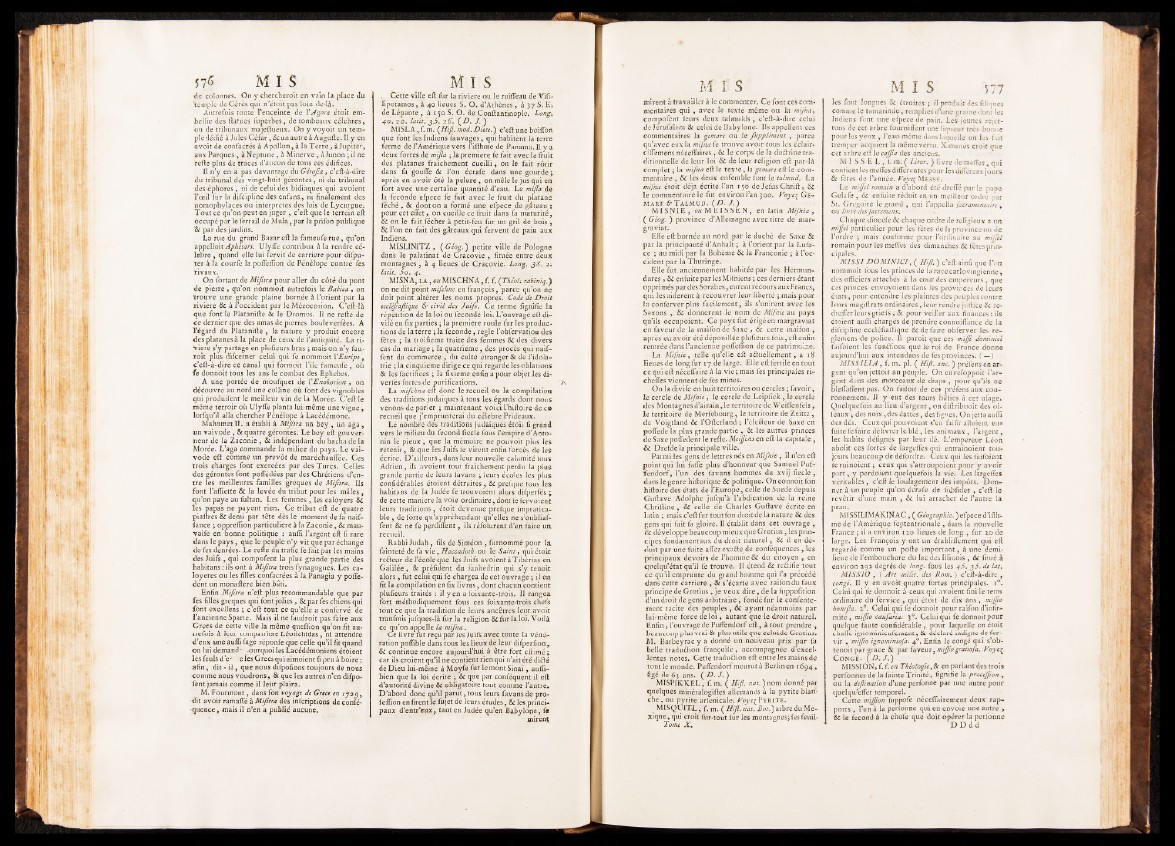
575 MI S
de colonnes. On.y chercheroit en vain la place du
temple de Cérès qui n’étoit pas loin de-Ià.
Autrefois toute l’enceinte de Y Agora étoit embellie
des ftatùes fuperbes, de tombeaux célébrés,
ou de tribunaux majeftueux. On y voyoit un temple
dédié à Jules Céfar, 6c un autre à Augufte. Il y en
avoit de confacrés à Apollon, à la Terre, à JupitéV,
aux Parques , à Neptune, à Minerve, àJunon ; il ne
refte plus de traces d’aucun de tous ces édifices.
Il n’y en a pas davantage du Gèrojîa, c’eft-à-dire
du tribunal.des vingt-huit gérontes, ni du tribunal
des éphores , ni de celui des bidiaques qui a voient
l ’oeil fur la difcipline des enfans, ni finalement des
nomophylaces ou interprètes des lois de Lycurgue*
Tout ce qu’on peut en juger , c’eft que le terrein eft
occupé par le ferrail de Mula , par la prifon publique
& par des jardins.
La rue du grand Bazar eft la fameufe rue, qu’on
appelloit Aphetars. Ulyffe contribua à la rendre célébré
, quand elle lui fervit de carrière pour difpu-
ter à la courfe la poffeffion de Pénélope contre fes
rivaux.
On Portant de Mijîtra pour aller du côté du pont
de pierre, qu’on nommoit autrefois le Babica, on
trouve une grande plaine bornée à l’orient par la
riviere & à l’occident par le Mézocorion. C’eft-là
que font le Platanifte & le Dromos. Il ne refte de
ce dernier que des amas de pierres boule v.erfées. A
l’égard du Platanifte , la nature y produit encore
des platanes à la place de ceux de l’antiquité. La rivière
s’y partage en plufieurs bras ; mais on n’y fau-
roit plus difcerner celui qui fe nommoit YEuripe,
c’eft-à-dire ce canal qui formoit l’île fameufe , où
fe donnoit tous les ans le combat des Ephebes.
A une portée de moufquet de YEnokorion , on
découvre au nord une colline où font des vignobles
qui produifent le meilleur vin de la Morée. C’eft le
même terroir où Ulyffe planta lui-même une vigne,
lorfqu’il alla chercher Pénélope à Lacédémone.
Mahomet II. a établi à Mijîtra un bey , un aga-,
un vaivode , & quatre gérontes. Le bey eft gouverneur
de la Zaconie , & indépendant du bacha de la
Morée. L’aga commande la milice du pays. Le vaivode
eft comme un prévôt de maréchauffée.' Ces
trois charges font exercées par des Turcs. Celles
des gérontes font poffédées par des Chrétiens d’entre
les meilleures familles greques de Mijîtra. Ils
font l’afliette & la levée du tribut pour les mâles ,
qu’on paye au fultan. Les femmes , les caloyers &
les papas ne payent rien. Ce tribut eft de quatre
piaftrés & demi par tête dès le moment de fa naif-
fance ; oppreffion particulière à la Zaconie, 6c mau-
vaife en bonne politique : auffi l’argent eft fi rare
dans le pays, que le peuple h’y vit que par échange
de fes denrées. Le refte du trafic fe fait par les mains
des juifs , qui compofent la plus grande partie des
habitans : ils ont à Mijîtra trois fynagogues. Les ca-
loyeres ou les filles confacrées à la Panagia y poffe-
dent un monaftere bien bâti.
Enfin Mijîtra n’eft plus recommandable que par
fes filles greques qui font jolies, 6c par fes chiens qui
font excèllens ; c’eft tout ce qu’elle a confervé de
l’ancienne Sparte. Mais il ne raudroit pas faire aux
Grecs de cette ville la même queftion qu’on fit autrefois
à leur compatriote Léotichidas, ni attendre
d’eux une auffi fage réponfe que celle qu’il fit quand
on luidemand" pourquoi les Lacédémoniens étoient
les feuls de- . e les Grecs qui aimoient fi peu à boire :
afin, dit - i l , que nous difpofions toujours de nous
comme nous voudrons, & que les autres n’en difpo-
fent jamais comme il leur plaira.
M. Four'mont, dans fon voyage de Grèce en ijz c )3
dit avoir ramaffé à Mijîtra des infcriptions de çonfé-
quence, mais il n’en a publié aucune.
M I S
, Cette ville eft fur la riviere ou le ruiffeaü de Vifi-
' lipotamos, à 40 lieues S. O, d’Athènes, à 3.7 S. E-,
de Lépante, à 150 S. O. de Conftantinople. Long;
40, 20. lati't. $5 . 2G. (D . ƒ. )
MISLA ,f.m. (Hijl. mod. Diète.y c’eft une boiffon
que font les Indiens fauvages, qui habitènt la terre
ferme de l’Amérique vers l’ifthme dé Panama. II y a
deux fortes de mijla ; la première fe fait avec le fruit
des platanes fraîchement cueilli, on le fait rôtir
dans fa gouffe & l’on écrafe dans une gourde;
après en avoir ôté la pelure , on mêle le jus qui en
fort avec une certaine quantité d’eau. Le mijla de
la fécondé efpece fe fait avec le fruit du platane
féché , & dont on a formé une efpece de gâteau ;
pour cet effet, on cueille ce fruit dans fa maturité,
6c on le fait fécher à petit-feu fur un gril de bois *
6c l’on en fait des gâteaux qui fervent de pain aux
Indiens.
MÎSLINITZ , ( Géog. ) petite ville de Pologne
dans le palatinat de Cracoyie , fifuée entre deux
montagnes, à 4 lieues de Cracovie. Long. 38. x*
latit. 5 o. 4.
MISNA, la , ou MISCHNA, f. f. (Théoh ràbiniq.)
on ne dit point mifehne en françois, parce qu’on né
doit point altérer les noms propres. Code de Droit
eccléJîaJUque & civil des Juifs. Ce terme lignifie la
répétition de la loi ou fécondé loi. L’ouvrage eft di-
vifé en fix parties ; la première roule fur les productions
de la terre ; la fécondé, réglé l’obfervatioa des
fêtes ; la troifieme traite des femmes 6c des divers
cas du mariage ; la quatrième , des procès qui naif-
fent du commerce , du culte étranger & de l’idola-
trie ; la cinquième dirige ce qui regarde les oblations
& les facrifices ; la fixieme enfin a pour objet les di-
verfes fortes de purifications. "î\
La mifehna eft donc le recueil ou la compilation
des traditions judaïques à tous les égards dont nous
venons de parler ; maintenant voici l’hiftoire de c»
recueil que j’emprunterai du célébré Prideaux.
Le nombre des traditions judaïques étoit.fi grand
vers le milieu du fécond fiecle fous l’empire d’Anto-
nin le pieux , que la mémoire ne pouvoit plus les
retenir, & que les Juifs fe virent enfin forcés de les
écrire. D’ailleurs, dans leur nouvelle calamité fous
Adrien, ils avoient tout fraîchement perdu la plus
grande partie de leurs favans ; leurs écoles les plus
confidérables étoient détruites , &c prefque tous les
habitans de la Judée fe trouvoient alors difperfés ;
de cette maniéré la voie ordinaire, dont fe fervoient
leurs traditions, étoit devenue prefque impraticable
, de forte qu’appréhendant qu’elles ne s’oubliaf-
fent 6c ne fe perdiffent, ils réfolurent d’en faire un
recueil.
Rabbi Judah, fils de Siméon , furnommé pour la
fainteté de fa vie, Haccadoth ou le Saint, qui étoit
refteur de l’école que les Juifs avoient à Tibérias en
Galilée , & préfident du fanhedrin qui s’y tenoit
alors , fut celui qui fe chargea de cet ouvrage ; il en
fit la compilation en fix livres, dont chacun contient
plufieurs traités : il y en a foixante-trois.. Il rangea
fort méthodiquement fous ces foixante-trois chefs
tout ce que la tradition de leurs ancêtres leur avoit
tranfmis jufques-là fur la religion & fur la loi. Voilà
ce qu’on appelle la mifna.
Ce livre fut reçu par les Juifs avec toute la vénération
poffible dans tous les.lieux de leur difperfion,
6c continue encore aujourd’hui à être fort eftimé ;
car ils croient qu’il ne contient rien qui n’ait été diélé
de Dieu lui-même à Moyfe fur le mont Sinaï, auffi-
bien que la loi écrite ; & que par conféquent il eft
d’autorité divine 6c obligatoire tout comme l’autre.
D’abord donc qu’il parut, tous leurs favans de pro-
feftion en firent le fujet de leurs études, & les principaux
d’entr’eux, tant en Judée qu’en Babylone, f*
' mirent
M I S
mirent à travailler à le commenter. Ce font ces commentaires
qui , avec le texte même ou la mifna,
compofent leurs deux talmulds , c’eft-à-dire celui
de Jérufalem & celui de Babylone. Ils appellent ces
commentaires la gemare ou le fupplément , parce
qu’avec eux la mifna fe trouve avoir tous les éclair-
eiffemens néceffaires , 6c le corps de la doftrine traditionnelle
de leur loi 6c de leur religion eft par-là
complet ; la mifna eft le texte, la gemate eft le commentaire
, ôc les deux enfemble font le talmud. La
mifna étoit déjà écrite l’an 150 de Jefus-Chrift, 6c
le commentaire le fut environ l’an 300. Voye£ G e -
MARE & T à LMUDi ( D . J . )
MISNIE, okMEISSEN, en latin Mifnia,
( Géog. ) province d’Allemagne avec titre de margraviat.
Elle eft bornée au nord par le duché de Saxe &
par la principauté d’Anhalt ; à l’orient par la Lufa-
ce ; au midi par la Bohème 6c la Franconie ; à l’occident
par la Thuringe.
Elle fut.anciennement habitée par les Hermun-
dures, 6c enfuiteparlesMifniens ; ces derniers étant
opprimés par des Sorabes, eurent recours aux Francs,
qui les aidèrent à recouvrer leur liberté ; mais pour
la conferver plus facilement, ils s’unirent avec les
Saxons , 6c donnèrent le nom de Mifnie au pays
qu’ils occupoient. Ce pays fut érigé en margraviat
en faveur de la maifon de Saxe , 6c cette maifon ,
après eu avoir été dépouillée plufieurs fois, eft enfin
rentrée dans l’ancienne poffeffion de ce patrimoine.
La Mijnie, telle qu’elie eft actuellement, a 18
lieues de longfur 17 de large. Elle eft fertile en rout
ce qui eft néceffaire à la vie ; mais fes principales ri-
cheffes viennent de fes mines.
On la divife en huit territoires ou cercles ; favoir,
le cercle de Mifnie, le cercle de Leipfick, le cercle
des Montagnes d’airain, le territoire de Weiffenfels,
le territoire de Merfebourg , le territoire de Zeittz,
de Voigtland 6c l’Ofterland ; l’élefteur de $axe en
poffede la plus grande partie , & les autres princes
de Saxe poffedent le refte. Meijfens en eft la capitale,
6c Drefde la principale ville. .
Parmi les gens de lettres nés en Mifnie , il n’en eft
point qui lui faffe plus d’honneur que Samuel Puffendorf,
l’un des favans hommes du xvij fiecle ,
dans le genre hiftorique & politique. On connoîtfon
hiftoire des états de l’Europe, celle de Suede depuis
Guftave Adolphe jufqu’à l’abdication de la reine
Chriftine , & celle de Charles Guftave écrite en
latin ; mais c’eft fur tout fon droit de la nature 6c des
gens qui fait fa gloire. Il établit dans cet ouvrage ,
6c développe beaucoup mieux que Grotius, les principes
fondamentaux du droit naturel, 6c il en déduit
par une fuite affezexaâe de conféqucnces, les
principaux devoirs de l’homme 6c du citoyen , en
quelqu’état qu’il fe trouve. Il étend 6c reCtifie tout
ce qu’il emprunte du grand homme qui l’a précédé
dans cette carrière , & s’écarte avec raifondu faux
principe de Grotius , je veux dire, de la fuppofition
d’un droit de gens arbitraire, fondé fur le confente-
ment tacite des peuples , & ayant néanmoins par
lui-même force de loi, autant que le droit naturel.
Enfin, l’ouvrage de Puffendorf eft, à tout prendre ,
beaucoup plus vrai & plus utile que celuide Grotius.
M. Barbeyrac y a donné un nouveau prix par fa
belle tradu&ion françoife, accompagnée d’excellentes
notes. Cetté traduûion eft entre les mains de
tout le monde. Puffendorf mourut à Berlin en 1694,
âgé de 63 ans. (D . J. y
MISPIKKEL, f. m. ( Hijl. nat. ) nom donné par
quelques minéralogiftes allemands à la pyrite blarf-
c h e , ou pyrite arlenicale. Voyt{ Py r it e .
M1SQUITL, f. m. ( Hîjl. nat. Bot.y arbre du Mexique.,
qui croît fur-tout fur les montagnes; fes feuil-
Tome X .
M I S 577
les lont lortgues 6c étroites ; il produit des filiques
comme le tamarinde, remplies d’une graine dont les
Indiens font une efpece de pain. Les jeunes rejet-
tons de cet arbre fourniffent une liqueur très-bonne
pour les yeux , l’eau-même dans laquelle on les fait
tremper acquiert la même vertu. Ximenès croit que
cet arbre eft 1 ecaffîa des anciens.
M I S S E L , f. m. ( Litur. ) livre de meffes , qui
contient les meffes différentes pour les différens jours
& fêtes de l’année. Voyeç Messe.
Le mijfel romain a d’abord été dreffé parle pape
Gelafe , 6c enfuite réduit en un meilleur ordre par
St. Grégoire le grand , qui l’appella facrarnentaire >
ou liv fe d&s jacnmtns,
Chaque diocèfe 6c chaque ordre de religieux a un
mijjcl particulier pour les fêtes delà province ou de
l’ordre ; mais conforme pour l’ordinaire au mijfel
romain pour les meffes des dimanches 6c fêtes principales.
MISSI D O MIN ICI, ( Hijl. ) c’eft ainfi que l’on
nommoit fous les princes de la racecarlçvingienne,
des officiers attachés à la cour des empereurs , que
ces princes envoyoient dans les provinces de leurs
états, pour entendre les plaintes des peuples contre
leurs magiftrats ordinaires, leur rendre juftice & re-
dreffer leurs griefs, & pour Veiller aux finances ; ils
étoient auffi chargés de prendre connoiffance de la
difcipline eccléfialtique 6c de faire obferver les re-
glemens de police. Il paroît que ces miffi dominici
faifoient les fonêhons que le roi de France donne
aujourd’hui aux intendans de fes provinces. (—) -
MISS IL IA , f. m. pi. ( Hiß. anc. y préfens en argent
qu’on jettoit au peuple. On enveloppoit l ’argent
dans des morceaux de draps , pour qu’ils ne
bleffaflent pas. On faifoit de ces préfens aux cou-
ronnemens. Il y eut des tours bâties à cet ufage»
Quelquefois au lieu d’argent, ondiftribuoit des oi-
feaux , des noix, des dattes, des figues. On jetta auffi
des dés. Ceux qui pouvoient s’en faifir alloient en-
fuite fe faire délivrer le blé, les animaux, l’argent,
les habits défignés par leur dé. L’empereur Léon
abolit ces fortes de largeffes qui entraînoienf toujours
beaucoup de défordre. Ceux qui les faifoient
fe ruinoient ; ceux qui s’attroupoient pour y avoir
part, y perdoient quelquefois la vie. Les largeffes
véritables , c’eft le foulagement des impôts. Donner
à, un peuple qu’on écrafe de fubfides , c’eft le
revêtir d’une main , 6c lui arracher de l’autre la
peau.
MISSILIMAKINAC, ( Géographie. ) efpece d’ifth-
me de l’Amérique feptentrionale , dans la nouvelle
France ; il a environ izo lieues de long , fur 10 de
large. Les François y ont un établiffement qui eft
regardé comme un pofte important, à une demi-
lieue de l’embouchure du lac des Illinois , & fitué à
environ 292 degrés de long, fous les 4S. jS . de lat.
MISS 10 , ( Art milit. des Rom. ) c’eft-à-dire ,
congés II y en avoit quatre fortes principales. i°.
Celui qui fe.donnoit à ceux qui avoient fini le tems
ordinaire du fervice , qui étoit de dix ans , mißio
hontfia. 20. Celui qui fe donnoit pour raifon d’infirmité,
mijjio caufaria. 30. Celui qui fe donnoit pour
quelque faute confidérable , pour laquelle on étoit
chaffé ignominieufement, & déclaré indigne de fer-
vir , mijßo ignominiofa. 40, Enfin le congé qui s’ob-
tenoit par grâce & par faveur, mijjîogratiofa. Voyeç
c o n g é v (D . j.y
MISSION, f. f. en Théologie ,& en parlant des trois
perfonnes de la fainteTrinité, fignifie la proceffion ,
ou la deflination d’une perfonne par une autre pour
quelqu/effet temporel.
Cette mijjion fuppofe néceffairement deux rapports
, l’un à la perfonne qui en envoie une autre ,
6c le fécond à la chofe que doit opérer la perfonne
D D d d